Cette page traite de deux questions
1) la gratuité de la justice
2) le contenu d'une justice gratuite
NB : nous reproduisons aussi en Annexes le contenu du livre
Quelle justice après la révolution citoyenne ?
Actes du colloque organisé à l'Assemblée Nationale
le 18 juin 2011 par le Parti de gauche
Gratuité de la Justice
In http://leblogdespetitspois.blogspot.fr/p/gratuite-de-la-justice.html
Un blog animé par les auditeurs de justice et les jeunes magistrats du SM
Une archive syndicale sur la gratuité de la justice (texte diffusé avant la suppression de l'instauration de "la contribution à l'aide juridique de 35 euros" qui fut supprimée à compter du 1er janvier 2014)
La gratuité de la justice : une tradition fragile
L’objectif de la gratuité de la justice trouve ses racines dans la conception monarchique de la juridiction : la justice n’était pas conçue comme une prérogative du Roi, mais comme une charge qui lui incombait.
La vénalité des charges n’a pas remis en cause cette conception de la justice. Le coût de la justice d’Ancien Régime, pour être élevé, ne l’était que marginalement du fait du magistrat
1 ; ainsi, les épices ne devaient pas être payées dans les affaires sommaires. Avant même la Révolution, la réforme judiciaire impulsée par le Chancelier Maupeou entre 1771 et 1774 a même tenté d’instaurer la gratuité de la justice.
La loi des 16 et 24 août 1790 dispose finalement que « les juges rendront la justice gratuitement et seront salariés par l’Etat ». Toutefois, au cours du XVIIIe siècle, plusieurs formes d’impôts judiciaires sont rétablies.
La suppression des impôts, droits de timbre, redevances, progresse avec les lois des 28 janv. 1892 et du 28 avr. 1893. Elle fût largement étendue par la loi du 30 décembre 1977 en matière civile et administrative. En 1993, le législateur étendait ce principe à la procédure pénale.
Toutefois les procédures en matière commerciale sont restées soumises à un droit de timbre. De même un droit de plaidoirie est institué depuis 1948 afin de financer les retraites des avocats.
L’idée de faire contribuer les parties au financement de la Justice n’a jamais été tout a fait été éradiquée. La gratuité de la justice est la toile de fond d’un débat séculaire sur le principe et les modalités de taxes judiciaires.
Aujourd’hui encore, les articles L. 111-2 du COJ et 1089 A et 1089 B du CGI affirment le principe de la gratuité des décisions de justice administrative et judiciaire. Avant 2009, jamais ce principe n’avait été aussi largement consacré.
Cet héritage est aujourd’hui en péril.
Genèse d’une régression
La remise en cause de la gratuité de la justice a été opérée silencieusement, soutenue par deux arguments de circonstances : les abus d’une poignée de bénéficiaires de l’AJ et le financement de la garde à vue.
Un ticket modérateur pour la justice ? – L’idée d’un « ticket modérateur » en matière de justice a été développée par le sénateur Roland du Luart (rapport d'information
« L'aide juridictionnelle : réformer un système à bout de souffle », 2007, p. 68 s.). Celui-ci devait avoir pour objet de lutter contre la multiplication abusive des procédures par les bénéficiaires de l’AJ.
Cette proposition était relayée dans le cadre du
rapport Darrois (p. 94 s.), qui remarquait pourtant qu’aucune étude sérieuse ne permettait de mesurer l’ampleur de ce phénomène.
Elle a finalement été entérinée par le législateur
2, qui a rendu exigible le droit de plaidoirie auprès des bénéficiaires de l’AJ.
Pourtant le juge comme les parties disposent d’outils juridiques pour déjouer l’abus du droit d’agir…Embarras au Sénat – Rapporteur du projet de loi instaurant la Contribution pour l’Aide Juridique
3, le sénateur Philippe MARINI (UMP) a pris le soin d’indiquer que le montant de cette taxe avait été choisi dans une
« fourchette haute ». Interrogée par ce sénateur, la Chancellerie a été incapable d’évaluer le coût moyen pour le justiciable d’une affaire en première instance ; elle indiquait simplement que cette nouvelle taxe
« ne devrait pas avoir d’incidences économiques importantes pour (…) les ménages » et que son montant
« restait marginal au regard des frais généralement payés à l’avocat »4.
M. MARINI poursuivait en s’inquiétant sur d’augmentation du coût d’accès à la justice depuis 2010, tenant compte de l’instauration du droit de plaidoirie et de la taxe de 150 € applicable en cas de procédure d’appel.
Mais l’état des finances publiques l’a emporté sur l’éthique : les recettes fiscales estimées couvrent exactement le coût prévisionnel de la réforme de la garde à vue.
Réactions des professionnels de la justice
Ces mesures agitent le monde judiciaire. De nombreuses voix dénoncent la restriction à l’accès au juge et le caractère inéquitable de cette mesure.
Le CNB (Conseil national des barreaux) a déposé un recours au Conseil d'Etat contre le décret d’application de l’article 1635 bis Q du CGI. Le SAF conteste la conformité de la Contribution à l’Aide Juridique au droit d’accès au juge garanti par la CEDSH.
Sa position est plus ambiguë sur le droit de plaidoirie : enjeu social de la profession d’avocat
5, l’augmentation du droit de plaidoirie à 13 € a été négociée par le CNB moyennant son exclusion dans le contentieux pénal et des étrangers.
De nombreux syndicats (cf. ce
communiqué commun et cet autre
communiqué commun soutenu par dix organisations syndicales) exigent désormais le retrait pur et simple de la Contribution à l’Aide Juridique.
Sous la pression des associations de consommateurs, de nombreux parlementaires
6 interpellent désormais le gouvernement sur les effets pervers de la Contribution pour l’Aide Juridique et demandent son exclusion des contentieux opposant le consommateur à un professionnel.
La justice a un coût mais elle n’a pas de prix!
Le financement de la réforme de la GAV : un argument fallacieux – Lerapporteur du projet de loi instaurant la nouvelle Contribution pour l’Aide Juridique dévoilait clairement son but : il s’agit uniquement de pallier le coût de la réforme de la garde à vue
7. La Chancellerie estimait alors la recette fiscale prévisionnelle à 87,5 millions d’euros (pour un besoin de financement analogue lié à la réforme de la garde à vue). Depuis, cette mesure est systématiquement présentée sous ce jour
8.
Or le législateur a également pris le soin d’insérer la L. 10 juil. 1991 un article 64-1-1 qui dispose que le gardé à vue qui a bénéficié de l'intervention d'un avocat commis d'office est tenu de rembourser au Trésor public les sommes exposées par l'Etat, dès lors qu’il n'est pas éligible à l'AJ.
Ainsi, le financement de la garde à vue va largement être assuré à l’avenir, l’Etat ne faisant que l’avance des frais de défense.
La nécessité d’un renflouement du budget de l’AJ est donc purement circonstancielle. Les budgets de l’AJ ont été fortement grevés par la réforme et il incombait à l’Etat de les réalimenter rapidement sans amputer le budget du Ministère de la Justice, déjà très serré.Pourtant cette mesure fiscale est appelée à être pérenne.
La justice ne doit être financée que par l’impôt – Il est intolérable que la Justice soit réduite à une simple prestation de service dont le coût doit peser, même partiellement, sur l’utilisateur!
Revendiquer la gratuité de la Justice, ce n’est pas négliger son coût. C’est dire que celui-ci doit être financé par l’impôt et non par la taxe, par la communauté des contribuables et non pas par l'utilisateur de ce service public régalien.
Parce que sans institution judiciaire, l’Etat de droit n’est qu’une création de papier, il est capital d’assurer le plus largement possible l’accès du citoyen à son juge. Le coût de l’action en justice est déjà discriminatoire et, dans une certaine mesure, irréductible ; avocats, huissiers et experts ne se nourrissent pas par photosynthèse. Dans ces conditions, l’Etat ne peut s’autoriser à augmenter le coût de l’accès au juge par la moindre taxe.
L’affectation de la recette de la Contribution d’Aide Juridique au budget de l’AJ est une manœuvre qui consiste à assimiler la réforme de la garde à vue à une revendication professionnelle des avocats. Cette réforme ne couronne pas une revendication corporatiste ; elle prend acte d’une exigence conventionnelle et vise à améliorer les droits des justiciables. La garantie des droits judiciaires a un coût, qui ne pèse que sur le budget de la Justice.
D’autre part, taxer une procédure judiciaire a pour effet de mercantiliser la Justice. Rendre la justice doit rester une prestation dont la contrepartie est inestimable.
Taxer, c’est ébaucher un caractère commercial à la décision judiciaire. En partageant le coût de juger, le justiciable s’approprie la décision judiciaire ; symboliquement, la justice est rendue au nom du justiciable beaucoup plus qu’au nom du peuple français.
Financer la Justice par l’impôt est un choix éminemment politique : c’est l’exigence démocratique d’assurer l’effectivité du Droit
La fiscalité de la justice doit assurer l’égalité des justiciables!
Les hommes naissent égaux en droit ; ils doivent également le demeurer. Assurer l’égalité des justiciables y participe.
Or l’accumulation des taxes judiciaires a un effet dissuasif indiscutable.
Assigner et faire appel d’une décision, moyennant deux plaidoiries, suppose d’avancer 203 € en taxes diverses9. Pour beaucoup de justiciables, une telle somme prohibe le recours à la justice.
Par ailleurs, beaucoup de procédures sont intentées par flux à l’encontre des consommateurs, pour des montants souvent modérés (en matière bancaire, assurantielle, etc.). Par le jeu mécanique des dépens, la moindre condamnation se voit majorée d’une somme de 35 € de frais de justice.
De plus, la Contribution pour l’Aide Juridique est perçue « par instance », ce qui favorise encore la concentration des instances et des moyens, aux dépens du justiciable non assisté.
Enfin, l’indexation de ces taxes sur les barèmes de l’AJ crée un effet de plafonnement particulièrement cruel pour les justiciables dont les ressources excèdent légèrement le seuil d’accès à l’AJ.
En l’état, ces mesures défavorisent les justiciables les plus pauvres.
Sur la légalité de ces mesures au regard de la CEDH
L’article 6 § 1 de la CESDH garantit le droit d’accès à la justice. Sur cette base normative, la CEDH a clamé que la protection de l’ensemble des droits de l’homme, pour être concrète et effective, n’est assurée que par l’accès au juge (Airey c. Irlande, 9 octobre 1979). Toutefois le « droit à un tribunal » n’est pas absolu ; les Etats membres peuvent restreindre l’accès au juge par l’établissement d’une taxe ou d’une caution judiciaire, dans la mesure où celle-ci a un but légitime et que cette atteinte est proportionnée à cet objectif (cf. arrêt Kreuz c. Pologne, 19 juin 2001, §§ 53 s.). Il y a lieu, pour le juge strasbourgeois, de tenir compte de la solvabilité du demandeur et de la phase de la procédure à laquelle la restriction a été imposée – à moins que celle-ci fût telle que le droit d’accès au juge ait été atteint dans sa substance même (Weissman et autres c. Roumanie, 24 mai 2006, § 37).
La CEDH a ainsi considéré qu’une taxe conditionnant l’accès au juge violait l’article 6 § 1 de la Convention lorsqu’elle était établie au pro rata de la demande, sans considération de ressources (cf. Daniel Ionel Constantin c/ Roumanie, 30 juin 2009).
In abstracto, il semble que la Contribution à l’Aide Juridique a été conçue pour échapper à tout risque d’inconventionnalité. Elle renonce à toute forme de proportion à l’enjeu du litige et s’efface en cas de droit à l’aide juridictionnelle.
Toutefois, il y a fort à parier que le juge qui déclarerait irrecevable l’action intentée par un demandeur impécunieux ayant négligé de demander le bénéfice de l'AJ laisse peser sur sa décision un risque d’inconventionnalité....
935 € + 150 € + 2 x 8,84 €
Syndicat de la magistrature
Septembre 2013
De renoncement en renoncement, quelle justice pour la gauche ?
Après l’échec de la réforme du Conseil supérieur de la magistrature, qui devait conduire la justice, particulièrement instrumentalisée ces dernières années, à plus d’indépendance à l’égard du pouvoir politique, après le report de la réforme pénale qui devait permettre de revenir sur 10 années de politique du tout carcéral au profit d’une politique centrée sur l’individualisation de la peine et la réinsertion des délinquants, le gouvernement envisage désormais de réduire de 32 millions d’euros le budget de l’aide juridictionnelle.
C’est pourtant l’aide juridictionnelle qui permet aux plus fragiles et aux plus démunis (locataires, salariés, étrangers, personnes hospitalisées sous contrainte,…) de bénéficier de l’assistance gratuite d’un avocat, condition absolument nécessaire à une défense effective et de qualité pour tous.
Alors que la rémunération des avocats qui prêtent leur concours aux plus défavorisés n’a pas été revalorisée depuis 2007, le gouvernement prépare un tour « de passe-passe » qui aboutira à une diminution sans précédent de la rétribution d’une grande majorité d’avocats qui ne pourront plus dès lors accomplir correctement cette mission.
Les plafonds d’accès au bénéfice de l’aide juridictionnelle sont particulièrement bas et privent déjà de fait bon nombre de justiciables, dont la crise économique a accru la précarisation, de l’assistance d’un avocat. Cette baisse drastique du budget de l’aide juridictionnelle va priver une partie encore plus importante de la population de la possibilité de voir garantir ses droits.
Le Premier ministre prévoit de réaliser ces « économies » grâce à un meilleur recours à « l’assurance juridique » et à la « déjudiciarisation de certaines procédures à la suite des conclusions des réflexions sur l’office du juge ». Révélant ainsi par avance les conclusions des groupes de travail sur la justice du 21ème siècle, qui n’ont pas encore achevé leurs travaux, il signifie clairement que les décisions sont déjà prises et qu’elles n’ont qu’un seul but : gérer la pénurie en réduisant les missions pourtant fondamentales du juge, et en privatisant, par le développement de l’assurance, l’une des missions essentielles de l’Etat, garantir l’accès des citoyens à leur justice.
La suppression de la taxe à 35 euros, annoncée par Christiane Taubira au mois de juillet n’était donc qu’un trompe l’oeil. Ce sont les justiciables les plus démunis, et ceux qui les assistent, qui supporteront le coût de cette suppression.
La France, qui ne consacre à l’aide juridictionnelle que 4,9 euros par habitant contre 8 euros en moyenne en Europe, se devait de rattraper son retard et de mettre en place une véritable politique d’aide et d’accès au droit en direction des plus défavorisés. Le gouvernement a au contraire choisi de réduire encore son engagement.
Le Premier ministre a fait clairement connaître ses choix : il poursuit l’oeuvre de ses prédécesseurs, il en aggrave même les conséquences, et a renoncé à mettre en place une justice plus humaine, plus accessible, et égale pour tous.
.La remise en cause de la gratuité de la justice
:
La loi n° 2011-939 du 10 août 2011 relative à la participation des citoyens au fonctionnement de la justice pénale et le jugement des mineurs publiée au journal officiel du 11/08/2011 réforme en profondeur la participation des citoyens à la justice pénale en l'étendant à des domaines inédits.
En effet, traditionnellement associé aux magistrats professionnels dans le cadre du jugement des crimes (cours d'assises) les citoyens sont désormais amenés aussi à être associés dans le cadre de jugements de certains délits (tribunal correctionnel) mais aussi aux décisions relatives à la libération conditionnelle des détenus (juge des libertés et chambre d'instruction de la cour d'appel).
Cette extension de la présence des citoyens dans la justice pénale est inédite depuis les codifications et pose beaucoup de questions sur son fonctionnement futur.
La critique majeure est relative au coût de cette réforme.
L'indemnisation des jurés populaires va peser sur le budget de la justice ainsi que la nécessité d'avoir les moyens matériels suffisants sous peine de discrédit de la justice.
La question va donc être celle du financement comme c'est également le cas de la réforme de la garde à vue financée par un droit de timbre de 35 euros que devra payer tout justiciable souhaitant saisir la justice à compter du 1er octobre 2011.
Cette atteinte au principe même de l'accès à la justice a été posée par la loi n° 2011-900 du 29 juillet 2011 de finances rectificative pour 2011 et complété par un décret n° 2011-1202 du 28 septembre 2011 relatif au droit affecté au fonds d'indemnisation de la profession d'avoué près les cours d'appel et à la contribution pour l'aide juridique.
A très court terme, la justice gratuite (sans avocat) n'existera plus en France à compter du 1er octobre 2011 et c'est l'accès à la justice pour le justiciable qui semble ici remis en cause par le législateur...
Quelle justice ?
Quelques éléments de réflexion
Le site du Syndicat de la magistrature
L'altergouvernement
Le premier Conseil des ministres de l'altergouvernement s'est tenu dans les locaux du DAL (Droit au logement) le 17 février 2012. Le thème de la soirée était : «2012 : quelles mesures pour un monde plus juste et plus égalitaire ?».
Clarisse Taron, Ministre de la justice de l'Altergouvernement
Pour aller plus loin


Quelle justice après la révolution citoyenne ?
Propositions de gauche pour changer le droit
Avec les contributions de : Paul Ariès (politiste, Directeur de la rédaction le Sarkophage), Hélène Franco (magistrate), Manuel Boucher (Sociologue), Jean-Claude Bouvier (magistrat), François Delapierre (Secrétaire national du Parti de Gauche), Michel Demoule (Syndicat CGT de la Chancellerie), Hélène Gacon (avocate), Jean-Pierre Martin (psychiatre), Daniel Ravez (avocat), Gilles Sainati (magistrat), Michel Tubiana (Président d’honneur de la Ligue des droits de l’Homme)
Editions Golias
Collection « Combats actuels » dirigée par Paul Aries.
Ce livre reprend l’essentiel des interventions lors du Forum du Parti de gauche sur la justice et les libertés
- 18 juin 2011 à l’Assemblée nationale
Préface
Hélène Franco
Magistrate
animatrice de la commission justice et libertés du Parti de Gauche,
membre du Bureau national
Cet ouvrage fait suite à un forum organisé par le Parti de Gauche le 18 juin 2011 et qui avait pour titre « Quelle justice après la révolution citoyenne ? ». Il ne constitue pas un programme ficelé mais a pour ambition de tracer, en s’appuyant sur les apports de professionnels et de militant-e-s qui ont accepté d’y participer, des perspectives de gauche pour une institution que dix ans de gouvernement de droite laissent exsangue. Encore faut-il préciser que si la révolution citoyenne ne pourra se limiter à des réformes institutionnelles, si ambitieuses soient-elles, puisqu’elle sera vouée à l’échec sans une implication populaire exigeante, il est tout aussi vrai qu’elle ne pourra pas rester indifférente au mode d’organisation des institutions. Et nous le disons clairement : notre révolution citoyenne est incompatible avec les institutions de la Vème République. Aussi un gouvernement de Front de Gauche engagera-t-il sans tarder un processus constituant avec l’élection d’une assemblée constituante et la soumission au peuple d’une constitution profondément remaniée, faisant de l’extension de la démocratie sa finalité.
Comment imaginer que la justice reste à l’écart de cette refondation républicaine? Pour les républicains ardents que nous sommes, le constat est alarmant : la justice sort en lambeaux d’une décennie de politique consistant d’une part à étriller le service public et d’autre part à mettre à mal les principes humanistes bâtis dans la lutte et dans le sang. Ce pouvoir de tous les abus a réussi l’exploit d’augmenter la défiance du plus grand nombre à l’égard de la justice et de braquer une majorité de celles et ceux qui la servent. Une instrumentalisation démagogique constante tend à réduire l’institution judiciaire à sa fonction punitive qui ne représente pourtant qu’une minorité de ses décisions. Les prud’hommes, les affaires familiales, la protection des enfants en danger et des adultes vulnérables, ce sont des centaines de milliers de situation qui sont cruciales pour la vie de ceux à qui elles s’appliquent et pour la vie en société qui ne peut faire abstraction d’une régulation par le droit.
Face au démantèlement du service public de la justice, dont l’exemple le plus récent et le plus scandaleux est cette taxe de 35 euros instaurée par la loi de finances rectificative du 29 juillet 2011 entrée en vigueur le 1er octobre dernier pour toutes les affaires civiles (prud’hommes, tribunaux des affaires de sécurité sociale, divorces et gardes d’enfants,…) et administratives, nous ferons de l’égalité d’accès au juge un axe majeur de notre action. Il faudra revaloriser substantiellement l’aide juridictionnelle et créer un véritable service public de la défense. Je m’arrête là dans les exemples de réformes qu’engagera un gouvernement de Front de Gauche, vous en trouverez d’autres dans cet ouvrage. Je suis bien conscient que quelques milliards supplémentaires au budget de la Justice (et il faudra le faire) ne suffiront pas à restaurer la confiance. Il faudra aussi repenser l’organisation de la justice et son fonctionnement, permettre de combattre la suspicion par des garanties d’indépendance à l’égard du pouvoir exécutif, faire rentrer la démocratie au sein des juridictions. La participation des citoyens à l’œuvre de justice, qui existe déjà, devra être repensée pour ne pas être un élément de désorganisation d’une institution qui n’a pas besoin de cela, mais pour permettre de réduire le fossé d’incompréhension entre le peuple et sa justice.
Face au brouillage et à la remise en cause des principes directeurs du droit par un pouvoir qui réserve sa mansuétude à une poignée de ses amis et le gros bâton à ceux qu’il a érigés en nouvelles « classes dangereuses » (jeunes des quartiers populaires, prostituées, gens du voyage, étrangers en situation irrégulière,…), il nous faudra remettre l’intérêt général au centre de nos décisions, loin de la privatisation des moyens de l’Etat à laquelle nous assistons. Nous en finirons avec des pratiques qui ont défiguré notre République : l’augmentation vertigineuse des gardes à vue et des écoutes téléphoniques depuis 2002 en sont deux exemples parlants. Nous en finirons avec la pénalisation du mouvement social, le scandaleux fichage génétique des militant-e-s. Nous abrogerons les lois répressives qui déséquilibrent dangereusement la procédure en faveur de l’accusation au détriment des droits de la défense. Nous délivrerons la police d’une absurde politique du chiffre pour lui permettre de restaurer des liens de confiance avec les populations notamment des quartiers populaires et pour concentrer des moyens aujourd’hui nettement insuffisants sur la lutte contre la délinquance économique et financière ou contre les infractions écologiques.
Le constat est clair, nos solutions le sont tout autant. Le Front de Gauche est prêt à les mettre en œuvre, avec la détermination tranquille que nous détiendrons de la confiance populaire. Maintenant, à vous de jouer !
Le Parti de Gauche ou le droit mis en scène
Hélène Franco
Gilles Sainati
Co-animateurs de la commission justice et liberté du Parti de Gauche
La justice française va mal. La dérive présidentialiste et autoritaire induite par la Vème République a sur elle un effet délétère.
Tout à la fois systême de valeurs (les Anciens auraient dit vertu) et service public, l’institution judiciaire est doublement attaquée par la politique libérale-autoritaire menée depuis une dizaine d’années en matière économique et sociale, une politique servie avec zèle par une grande partie de la hiérarchie judiciaire.
L'institution judiciaire est frontalement et visiblement attaquée en ce qu'elle subit, comme tous les services publics, les ravages des LOLF et RGPP. Ses moyens déjà cruellement défaillants ont été rabotés jusqu'à faire de la France le 25ème pays de l’Union européenne en ce qui concerne le budget par habitant pour ce ministère.
Mais quelques milliards d'euros supplémentaires dans le budget ne résoudront pas la crise que traverse aujourd'hui l'institution. L'institution judiciaire est également attaquée en ce qu'elle applique des lois, notamment pénales, qui discréditent sa fonction de maintien de la justice sociale. Comme il est évident que la politique actuelle ne permet pas de lutter contre « les causes sociales » de la délinquance en interdisant de mettre en place une politique de prévention qui ne se réduise pas à de la dissuasion pénale, elle demeure inefficace. L'image de la justice fait partie des victimes de cette politique inefficace. Elle apparaît comme – et concrètement elle l'est – un appareil repressif des plus pauvres et protecteur des plus riches.
L’avalanche de lois sécuritaires a donc gravement déséquilibré le fonctionnement de l’institution, la dédiant de plus en plus à une fonction punitive en sacrifiant les fonctions de réinsertion et en privilégiant la réponse carcérale sur toute autre. De ce fait, l’autorité judiciaire est empêchée de mener à bien sa mission constitutionnelle de gardienne de la liberté individuelle (article 66 de la Constitution), de manière indépendante et en garantissant l’égalité de traitement entre chaque citoyen (article 6 de la Déclaration des droits de l'Homme et du Citoyen). Or, comme l’indique l’expérience des révolutions citoyennes actuellement à l’oeuvre en Amérique du Sud, sans redéfinition de la place de l’institution judiciaire - l’outil de la régulation par le droit -, la refondation démocratique est incomplète et suscitera d'inévitables frustrations. Faut-il rappeler que l’inégalité devant la justice était en 1788, lors de la rédaction des cahiers de doléances, le deuxième sujet de mécontentement après l’inégalité devant l’impôt ?
Le Parti de Gauche considère qu’il y a urgence à réformer la justice dans la perspective d’une révolution citoyenne. Cette réforme participe du nouveau cadre institutionnel qui devra naître de l'assemblée constituante que nous réclamons pour le peuple.
Refonder la République implique de refonder la justice qui doit l'animer. Cette justice républicaine passera d'abord par la garantie d'un véritable pouvoir juridictionnel démocratique. La justice républicaine repose ensuite sur la reconquête des libertés saccagées par l'Etat pénal actuel. Elle se réalise enfin par l'égal traitement effectif des citoyens justiciables.
Pas de justice républicaine sans pouvoir démocratique
L'équilibre des pouvoirs et la séparation de leurs prerogatives, est une garantie contre les abus de pouvoir et une condition essentielle de la démocratie.
Or, le système politique français dans son ensemble ne connaît pas véritablement un régime équilibré de séparation des pouvoirs. Il organise, au contraire, la confusion des pouvoirs au profit d'un exécutif omnipotent. D'abord la justice n'est pas reconnue par la Constitution comme un pouvoir autonome. Du coup, l'autorité judiciaire se voit régulièrement contester son indépendance par les gouvernants, alors même qu'elle est en principe constitutionnellement garantie par... le President de la Republique. Mais c'est là toute la perversité du système, puisque le Président de la République est chef de l'exécutif.
Ces dernières années, le fonctionnement de la justice a été fortement déstabilisé par une caporalisation qui n'épargne plus les magistrats du siège, pourtant statutairement indépendants. Ceci s'explique par le fait qu'ils sont de plus en plus soumis aux exigences gestionnaires.
Plusieurs propositions peuvent être suggérées pour assurer un nouvel équilibre des pouvoirs soucieux de l'indépendance de la justice. Il faut agir sur le pouvoir exécutif en faisant régresser ses prérogatives pour desserrer l'emprise sur le système judiciaire. Cette indépendance doit toutefois connaître une contrepartie qui s'analyse en une responsabilité à l'égard de la représentation nationale – le Parlement – et en une implication démocratique plus importante à l'intérieur même de la justice.
Pour faire la révolution citoyenne dans la justice, il s'agit donc tout à la fois de sortir la justice de la tutelle de l'exécutif et d'assurer le lien entre la justice et le peuple français au nom duquel elle rend des décisions.
Voici les propositions concrètes susceptibles de mettre en oeuvre les grands principes d'un fonctionnement républicain de la justice :
L'actuel Conseil supérieur de la magistrature, symbole de la subordination de l'autorité judiciaire au pouvoir exécutif et au pouvoir hiérarchique par sa composition et son fonctionnement, est remplacé par un Conseil supérieur de justice. Celui-ci décide de l’ensemble des nominations des magistrats. Il a compétence pour examiner toutes questions relatives au fonctionnement de la justice : organisation judiciaire, budget de la justice, formation des magistrats. Des inspecteurs des services judiciaires y sont rattachés ainsi que l'actuelle direction des services judiciaires du ministère de la justice. Pour composer le Conseil, des non-magistrats sont désignés par le Parlement selon un mode de scrutin qui assure une représentation pluraliste et des représentants des magistrats sont élus au scrutin proportionnel et direct. Le Conseil supérieur de justice veille à ce que l’application de la loi soit égale pour tous. Il en rend compte chaque année au parlement. Il établit le budget des services judiciaires, qui ne peut être rejeté par le parlement qu’à une majorité qualifiée.
L’indépendance des magistrats du siège est garantie par l’inamovibilité et l’absence de subordination hiérarchique.
Les magistrats du parquet peuvent se voir conférer par la loi des fonctions de coordination de l’action publique. Ils disposent dans ce cas des pouvoirs hiérarchiques nécessaires à l’exercice de cette fonction. Leur indépendance peut résulter soit de la nomination par le Conseil de justice, soit d’un avis conforme du pouvoir législatif .
Le ministère public, unique et indivisible, a la charge du respect de la loi devant les juridictions des ordres administratif, judiciaire et financier.
En ce qui concerne la participation des citoyens à l'oeuvre même de justice, elle doit être favorisée tout en tenant compte de la nécessaire technicité et des compétences requises. Elle s'exerce en matière pénale dans les juridictions de première instance qui sont constituées collégialement, sous la présidence d’un magistrat professionnel, et l’assistance de deux assesseurs citoyens (échevins). Ces assesseurs sont élus pour une durée de quatre ans non renouvelable. Ils sont indemnisés comme les conseillers prud'homaux. Ce mandat n'est pas cumulable avec une autre fonction élective et doit nécessairement s'accompagner d'une formation préalable puis continue. Les juridictions d’appel peuvent comprendre des échevins universitaires.
La magistrature constitue un corps unique, dont le statut prévoit trois cadres d’emploi : magistrature judiciaire, magistrature administrative, magistrature du parquet. Le passage d’un cadre à un autre s’effectue par la voie du détachement. La promotion se fait à l’ancienneté, sous réserve d’une obligation de mobilité et de la prise en compte de spécialisations particulières.
Un établissement public juridictionnel est créé en lieu et place des tribunaux de grande instance. Son conseil d’administration est élu pour trois ans. Il comprend des magistrats, des fonctionnaires de justice, des représentants des professions judiciaires, des élus des collectivités territoriales et de la société civile. Il élit en son sein deux présidents à parité de genre qui remplacent les actuels chefs de juridiction.
Pas de justice républicaine, sans libertés juridiquement protégées
Si l'on écoute bien le discours dominant, « La guerre, c'est le maintien de la paix », « L'exécution sommaire, c'est la justice », « La concurrence libre et non faussée, c'est la vie », « La presse, c'est la vérité », « La répression, c'est la liberté », « La précarité, c'est l'aventure », « Le contrôle, c'est la libre circulation », « La libre circulation des hommes c'est celle des capitaux », « Le droit à l'oubli c'est le fichage »... Notre démocratie meurt de ces manipulations du discours et de la réalité. Et l'on pourrait continuer: « Facebook, c'est l'amitié », « Le nucléaire, c'est la protection de l'environnement », « La liberté, c'est un pacte d'actionnaires », « La vidéo-surveillance, c'est de la protection », « L'égalité, c'est l'égalité des chances » et « Le chômage, c'est de la fraude ». Cette novlangue et les manipulations sémantiques participent d'un projet idéologique clair. L'assaut contre le temps de cerveau disponible est devenu une méthode de gouvernement et un projet de société identique à celui que décrivait Georges Orwell dans son roman 1984 se met en place. Cette simplification lexicale et syntaxique de la langue est destinée à rendre impossible l’expression d'idées subversives et à éviter toute critique de l'Etat et du gouvernement. Dans ces conditions, pas questions de changer la vie. Nous en sommes là.
En matière de justice, le projet du Gouvernement et de certains syndicats droitiers de la police est de faire de la sécurité un principe constitutionnel tordant complètement le sens de la sûreté issue des déclarations des droits de 1789 et 1793. Avec un principe général de sécurité, l'individu n'est plus en situation de revendiquer la sûreté pour lui-même comme un droit contre l'arbitraire de l'Etat, du gouvernement ou de son voisin. Le droit à la sécurité n'est plus un attribut personnel, mais une fonction de l'Etat au nom de laquelle il peut agir au mépris de la liberté individuelle et physique devenue suspecte et fauteuse de troubles. Dans le droit fil de cette évolution, on recense plus de 40 lois sécuritaires depuis 2002 avec une accélération à partir de 2007. La méthode du gouvernement est radicale : il s'agit non seulement avec les médias dominants de déstructurer le sens commun et d'instaurer une police de la pensée mais aussi de marquer dans les chairs un nouvel ordre sécuritaire. C'est la « frénésie sécuritaire » (L. Mucchielli). En France, parmi les grands textes liberticides imitant le USA Patriot Act juste après les attentats de 2001 avec la généralisation des procédures d'exception comme partout dans le monde, on trouve les lois dites « sécurité quotidienne » et « sécurité intérieure » qui pénalisent la mendicité, le racolage passif, les rassemblements dans les halls d'immeuble, notamment, la loi Perben II qui généralise l'utilisation de la notion de bande organisée avec des pouvoirs exorbitants de police en matière d'écoutes et de surveillance du net, de perquisition de nuit ou de sonorisation. Cette tendance se poursuivra avec la loi sur les peines planchers et les LOPPSI. Le résultat d'un tel acharnement est la consolidation d'un Etat pénal revendiqué qui, en rognant sur les libertés individuelles et collectives, s'attaque au coeur du dispositif de la République sociale.
Les travailleurs sociaux vont devoir partager leur secret professionnel avec les policiers, les maires vont être conviés à prononcer des sanctions pénales, le statut des milices privées et vigiles en tous genres est étendu pour se substituer aux effectifs républicains de maintien de l'ordre. Tout dispositif social devient exclusivement un dispositif de contrôles : ANPE, administration communale, éducation nationale dont le contrôle de l'absentéisme scolaire aura pour fonction essentielle de suspendre les allocations familiales. On braque l'instrument pénal sur les plus faibles, les précaires, les jeunes, les étrangers, les fous... Une psychiatrie policée apparaît. Le coeur de ce nouveau projet de société réactionnaire est la loi prévention de la délinquance de 2006. A partir du milieu des années 2000, le déterminisme social devient la règle et le comportementalisme est promu au rang d'un mode de résolution des conflits. Ainsi sortira le rapport de l'INSERM en 2005 qui propose de dépister, dès la grossesse, les signes avant-coureurs de risques de "troubles de conduites" des enfants, définis comme "troubles oppositionnels avec provocation" et autres "atteintes aux droits d’autrui et aux normes sociales". Les futurs délinquants sont des foetus : il faut les prendre en charge sans désemparer... Les divers rapports Benisti vont accompagner le mouvement. Si les jeunes sont à surveiller, les étrangers et les malades psychiatriques ne le sont pas moins. Les uns ne quitteront pas les centres fermés et les centres de rétention administrative, les autres leur camisole chimique. Les peines deviennent des mesures de sûreté sans fin...
A chaque fois les opposants à ces dispositifs dans les différents secteurs penseront que c'est un malentendu, que le pouvoir va reculer... Il n'est est rien car c'est un projet global de société de contrôle qui est à l'oeuvre. Ce projet est activé par un réseau de fichage de la population (stic, fnaeg). Pour la surveiller, on croise les fichiers sociaux et pénaux. Il en résulte dans la population un sentiment de crainte et une culture de soumission face à celui qui domine (l'Etat, le patron,...). Contre ce fichage généralisé, la CNIL ne peut plus grand chose. Elle est tout aussi impuissante – sinon plus – devant l'offensive qui touche Internet sous prétexte de régulation. La LOPPSI II et plus encore le décret du 1er mars 2011 obligent désormais les fournisseurs de services sur Internet à conserver mots de passe, traces d'achats ou commentaires des internautes. La police pourra y avoir accès lors d'enquêtes, ainsi que le fisc ou l'URSSAF et de fait à toutes les informations confidentielles. La correspondance privée n'existe plus. Le forum e-G8 qui s'est tenu fin mai est caractéristique de la méthode : combiner développement du commerce, contrôle et interdiction sous prétexte de lutte contre la pédophilie ou de respect des droits d'auteur. La loi Hadopi l'illustre. La mise en place d'un Schengen virtuel pour le net va définitivement clore la liberté du net dans l'espace européen avec des listes de sites censurés a priori.
Dans ces conditions, revenir sur ces processus mortifères et reconquérir cette liberté personnelle – libertés individuelles et collectives – supposent de faire de ces libertés un axe essentiel du projet de révolution citoyenne.
Le Parti de gauche soumet au débat :
L'abrogation pure et simple des textes portant atteinte aux principes fondamentaux du droit notamment constitutionnels et/ou dégagés par la Cour européenne des droits de l'homme.
Un toilettage législatif pour supprimer toutes les infractions tombées en désuétude mais qui, par leur persistance dans les textes peuvent à tout moment être ravivées.
La dépénalisation d'infractions qui seront avantageusement remplacées par des dispositifs sociaux et/ou médicaux ou bien par l’application de règles de droit civil, social ou administratif : usage de stupéfiants, séjour irrégulier d’étrangers, par exemple.
La suppression des poursuites pénales à l’initiative du seul ministère public ou l'autorisation d'alternatives aux poursuites pour des faits ou des comportements courants de la vie en société (injures, tapage…).
Pour restaurer dans le Code pénal une échelle véritablement progressive des valeurs qui protègent le citoyen et lui restituent sa liberté, il faut procéder à l'inversion des choix actuels en matière de pénalité. Le droit doit servir le citoyen, non l'asservir. Dans cette perspective, il faut aussi lutter et s'affranchir de la loi des marchés financiers et spéculatifs, cela suppose bien évidemment de pénaliser la délinquance financière afin d'assainir la vie des affaires (la corruption, le trafic d’influences) et rétablir un rapport de forces moins favorable à l'oligarchie. C'est pourquoi la question de l'égalité devant la justice est tout aussi cruciale pour la révolution citoyenne.
Pas de justice républicaine sans un égal traitement des justiciables
La Déclaration des droits de l'Homme et du Citoyen de 1789 dispose que « La loi est la même pour tous, soit qu'elle protège, soit qu'elle punisse ». Pour mettre en oeuvre cet article de la Déclaration des droits, il va falloir que le juge fasse preuve d'imagination. Pour cela, il doit s'en donner lui-même les moyens. En 1974, un substitut du procureur de la République à Marseille, Oswald Baudot, avait bien compris le problème en prononçant sa "harangue à des magistrats qui débutent": « On vous a dotés d’un pouvoir médiocre : celui de mettre en prison. On ne vous le donne que parce qu’il est généralement inoffensif. Quand vous infligerez cinq ans de prison au voleur de bicyclette, vous ne dérangerez personne. Evitez d’abuser de ce pouvoir. (…) Il est vrai que vous entrez dans une profession où l’on vous demandera souvent d’avoir du caractère mais où l’on entend seulement par là que vous soyez impitoyables aux misérables. Lâches envers leurs supérieurs, intransigeants envers leurs inférieurs, telle est l’ordinaire conduite des hommes (...). D’ailleurs vous constaterez qu’au rebours des principes qu’elle affiche, la justice applique extensivement les lois répressives et restrictivement les lois libérales. Agissez tout au contraire (...) Qu’on le veuille ou non, vous avez un rôle social à jouer. Vous êtes des assistantes sociales. Vous ne décidez pas que sur le papier. Vous tranchez dans le vif. Ne fermez pas vos coeurs à la souffrance ni vos oreilles aux cris (...). Soyez partiaux. Pour maintenir la balance entre le fort et le faible, le riche et le pauvre, qui ne pèsent pas d’un même poids, il faut que vous la fassiez un peu pencher d’un côté. C’est la tradition capétienne. Examinez toujours où sont le fort et le faible, qui ne se confondent pas nécessairement avec le délinquant et sa victime. Ayez un préjugé favorable pour la femme contre le mari, pour l’enfant contre le père, pour le débiteur contre le créancier, pour l’ouvrier contre le patron, pour l’écrasé contre la compagnie d’assurance de l’écraseur, pour le malade contre la sécurité sociale, pour le voleur contre la police, pour le plaideur contre la justice. »
A voir l'augmentation du nombre de détenus depuis 2002 (53463 personnes au 31 décembre 2002, 64584 au 1er mai 2011, soit une augmentation de 20,8%), il semble que ces recommandations soient oubliées. Surtout, le profil socio-culturel moyen des détenus montre à quel point la répression s'abat d'autant plus durement que les difficultés sociales, scolaires, professionnelles sont lourdes. Aujourd'hui, la justice ajoute bien souvent à la somme des souffrances.
Par le fait, l'oligarchie ne se tient pas éloignée de la justice. Elle s'en sert. Le procureur de Nanterre, dans l'affaire Woerth, est devenu le symbole d'une justice au service des puissants. Son homologue de Paris n'a pas fait mieux en s'empressant de déclarer, avant même l'ouverture du procès de Jacques Chirac, que le parquet requèrerait la relaxe, faisant fi par avance des débats qui pourraient avoir lieu. La justice spécialisée en matière de délinquance économique, financière et environnementale et les enquêtes policières en la matière ont vu leurs moyens considérablement rognés, sur fond d'injonctions présidentielles en faveur de la dépénalisation du droit des affaires (Cf. le discours de Nicolas Sarkozy le 30 août 2007 devant l'université d'été du MEDEF). Faut-il donc s'étonner qu'aux yeux de beaucoup, la justice ne soit pas "la même pour tous" ?
La situation de pénurie budgétaire dans laquelle est tenue l'institution judiciaire aggrave cette inégalité. La fermeture sous Rachida Dati de 200 tribunaux d'instance représentant la justice de proximité et la réduction de l'aide juridictionnelle participent d'une politique foncièrement inégalitaire en matière d'accès à la justice.
Ceci étant dit, voici ce que propose le Parti de Gauche pour permettre un égal traitement des justiciables :
Une évaluation précise par les professionnels de justice mais aussi des sociologues et des géographes, des besoins en matière de justice afin d'envisager de combler les déserts judiciaires créés par les décrets de 2008 sur la carte judiciaire et de créer des juridictions supplémentaires le cas échéant en fonction des besoins des populations et des territoires concernés.
Une revalorisation de l'aide juridictionnelle avec la création d'un service public de la défense au sein duquel des avocats pourraient choisir d'être salariés.
Une loi de programmation budgétaire ambitieuse pour la justice sur toute la législature afin d'engager un plan de rattrappage de la justice française par rapport à ses homologues européennes mais permettant surtout de dégager des priorités politiques à l'inverse de celles qui sont favorisées depuis dix ans : priorité à la désinflation carcérale, à l'accompagnement humain des personnes condamnées, à la réinsertion, priorité à la justice civile de proximité, aux tribunaux d'instance, à la justice prud'homale.
Une redéfinition des missions de la police pour réorienter les priorités budgétaires en faveur de la police judiciaire (avec des fonctionnaires de police détachés auprès des juridictions) et d'une police de proximité à reconstruire.
La création d'un parquet national anti-corruption permettant de donner plus d'efficacité aux enquêtes dans ce domaine.
Pour l’égalité d’accès de tous à la justice !
Daniel RAVEZ, Avocat au Barreau de Paris.
Membre du Conseil National du SAF, Secrétaire de la section SAF de Paris.
J'ai le plaisir de remercier les organisateurs de ce Forum sur la Justice d'avoir invité le SAF, Syndicat des Avocats de France. Pour ceux ou celles qui ne connaîtraient pas le SAF, que plusieurs intervenants ont déjà cité, je préciserai qu'il s'agit d'un syndicat d'avocats engagés, militants des droits de l'homme et des libertés, et plus généralement situés à gauche.
On m'a demandé d'intervenir sur le thème de l'égalité dans cette table ronde sur l'accès à la justice, je préciserai donc que j'ai interprété cela comme l'égalité d'accès pour tous à une justice d'une qualité égale pour tous.
En effet de très nombreux facteurs s'opposent à ce que les petits justiciables individuels soient traités équitablement :
· La redéfinition de la carte judiciaire impulsée par le Garde des Sceaux Rachida DATI, qui supprime de nombreux tribunaux et conseils de prud'hommes a pour effet de compliquer l'accès du justiciable au juge. Force est de constater toutefois que cette difficulté est parfois moins marquée et que les procédures se déroulent parfois avec plus de célérité comme nous l'a montré récemment le cas de Florence WOERTH au Conseil de Prud'Hommes de NANTERRE.
· De plus, la durée des procédures est excessive, notamment en matière de réclamations portant sur les salaires devant les Conseils de Prud'Hommes. Michel TUBIANA l'a évoqué dans son intervention, les SAF a initié à ce sujet une action groupée contre l'Agent Judiciaire du Trésor. Dix-huit avocats militants du SAF ont introduit simultanément soixante-quinze assignations contre l'État pour dysfonctionnement du service public de la justice en raison des délais déraisonnables de traitement des procédures prud'homales, notamment en cas d'intervention du juge départiteur. Cette action est soutenue par les interventions volontaires du SAF, bien sûr, mais également du Syndicat de la Magistrature, des Ordres des Avocats aux Barreaux de PARIS, NANTERRE, BOBIGNY, VERSAILLES et de syndicats de salariés (CGT, UNSA). La durée de la procédure profite exclusivement à l'employeur qui sera finalement condamné à payer les salaires longtemps après qu'ils soient dus (on parle de délais de traitement qui portent sur plusieurs années) ce qui revient à accorder des délais de paiement (donc des crédits quasi-gratuits) aux employeurs au détriment de leurs salariés qui ne touchent en contrepartie que des sommes dérisoires au titre des intérêts légaux de retard, calculés cette année au taux annuel de 0.38%. Les délais excessifs de traitement des affaires prud'homales résultent principalement de l'insuffisance de moyens mis par l'État pour assumer ses fonctions régaliennes mais cette situation ne se limite pas à la justice prud'homale, il suffit pour s'en convaincre de regarder les délais de traitement, notamment, des affaires de divorce.
· Ces inégalités sont encore accrues par les modalités financières des recours, qui pénalisent le petit justiciable, et l'on parle maintenant d'instaurer un droit de saisine de 35EUR, similaire au timbre fiscal de 100 F dont devaient être revêtues avant 2004 les saisines du Tribunal Administratif. Les tarifs des Avoués, dont la suppression a été annoncée pour l'an prochain (après avoir été retardée) et des Avocats au Conseil d'État et à la Cour de Cassation qui sont obligatoires sont autant de freins à l'exercice effective de recours par les justiciables. En matière prud'homale il convient de rappeler que la dispense exceptionnelle de recours à l'entremise d'un Avocat aux Conseils pour former un pourvoi en cassation a été supprimée, prétendument pour assurer l'égalité des droits de la défense (les employeurs recourant systématiquement aux services d'un Avocat aux Conseils contrairement aux salariés) avec la promesse d'assouplir les conditions d'attribution de l'Aide Juridictionnelle en cassation, promesse qui n'a jamais été tenue, avec pour résultat une baisse très significative du nombre des pourvois en cassation (essentiellement de la part des salariés) qui était le véritable objectif recherché.
· Et quand le parcours du combattant pour obtenir la reconnaissance des droits du salarié et une décision de justice exécutoire est enfin terminé, un autre va commencer pour obtenir l'effectivité de la décision. Multiples tentatives de saisie de l'huissier de justice chargé de faire exécuter la décision, puis saisine du Tribunal de Commerce pour obtenir l'ouverture d'une procédure collective à l'encontre du débiteur et la prise en charge de la créance salariale par l'AGS (Assurance de Garantie des Salaires). A cet égard, qui peut croire à une véritable égalité des droits entre employeurs et salariés face à des juges consulaires élus par leurs pairs employeurs et qui ne semblent pas souvent très réceptifs à l'argumentation des salariés créanciers et de leurs syndicats. Malgré de multiples réformes des Tribunaux de Commerce les entreprises et leurs chefs sont toujours prioritaires et il serait urgent de remettre l'économie au service de l'homme alors qu'il faut bien constater que c'est l'approche contraire qui prédomine.
Et même si le salarié parvient à surmonter tous ces obstacles il n'est pas certain d(être intégralement rempli de ses droits, car la garantie de l'AGS, comme toute assurance, est soumise à des plafonds, dont le montant a été scandaleusement réduit de plus de moitié en juillet 2003 en prétextant un déséquilibre financier du régime alors même que l'on constate que le taux d'appel des cotisations pour le financer baisse de façon continue !!!
Ces quelques remarques montrent que la problématique de l'égalité de l'accès au Droit pour les justiciables ne se limite pas à la question, essentielle toutefois, de l'Aide Juridictionnelle que j'aborderai maintenant :
Je ne m'étendrai pas sur les conditions scandaleuses dans lesquelles le Gouvernement n'a pas prévu une juste rémunération des avocats dans le cadre renouvelé de la garde à vue, avec la réinstauration cachée des frais de justice mis à la charge des justiciables (ou plus probablement s'agissant des justiciables les plus démunis de leurs avocats) au travers du traitement des droits de plaidoirie.
Le SAF refuse fermement la logique de l'indemnisation et réclame une rémunération normale pour l'avocat chargé d'une mission de service public. Le système d'indemnisation, avec sa logique d'unité de valeur forfaitaire différenciée selon les types de procédures aboutit à accroître les inégalités entre avocats et à renforcer une justice à deux vitesses. Des avocats sous-payés pour les petits justiciables pauvres et de gros cabinets d'affaires pour les entreprises, se donnant parfois bonne conscience à moindre coût en cas d'application du système du pro-bono. L'accès à la justice est aujourd'hui assuré par des avocats volontaires engagés et par certains qui n'ont pas d'autre choix dans certaines zones géographiques défavorisées que de survivre grâce aux subsides versées par l'État au titre de l'Aide Juridictionnelle. Malgré les promesses et engagements solennels réitérés de réévaluer les montants versés au titre de l'Aide Juridictionnelle force est de constater que les réalisations ne sont pas au rendez-vous et à la hauteur des besoins et des attentes des avocats qui interviennent sur ce secteur et que les avocats ne pourront pas assumer longtemps à eux seuls la croissance de la charge financière de l'accès au droit.
Diverses pistes de réflexion existent, notamment la proposition du Parti de Gauche de la mise en place d'un service public de l'accès au droit mais nous excluons formellement que les avocats intervenant à ce titre le fassent avec le statut de salariés. En effet, le salariat implique un état de subordination qui est contraire au principe fondamental d'indépendance de l'avocat. Or, l'indépendance de l'avocat est essentielle à sa fonction de défense, c'est précisément son indépendance qui permet d'assurer qu'il défendra au mieux les intérêts de son client. Il faut en effet rappeler que la déontologie de l'avocat n'est pas conçue à son profit mais avant tout comme une garantie au profit de ses clients. Accepter que des avocats soient salariés d'un service public de la justice réactiverait au surplus automatiquement le débat sur l'avocat salarié en entreprise, statut refusé par la majorité de la profession mais ardemment souhaité par quelques gros très cabinets au service de grandes entreprises qui souhaiteraient pouvoir bénéficier à leur profit du secret professionnel de l'avocat salarié.
Le système du pro-bono ne constitue pas non plus une solution, dans ce système les gros cabinets acceptent qu'un collaborateur consacre une partie de son temps à défendre des causes défavorisées. On peut douter de l'efficacité réelle de cette approche, notamment en raison de la technicité particulière des matières juridiques concernées dont on peut douter que les praticiens puissent toujours réellement efficacement sauter de la pratique des fusion-acquisitions internationales à la défense des salariés au Conseil de Prud'Hommes où à la défense d'urgence des étrangers menacés d'expulsion du territoire.
A cet égard, et malgré la fiction de l'égalité entre les avocats, il faut avoir le courage et le réalisme d'accepter de reconnaître l'existence d'inégalité de compétence technique, liées principalement à la pratique et donc à l'expérience, non seulement entre avocats mais aussi entre magistrats, et pas seulement s'agissant des magistrats non-professionnels que sont les conseillers prud'homaux ou les assesseurs au Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale.
En conclusion de ces quelques remarques il reste donc fort à faire avant d'espérer atteindre l'idéal d'un accès pour tous à une justice de qualité égale pour chacun, ce qui ne pourra se faire qu'en remettant l'homme au centre des préoccupations de la société et non l'entreprise car, comme l'a démontré en trois mots Mathieu BONDUELLE dans son intervention de ce matin les soi-disant « lois » économiques ne trouvent pas à s'appliquer au Droit : « les agents économiques cherchent à tirer bénéfice de leurs avantages concurrentiels » mais rien ne permet de penser que cette motivation égoïste de recherche de la maximisation du profit financier suffise à assurer le bonheur des populations.
Quels moyens pour le service public de la justice ?
Michel DEMOULE
secrétaire général adjoint du syndicat national C.G.T.
des chancelleries et services judiciaires
“ Révolution citoyenne ?”
Rappelons tout d’abord que la révolution bourgeoise de 1789 avait aboli la vénalité des charges et des offices. La restauration avait rétabli celle-ci dès 1816 et il aura fallu attendre une loi de 1965 pour que les greffes des cours et tribunaux soient fonctionnarisés, dans la décennie 1967/1977. C’est en raison de cette fonctionnarisation des greffes que la justice est devenue “gratuite” à partir de 1978. Or cette gratuité est gravement remise en cause aujourd’hui...
* L.O.L.F. L.O.P.J. puis R.G.P.P.
Régulièrement, il est rappelé qu’il faut donner des moyens supplémentaires à la Justice, qu’il ne doit pas y avoir de nouvelles réformes sans accompagnement par les moyens nécessaires, qu’il faut recentrer les juges sur leurs missions de dire le droit, trancher les litiges... Et tout aussi régulièrement, les moyens sont supprimés,
- la L.O.L.F., loi organique relative aux lois de finances votée en 2001 par l’ensemble des députés (ceux du P.C. s’abstenant), devait permettre au Parlement de contrôler l’ensemble des dépenses de l’Etat, il était question de justification au premier euro...Nous ne pensons pas que les parlementaires aient une vision plus précise de la justification des dépenses du ministère de la justice depuis la mise en place de la L.O.L.F. en janvier 2006. Ce que nous avons constaté, c’est que la L.O.L.F. a servi à justifier les suppressions massives d’emploi dans les greffes, notamment ceux créés par la L.O.P.J., la loi d’orientation et de programmation pour la justice de septembre 2002, sachant que dans les 5 ans d’application théorique de la LOPJ, moins de 40 % des emplois prévus dans les greffes avaient été créés...
- La révision générale des politiques publiques ( R.G.P.P.) a contribué largement à la casse des services publics, et la justice n’y échappe pas. Le logiciel budgétaire Chorus, qui ne fonctionnait déjà pas dans d’autres ministères, a été imposé à la justice en 2011... évidemment, ça ne fonctionne pas mieux, c’est surtout nettement pire puisque là où l’on mettait dix minutes à passer une commande, on peut perdre deux heures à ne pas y arriver, quand le système n’est pas en carafe... La création de plates-formes interrégionales, l’une des mesures de la R.G.P.P., s’effectue sans réelle réflexion sur le fonctionnement des services, les lieux mêmes sièges de ces plates-formes changent au gré des vents (Orléans-Dijon, Strasbourg-Nancy, Amiens-Lille, ...), les compétences d’attribution ne semblent pas plus définies, nous avons l’impression que l’administration centrale a un mur devant elle mais continue de foncer...Un discours langue de bois sur la mutualisation des moyens devant apporter des économies en termes de moyens, d’effectifs, ... tient lieu de credo. En 2007, le programme du candidat Sarkozy, de l’U.M.P., comportait la réforme de la carte judiciaire, véritable “serpent de mer”. Ce programme se résumait, en la matière, à dire : une région = une cour d’appel (ce qui impliquait de supprimer 8 C.A. sur 30 en métropole), un département = un tribunal de grande instance (ce qui impliquait de supprimer 80 T.G.I. sur 175 en métropole). Il n’était pas question des autres juridictions.
Or la “réforme” imposée par Rachida Dati après un simulacre de concertation s’est traduite en réalité par la destruction de la carte judiciaire, avec la suppression de plusieurs centaines de juridictions de proximité, tribunaux d’instance (T.I.) et conseils de prud’hommes (C.P.H.). Elle a abouti à la création de véritables déserts judiciaires, des départements entiers n’ayant plus de juridictions en dehors de la ville préfecture... À l’inverse, il n’a pas été touché aux vingt tribunaux d’instance des arrondissements parisiens...À l’inverse de toutes logiques, Dati a décidé la suppression, avec la complicité des barreaux (le Conseil national des barreaux et pas le S.A.F.), des juridictions de proximité, celles où l’avocat n’était pas obligatoire... dès lors que l’on ne touchait pas aux cours d’appel et que l’on ne supprimait qu’une vingtaine de “petits” T.G.I., donc autant de petits barreaux...Ceci implique de réfléchir sur les juridictions qu’il sera nécessaire de réouvrir ou de créer. Lors d’une rencontre entre l’entente syndicale CGT, CFDT, UNSA et SM et le groupe socialiste à l’Assemblée nationale, Marylise Lebranchu, ancienne garde des sceaux, nous avait demandé si cette réforme était réversible.
La plupart des tribunaux supprimés appartenant aux communes, leur réouverture, lorsqu’elle s’avère justifiée, implique à tout le moins que les communes ne les aient pas vendus. Or plusieurs communes, y compris à gauche, ont d’ores et déjà mis en vente, voire vendu, les bâtiments de leur tribunal, ce qui rend une réouverture ultérieure d’autant plus difficile. Puis Dati a mis en place la commission Guinchard pour, théoriquement, réfléchir sur les contentieux... nous avons boycotté cette commission dont les principales préconisations mises en oeuvre vont à l’encontre du service public via l’externalisation des missions vers le privé et les professions para-judiciaires...
La majorité de l’activité judiciaire est de nature civile or, et le document qui nous a été diffusé en introduction à ce forum n’y échappe pas, dès qu’il est question de justice, on parle essentiellement de l’activité pénale, bien évidemment plus médiatique...Mais ces dernières années, les mauvais coups contre le service public de la justice ont aussi beaucoup touché l’activité civile :
- les P.A.C.S., dont la compétence est maintenant partagée avec les notaires ; cela reste gratuit devant les tribunaux d’instance, c’est payant devant le notaire qui n’y connaît pas grand-chose (entre 150 et 600 euros, car il n’y a pas de tarif), nos listes de discussion sont édifiantes à ce niveau...
- les actes de notoriété, ... gratuits devant le tribunal, payants devant le notaire...
- les appositions de scellés, avec maintenant compétence donnée également aux huissiers...
- les consentements à adoption, ...
Il faut donc une réflexion sur les professions parajuridiques, mais celles-ci constituent des lobbys très puissants ! Pour nous, la suppression de la vénalité des charges et des offices est un vrai sujet.
* suppression des avoués ! La seule “bonne” réforme à l’actif de Rachida Dati, et encore, elle n’est pas encore effective... et nous en subissons des contrecoups sur les emplois, les recrutements, la formation...
* les tribunaux de commerce : il y a eu le livre sur la mafia des tribunaux de commerce, le rapport Montebourg, le rapport des inspections générales des finances et des services judiciaires, tous édifiants ! Il résultait notamment de ce dernier rapport que “les frais de justice prélevés sur les procédures judiciaires assurent aux auxiliaires de justice des revenus très élevés, les montants répartis aux créanciers ne leur permettant de recouvrer qu’une part marginale des créances impayées”.
Élisabeth Guigou avait tenté de réformer, en introduisant a minima un magistrat professionnel dans les procédures collectives, elle a été confrontée à un mur et la réforme a été abandonnée...Et alors qu’il aurait fallu fonctionnariser les greffes des tribunaux de commerce, c’est l’inverse qui a été décidé et mis en place sous Dati avec la suppression de la compétence commerciale des tribunaux qui l’avaient...Quant aux coûts de l’opération, ils sont clairs : les T.G.I. à compétence commerciale récoltaient chaque année pour l’Etat des millions d’euros qui rentrent maintenant dans les caisses du privé... Malgré nos demandes répétées, nous n’avons jamais su ce que les greffes privés avaient payé pour récupérer la compétence qu’avaient les T.G.I. à compétence commerciale, il semble bien qu’il leur en ait été fait cadeau !
* les huissiers : qu’il y ait des huissiers pour vérifier la régularité des jeux concours qui encombrent nos boîtes aux lettre, peut nous chaut ! Mais que l’on confie à ces gens-là l’exécution des décisions de justice pose d’autres questions et nous estimons que cette fonction devrait revenir à des fonctionnaires, entrées dans la compétence des greffiers, qui sont les garants de la procédure...D’autant que les cas d’huissiers ne respectant pas les tarifs sont nombreux ; certains exigent des sommes importantes à titre de provision pour exécuter des décisions prud’homales et de ce fait, des salariés sont contraints de renoncer à les faire exécuter... Si certains s’émeuvent à droite des condamnations pénales non exécutées, il n’y a pas de contrôle sur l’exécution des décisions civiles.
* Quel est le principal point commun entre Nicolas Sarkozy, Dominique Strauss-Kahn et Marine Le Pen ? Mais je pourrais rajouter Lagarde, Borloo, Devedjian, Alliot-Marie, Baroin, et même des plus récents, Dati, Villepin, Mamère...
Les avocats se plaignent du faible montant de l’aide juridique... et j’entends régulièrement parler d’avocats smicards...Encore récemment, à l’occasion di bicentenaire du conseil de prud’hommes de Lille, le bâtonnier expliquait que s’ils travaillaient pour 150 euros de l’heure, il ne leur en restait plus que 60 après déduction des divers frais et cotisations... rappelons que le SMIC est à 9 euros brut... (pour comparaison, cadre A de la Fonction publique avec 30 ans d’ancienneté, je suis payé environ 23 euros de l’heure sur la base de 35 heures donc en réalité beaucoup moins)...Cela fait maintenant plusieurs années que notre syndicat dit : chiche ! On ne veut pas vous faire perdre d’argent, avec les crédits de l’aide juridique (A.J.), on peut créer un corps de plusieurs milliers d’avocats fonctionnaires, payés sur une grille de la catégorie A de la fonction publique.
Nous entendons déjà les avocats (et là, même au S.A.F.) hurler à la nécessaire indépendance et autres arguments réellement de peu de poids : - les magistrats sont des fonctionnaires, qu’ils soient régis par le statut de la magistrature ou par le statut général, et ce n’est pas ce qui nuit à leur indépendance, de nombreux avocats sont salariés de cabinets et n’ont donc pas réellement un statut indépendant de profession libérale... Par ailleurs, il est nécessaire de relever fortement les plafonds permettant l’accès à l’aide juridictionnelle totale, l’aide partielle relevant trop souvent de la fumisterie.
* Avec la réforme de la garde à vue, donc en matière pénale, le gouvernement veut faire payer ceux et celles qui s’adresseront à la justice, uniquement en matière civile, commerciale ou sociale, un forfait de 35 euros ! (*)
Rappelons que la justice est devenue gratuite depuis 1978 avec la fin de la fonctionnarisation des greffes... C’est un énorme retour en arrière !
* Des moyens, quels moyens ?
Il faut bien sûr des effectifs, mais des effectifs réels, pas de ceux qui durent le temps des effets d’annonce puis qui disparaissent, mais des effectifs recrutés sur concours (en dehors des exceptions légales) et bien formés, alors que nous connaissons depuis plusieurs années une politique de casse de la formation, de la remise en cause des statuts. Tous les gouvernements annoncent qu’ils ne feront pas de réforme sans donner des moyens, puis s’empressent de faire le contraire...Il faut bien sûr des moyens budgétaires, encore faut-il les utiliser à bon escient. Or l’utilisation des moyens apparaît souvent incohérente. Notre syndicat avait ainsi adressé une lettre ouverte à la précédente garde des sceaux dénonçant la gabegie au sein du ministère de la justice. Cette lettre ouverte est malheureusement toujours d’actualité.
(*) L’article 54 de la loi n° 2011-900 du 29 juillet 2011 de finances rectificative pour 2011 a créé cette contribution obligatoire pour l’aide juridique, affectée au Conseil national des barreaux. Le décret d’application devrait être soumis à la concertation au mois de septembre 2011 pour mise en place dès le 1er octobre 2011. Si cette mesure scandaleuse était mise en place, il faudrait évidemment qu’un gouvernement démocratique l’abroge au plus vite.
Michel Tubiana
Président d’honneur de la Ligue des droits de l’Homme
Transcription de l’intervention orale réalisée par l’éditeur
Mon intervention se situe dans le contexte où la Ligue intervient, comme partout, pour présenter ses observations, pour interpeller, en tant que membre du monde social l’ensemble des organisations politiques. Sur la justice en particulier, si l’on veut réfléchir, je pense que le premier mot qui vient à l’esprit, c’est le mot « humilité ». Vous savez qu’on prête à Casamayor, grand magistrat, fort indépendant et en lutte face aux tracasseries à l’époque du Général de Gaulle et de son garde des sceaux M. Jean Foyer, cette formule qui veut que « le grand problème de la justice c’est qu’on a donné le nom d’une vertu à une administration ». Je pense que ce n’est pas une mauvaise interpellation. La justice est humaine, profondément humaine. Le fait de justice est donc ancré dans l’imperfection et l’injustice. L’injustice, bien évidemment, quand la justice est mal rendue. Donc, je dirai que la question de l’injustice va de pair, à la fois, avec le fonctionnement de l’injustice mais aussi avec la perception de la justice. C'est-à-dire que pour passer de la vengeance biblique à la justice versus humaine, il faut quand même de singulières vertus et que la critique est d’autant plus aisée que l’exigence de justice est par nature, sans fin, absolument démesurée. Non pas au sens péjoratif du terme mais sans fin parce qu’elle trouve à s’appliquer à tous moment et à tous propos. A cette heure, la réflexion que je vous livre n’est donc pas de créer un système parfait… mais de créer un processus le moins imparfait possible pour rendre cette justice. Alors, si vous le voulez bien, je vous dispenserais de l’état actuel. Je ne pense pas que le colloque ait pour but de faire le mur des lamentations. Et le mur des lamentations en l’espèce pourrait être sans fin entre la caporalisation, les moyens, les interventions, les logiques sécuritaires… Nous connaissons cela tous très bien et je ne crois pas utile d’y revenir. Même la psychiatrie maintenant est caporalisée par le gouvernement. Je relève avec une petite satisfaction ironique, le fait que ce pouvoir politique a quand même réussi un tour de force ; c'est-à-dire de se mettre à dos un corps, je parle des magistrats, qui est tout sauf progressiste, sans vouloir être désagréable avec mes deux voisins… On n’avait pas vu cela depuis… je crois depuis jamais. Mais avant de renter dans le vif du sujet, je voudrai revenir sur quelques questions contextuelles qui me paraissent déterminées la réflexion que nous devons avoir sur la justice. Ces réflexions sont au nombre de quatre. La première c’est que le système judiciaire n’échappe pas aux effets de la globalisation. Ceci concerne aussi bien les normes légales que le système doit appliquer que les moyens et sa capacité à remplir sa fonction. Les systèmes judiciaires (et pas simplement celui de la France) ont montré très vite leurs limites face à un mode globalisé. On peut prendre un exemple très simple, et compte tenu du temps, je ne vais pas en donner beaucoup. Aller rechercher la responsabilité d’une firme multinationale dont les lieux de décision sont totalement délocalisés et sortent de l’emprise nationale de la justice puisque, à l’exception très restreinte de la cour pénale internationale où des juridictions ad’ hoc créés à propos de la Yougoslavie, du Rwanda, de la Bosnie par le conseil de sécurité l’ONU, la justice est encore, bien évidemment, totalement nationale. Ces lieux de pouvoirs sont non seulement délocalisés mais en plus souvent non indentifiables. On peut se poser une deuxième question à ce propos et qui va dans le même sens. Une justice suppose un contrôle démocratique et la création d’une norme. Une justice ne produit pas de normes, elle applique. Elle produit à la rigueur une jurisprudence même dans les pays du Common law mais la norme fondamentale ne dépend pas de l’appareil judiciaire dans le triptyque classique de la séparation des pouvoirs entre exécutif, législatif et judiciaire. Alors se pose la question suivante : où se situe le contrôle démocratique lorsque la norme est déterminée de manière supranationale ? A ce sujet, je précise que je suis pour la Cour Pénale Internationale, pour la Cour Européenne de Strasbourg et la détermination de normes internationales…. Mais observons tout de même que le mécanisme institutionnel est celui de décisions de justice et de normes prises en application d’un traité ce qui pose la question débat du contrôle démocratique. Et quelque part, ces deux éléments à la fois, la délocalisation des lieux de pouvoirs et donc de contrôle et l’absence de contrôle citoyen sur des parties du droit de plus en plus importantes, montrent que la justice n’échappe pas au phénomène de globalisation alors qu’elle est par essence l’attribut régalien d’un Etat-nation.
Le second élément qui fait contexte est l’assimilation de la justice aux mêmes règles que celles du monde économique. Antoine Garapon a beaucoup écrit sur ce sujet. Ce que l’on constate actuellement, c’est que ce qui est mis en place astreint la justice à fonctionner comme une entreprise avec ses règles de management et de procédure dans laquelle l’objectif est la productivité, y compris en termes de concurrence qui devient un mode de fonctionnement à l’intérieur de l’appareil judiciaire. A partir de là, la justice n’est plus évaluée comme un service public chargé de réguler les conflits et d’appliquer la norme sociale mais comme une entreprise qui doit respecter des objectifs quantitatifs déterminés par une idéologie politique et je ne parle pas seulement de la politique du chiffre que vous connaissez.
Le troisième élément de contexte qu’il me semble nécessaire d’avoir à l’esprit, c’est que bien évidemment nous connaissons le « tout sécuritaire », qui idéologiquement ne date pas d’aujourd’hui. En 1885, c’est le ministère Waldeck Rousseau, ministère progressiste de la création des syndicats, du divorce, etc. mais aussi ministère de la relégation avec la création du délit de vagabondage, seul délit de classe, ou des personnes sans domicile fixe ni revenu se voient incriminés pénalement pour leur situation. Ce ministère va instituer la relégation in fine à Cayenne. Il y a un dialogue à l’Assemblée nationale entre Waldeck Rousseau et Georges Clémenceau dans lequel le premier explique que ce sont d’abord les pauvres qui sont victimes de l’insécurité. Clémenceau lui répondra alors : « Vous avez raison monsieur le Premier Ministre, votre loi interdit aux riches et aux pauvres de dormir sous les ponts et de mendier. » Vous voyez que le débat de l’ordre et de la loi, de la protection des classes riches par rapport aux classes dangereuses ne date pas d’aujourd’hui. L’élément nouveau, c’est que notre rapport sociétal au risque en général a évolué vers une plus grande intolérance. Nos sociétés sont devenues des sociétés complexes et aux capacités prodigieuses et en même temps d’une extrême fragilité, parce que cette complexité induit un rapport au risque de plus en plus frileux et nous emmène vers la notion de « risque zéro », de « tolérance zéro », de « délinquance zéro », ce qui est une absurdité…. Le risque a changé de nature, en 1966, un incendie dans la raffinerie de pétrole de Feyzin (Rhône) fait 18 morts… Ce qui se passe au Japon actuellement nous montre que la nature du risque a considérablement évolué.
Au-delà des exploitations politiques sécuritaires, c’est ce désir grandissant de « risque zéro » qui parait tout simplement, à tort, de plus en plus atteignable. Par exemple, qui accepterait aujourd’hui, par rapport à une trentaine d’années en arrière, de mourir sur une table d’opération pour une appendicite alors que c’est un acte chirurgical qui nécessite une prise de risque et une anesthésie ? Personne, bien évidemment. Par conséquent, en découle une recherche accrue de responsabilité et donc de judiciarisation de la vie sociale en général. Petit exemple drôle et dramatique : il y a quelques années à Strasbourg, il y eut une tornade localisée sur quelques ares. Il y avait un concert, un arbre s’est écroulé sur une tente et a tué plusieurs personnes. Une information a été ouverte par le Parquet afin de savoir si la météo aurait pu prévoir une tornade. Preuve encore de cette recherche permanente de la responsabilité et du « risque zéro » que l’on peut élargir socialement à la question de la délinquance ou autre.
Le quatrième élément, extrêmement pesant, c’est qu’à cette recherche de « risque zéro » et de responsabilité à tout prix, correspond l’éruption de la victime dans le jeu judiciaire de manière très forte et quelque peu nouvelle. Jusqu’ici, la justice a été largement méprisante à l’égard des victimes. La césure, c’est Robert Badinter qui met en place, dès 1981, un système d’aide aux victimes qui se perfectionnera dans le futur. Mais là, on est au-delà de l’aide aux victimes parce que, être une victime ce n’est pas un état, c’est une situation, d’où ce débat, que l’on voit fleurir outre-Atlantique, entre la présomption d’innocence de l’agresseur et la présomption de véracité des propos de la victime présumée elle aussi. Le problème c’est que jusqu’à ce jour, le système judiciaire est là pour arrêter la vengeance privée, transférer la vengeance privée vers un exercice public dans l’intérêt de la société, sans mépriser pour autant ce que les personnes subissent et en tenant compte de la volonté de réinsérer et de retisser le lien social avec l’agresseur. Là, ce qu’on est en train de faire par l’intervention des victimes jusqu’au prononcé des peines et au contrôle de l’exécution des peines, c’est la prise en charge de la vengeance privée à l’intérieur du système judiciaire. On voit réapparaître ce système de vengeance privée que l’ont transfère dans le système judiciaire, ce qui est inacceptable. Il ne s’agit pas de mettre la victime de côté comme dans le système anglo-saxon. Sa voix et sa parole doivent être écoutées. En revanche, dès que l’on touche à l’exercice social de cette justice, la victime n’a plus sa place, cette place qu’on lui donne aujourd’hui et qui créée une vengeance privée accueillie par l’institution publique.
A partir de là, je voudrais aborder la question de l’institution elle-même. Il est clair que l’institution a besoin de sécurité juridique et politique : on ne peut exiger que les acteurs du monde judiciaire, les magistrats notamment (et bien d’autres encore) aient à se comporter en héros. Il faut que les magistrats soient dans un cadre qui les autorise à ne pas faire preuve d’héroïsme pour exercer leur métier de manière indépendante et rendre compte éventuellement lorsqu’ils ont commis des fautes. Cela suppose un Conseil Supérieur de la Magistrature autrement composé qu’actuellement. Cela suppose également un cadre démocratique général : nous ne pouvons plus continuer avec des nominations politiques dans les structures qui constituent à l’intérieur de l’Etat des contre-pouvoirs. Avec beaucoup d’habileté manœuvrière et médiatique, Sarkozy a réussi à faire croire à une partie de la population qu’il avait trouvé la solution et qu’il avait fait une ouverture démocratique extraordinaire en permettant aux commissions parlementaires de s’opposer à une nomination au CSA, etc. par une majorité des 3/5ème. La Ligue des Droits de l’Homme demande que les personnes soient positivement désignées à la majorité des 3/5ème par l’Assemblée, ce qui est bien différent. Ce ne sera pas parfait, il restera des marchandages mais cela réduirait les marchandages actuels.
Il y a bien d’autres choses dans la Constitution à revoir pour assurer l’équilibre en soi. Le conseil supérieur de la magistrature doit pouvoir avoir un contrôle financier sur le budget. Ce serait une innovation parce que d’abord on serait le seul pays à exercer un contrôle de cette nature, c’est une question qui mérite d’être posée. En ce qui concerne la composition du CSM, les magistrats y ont évidemment leur place et les personnes non magistrats doivent impérativement ne pas être nommées par le pouvoir politique mais être élues à une majorité renforcée par l’Assemblée. Enfin, il s’agit de garantir l’indépendance de tous les acteurs et notamment du parquet. Le parquet se doit d’appliquer une politique pénale, en revanche il est inadmissible qu’aujourd’hui les parquets aient à répondre d’injonctions politiques et que les nominations dépendent du pouvoir politique.
Deuxième question fondamentale : l’accès à la justice. Je suis scandalisé par l’idée de taxer de 35 euros les gens qui engagent une procédure judiciaire. Lorsque l’on voit déjà l’état de la situation de l’aide juridictionnelle -le peu de gens qu’elle concerne et le peu de rémunérations qu’elle offre aux avocats-, là c’est vraiment la logique de la loi du plus fort, c’est mort aux pauvres ! Cela pose aussi la question de la carte judiciaire, mais aussi et surtout des moyens financiers. L’Etat est amené à payer des amendes car il n’est pas capable de répondre en temps et en heure à sa fonction judiciaire en raison de délais trop longs dans les décisions rendues aux justiciables. On marche sur la tête !
Un mot sur le fait de juger. Qu’est ce que juger ? Quoi juger ? La folie des temps actuels veut que tout soit susceptible d’être incriminé et de passer en jugement. Ce qui conduit à un démembrement de la notion de juger. Je suis totalement opposé, je le redis encore, à la participation des victimes et de leurs représentants comme aujourd’hui dans un certain nombre d’actes de jugement par exemple sur les tribunaux d’application des peines où siègent des organisations de victimes. Aussi surprenant que cela puisse paraître, il me semble que le débat actuel sur le juge d’instruction est un faux débat. Tout le monde dans le monde judiciaire sait que la fonction d’instruction ne marche pas. Elle ne marche pas car elle ne concerne plus que 4 à 7 % des affaires. Elle ne marche pas parce qu’instruire à charge et à décharge est un exercice intellectuel difficile… qui n’est pas évident tous les jours… mais aussi parce que le juge d’instruction est extrêmement tenu par le parquet. En revanche, dans le contexte actuel, la réforme proposée est intolérable puisqu’elle aboutit à passer la totalité du procès pénal sous le coup du parquet, lui-même soumis au pouvoir politique. C’est pour cela que dans ce débat, je suis « pour le juge d’instruction » aujourd’hui, mais cela ne veut pas dire que je le serai demain. Le vrai débat à poser est celui du procès équitable avec une accusation, une défense, un juge. Cela suppose au préalable l’indépendance des acteurs et des moyens d’accès à la justice des citoyens. A partir de là seulement, nous pourrons avoir un débat fructueux.
Enfin, pour terminer, la question de la sanction. Lorsque Robert Badinter met en œuvre la réforme du code pénal, il ne prévoit pas que ce qui va en sortir est un monstre en termes d’inflation des peines. Au-delà de ce constat, il faut se demander si le fonctionnement judiciaire est uniquement celui d’une sanction pénale ou s’il doit être celui de la reconstitution d’un lien social brisé. Si c’est celui de la sanction, on en reste au système de la sanction. Si c’est la reconstruction du lien social, on se demande comment on réintègre une personne qui a rompu le pacte social à un moment donné. Il faut également avoir une réflexion sur la question des normes. Qu’est ce qui est le plus grave : voler une bicyclette ou procéder à des écoutes téléphoniques illégales ? Aujourd’hui, vous pouvez aller en prison pour un vol de bicyclette. Pas pour les écoutes illégales ! Or, nous avons besoin sur ce terrain là d’instituer des normes qui donnent un signifiant social plus radical à un certain nombre de comportements sociaux liés aux évolutions des sciences et techniques et liés à un certain type de délinquance notamment en terme d’environnement, en terme économique et en termes de droits sociaux.
.
Droit des étrangers : pour en finir avec un droit d’exception honteux
Hélène Gacon, avocate
La formulation de ce thème révèle une aspiration à laquelle nous tendons tous. Elle part du postulat que la situation actuelle est honteuse et qu’il convient d’en finir au plus vite. Mais c’est la politique sécuritaire qui règne dans tous les domaines du droit des étrangers et génère une situation honteuse pour les immigrés. Telles sont les tristes caractéristiques de ce droit d’exception.
Multiplication des réformes de plus en plus sécuritaires
Depuis soixante ans, les premiers textes applicables en matière d’immigration ont connu de multiples retouches, décidées à un rythme de plus en plus accéléré et marquées par une logique sécuritaire : c’est désormais une exception d’être admis sur le territoire français, c’en est une d’être autorisé à y séjourner auprès de ses proches et de bénéficier des droits sociaux acquis du fait d’une parfaite insertion sociale. En revanche, c’est devenu la règle d’être maintenu dans une situation de précarité extrême, d’être expulsé du territoire dans des conditions brutales et d’en être banni pour plusieurs années. Les ministres successifs ne cessent de désavouer leurs prédécesseurs. Dès leur entrée en fonction, ils ont pris l’habitude d’entreprendre une réforme, non pas pour corriger les carences qui résultent du système dont ils héritent (par exemple, 26 000 reconduites à la frontière par an pour 300 000 étrangers sans-papiers en France), mais pour renforcer cette course effrénée vers la répression. En Europe, c’est le même constat, même si le processus est plus récent. Les Etats membres n’ont jamais rencontré de difficultés à s’accorder pour élaborer une politique de mise à l’écart. Ils retiennent encore une logique d’exclusion à l’égard des ressortissants communautaires : la libre circulation est organisée, après qu’un cordon de sécurité ait été mis en place pour garantir l’expulsion des indésirables, soit parce qu’ils sont considérés comme une menace pour l’ordre public, soit du fait de la précarité de leur situation matérielle. Les nouveaux adhérents, tels les roumains, sont plus frappés par cette mise à l’écart. Leur intégration est admise au compte-goutte : immédiatement si les Etats n’ont rien à faire pour eux (lorsqu’il s’agit de travailleurs indépendants et ou de personnes disposant de ressources propres) et sans cesse reportée pour ceux qui envisagent d’accéder au marché de l’emploi. Les autres, ceux qui viennent de Libye, de Tunisie ou d’ailleurs, ceux qui fuient un régime qui les persécutent au risque de leur vie ou de celle de leurs proches, c’est à une muraille qu’ils sont confrontés. Derrière elle, un espace inaccessible, largement « armé » d’un dispositif extrêmement dissuasif. Frontex, cette « agence » européenne dotée de moyens sans cesse renforcés est omniprésente pour fabriquer une véritable machine à refouler, grâce à l’intense coopération des polices des Etats membres.
Une situation honteuse pour les étrangers
Les témoignages se multiplient pour révéler les conditions indignes qui sont réservées aux étrangers à tous les stades de leur quête d’insertion en France : dans les consulats, aux frontières, dans les préfectures. L’exception est là encore vérifiée : les pratiques démontrent que le principe est de refuser tout demande à un étranger, qu’il s’agisse d’un visa, de l’entrée sur le territoire ou d’une carte de séjour. Et c’est souvent après des années de procédure qu’ils parviennent à faire valoir des droits dont ils ont été privés parfois pendant plusieurs années, les plaçant dans une situation de précarité extrême.
Les procédures qui leur sont appliquées sont également honteuses. En cas d’interpellation et de procédure d’éloignement, ils se trouvent confrontés à une procédure d’une rare complexité, souvent privés d’information sur leurs droits et expulsés de manière expéditive. S’agissant de droits fondamentaux, tels que la liberté de circuler ou celle de mener une vie familiale harmonieuse, ils doivent en principe bénéficier de garanties contrôlées par le juge. Or, avec les lois successives – et encore tout récemment, avec l’entrée en vigueur aujourd’hui même de la loi Besson -, l’étranger est désormais purement et simplement privé de son juge « protecteur » pendant cinq jours, risquant ainsi d’être victime du zèle de la police, en étant expulsé avant-même de pouvoir s’expliquer auprès de lui. Tout cela conduit bien souvent à des situations criantes et désespérantes, pour des familles éclatées, pour des travailleurs sans-papiers et exploités, qui voient les portes d’un employeur officiel constamment fermées, pour des associations menacées et soupçonnées de délit de solidarité. Ce ne sont donc plus seulement les étrangers qui sont victimes de cette machine répressive honteuse.
Nous avions pour habitude d’évoquer ces zones de non-droit, ces bandes de territoire, abstraitement définies entre le lieu de débarquement du moyen de transport qui les acheminent vers notre territoire et le point de la frontière que la police autorise à franchir. En cas de refus, ils sont refoulés ou sont enfermés en « zone d’attente », le temps, dans la plupart des cas, d’être refoulés... Un lieu interdit à notre regard, dans lequel les violences et les violations sont constantes. Désormais, ces zones sont partout en France. Elles existent du seul fait qu’un étranger soupçonné d’être indésirable sur le territoire doit faire l’objet d’une interpellation et expulsé, souvent dans la plus grande précipitation et au mépris des droits les plus fondamentaux, tels que celui de rejoindre ses proches ou de solliciter la protection qui est pourtant nécessaire après avoir été persécuté pour ses opinions ou son origine.
N’importe où sur le territoire national. C’est la honte qui s’installe partout.
POUR UNE JUDICIARISATION QUI NE SOIT PAS UNE MESURE DE DEFENSE SOCIALE
Jean-Pierre Martin
Avocat ??????????
Le texte de réforme de la loi de 90 relative aux droits et à la protection des personnes hospitalisées en raison de troubles mentaux et à leur conditions d’hospitalisation voté par le Sénat le 17 juin s’inscrit dans la généralisation des politiques sécuritaires à tous les champs de la société, et vient comme une « revanche » de Mai 68 et ses luttes contre l’enfermement. C’est l’ensemble du dispositif psychiatrique qui est soumis au soin contraint, tant par le soin obligatoire en ambulatoire que l’accueil sous contrainte de 72h et la constitution de fichiers d’antécédents sous le contrôle renforcé des préfets et des directeurs d’hôpitaux.
La décision du conseil constitutionnel du 26 novembre 2010, qui instaure la nécessité d’une autorisation par le juge des libertés pour prolonger, au 15ème jour, une mesure d’hospitalisation sous contrainte, a cependant modifié de façon substantielle le projet en introduisant la judiciarisation de la contrainte en psychiatrie.
Cette mesure applique le principe d’un droit fondamental et inaliénable, dans la défense des libertés individuelles : il ne peut y avoir de privation de liberté sans la décision d’un juge judiciaire. Elle transpose partiellement le droit européen à l’exception française où la contrainte de police (Hospitalisation d’office) est décidée administrativement par le préfet, agent de l’Etat. Partiellement, car la question d’une autorisation judiciaire se pose dès le début de la contrainte et dans ses suites, en particulier pour les soins après hospitalisation promus par le projet de loi actuel. Rappelons, également, que les hospitalisations contraintes à la demande d’un tiers familial ou allié (HDT) qui relèvent, en principe, d’une décision seulement médicale entérinée par le directeur de l’établissement, sont également soumises dans le projet à une décision du directeur qui peut se substituer à la décision médicale du psychiatre traitant.
La judiciarisation du soin contraint que nous défendons ne saurait, cependant, devenir une mesure de défense sociale comme elle se pratique en Belgique ou en Allemagne qui repose sur le constat psychiatrique qu’il n’y aura pas de récidive, mode opératoire qui maintient le soin contraint à vie, car aucune science ne peut rendre prévisible le psychisme humain. Nous défendons par contre les pratiques de la loi 180 de 1978 en Italie où le juge est présent dès le début de la mesure, pour une durée de 7 jours, puis prolongée sous son contrôle, à partir des certificats médicaux. Elle met fin au soin contraint « vitam eternam » et au critère non psychiatrique de dangerosité.
Notre REFUS de cette loi essentiellement sécuritaire, en lieu et place d’une loi sanitaire de la psychiatrie, et en l’absence d’un véritable bilan de la loi de 90, est porté par le Collectif Mais c’est un Homme qui rassemble la LDH, les partis de gauche et des organisations de patients, ainsi que par l’ensemble des syndicats de psychiatres d’exercice public. Il rejoint celui de la Commission consultative des Droits de l’Homme, qui dénonce une ATTEINTE AUX LIBERTES, en particulier dans ses articles :
- de mise en place généralisée de la contrainte en ambulatoire, à domicile, ce qui ouvre la contrainte à l’ensemble des troubles du comportement, sociaux et psychologiques, d’un possible soin contraint en psychiatrie. C’est d’ailleurs ce point de la loi qui a concentré les oppositions jusque dans la majorité politique actuelle à l’assemblée nationale et au sénat. Le soin contraint en ambulatoire transforme ce qui fait négociation dans l’accès et la continuité des soins, en particulier à domicile en épreuve de force avec toutes les dérives de traitements médicamenteux injectables. Il aggrave les contextes de dramatisation familiale ou sociale substituant à la recherche de symptômes relationnels la répression de tout trouble du comportement. Il met sous contrainte la vie familiale et sociale et est une atteinte grave dans la durée à l’intégrité du sujet et de son environnement, tant sur le plan corporel, psychique, social, culturel et juridique.
- par le déni d’accueil que suppose la mise en observation de 72h sous contrainte, sans garanties juridiques, qui est de fait une véritable garde à vue psychiatrique, attentatoire aux droits des patients à faire recours (avocat ou personne de confiance), et se défendre.
- par la mise en place d’un fichage des antécédents qui font « dangerosité », notion qui n’est pas un facteur psychiatrique en soi, sous la houlette des directeurs, sans mettre en place une limite dans la durée des données : la loi prévoit, en effet, que le psychiatre traitant doit informer le directeur de l’établissement des antécédents de mesures de contrainte du patient, soit en établissements spécialisés (UMD) ou soit dans des suites judiciaires.
Ce texte dénie sur le fond tous les acquits des thérapies relationnelles et institutionnelles, au profit de la pharmacologie et de la gestion comportementale, plus évaluables car s'éloignant de la complexité humaine du soin psychique. Elle fonde sa justification sur la dangerosité qui n'est pas la question centrale du soin. Le psychiatre voit sa fonction soignante déplacée vers celle d’expert et d’agent de la paix sociale. Il entérine la référence de la contrainte au non consentement et au refus de soin, catégories dont on a vu les effets d’objectivation dans l’application de la loi de 90 avec la quasi généralisation de la contrainte hors des lieux de soins, avec des sorties d’essai interminables, véritable contrôle social et du critère d’ordre public (voir les chiffres en annexe).
Il est depuis quelques jours accompagné par un rapport de l’IGAS qui, dans son soutien au gouvernement, déplace le bilan par une série de caractérisations négatives concernant les malades et les soignants, au nom de normes hygiénistes qui ne sont pas celles du réel social et des pratiques relationnelles qui font le soin psychique, rapport dont il faut attendre la finpour qu’apparaisse « demander l’avis du patient ». A l’opposé nous constatons, qu’il rend parfaitement compte des effets des nouvelles gouvernancesde la loi de restructuration de l’hospitalisation publique (HPST) et de la révision générale des politiques publiques (RGPP) :
- qui font du soin la gestion de lits à rentabiliser, et non le travail prolongé auprès du patient. Chaque activité est ainsi appelée à fonctionner de façon autonome, à flux tendu, ce qui nécessite un tri des patients à chaque niveau d’intervention et une définition des moyens en fonction des files actives et du nombre d’actes de chaque structure. C’est l’ère des soins protocolisés, « rentabilisés » opposée au temps du soin psychique fait de parcours individualisés, de disponibilité, d’agir concertés.
Cette gouvernance d’hôpital-entreprise s’articule avec des pratiques fondées sur une clinique purement symptomatique d’urgence et l’acte médical médicamenteux d’emblée, de « troubles du comportement », la prétention ou l’injonction à une efficience immédiate, dans le déni des dimensions essentielles de la subjectivité et du temps du soin psychique ; par sa violence, elle rend illusoire toute réelle pratique d’accès aux soins et d’écoute des tiers familiaux et sociaux.
Il est ainsi constaté que les restructurations de moyens réduisent le soin à l’enfermement et les traitements médicamenteux d’emblée et forcés, par une gestion des lits et des effectifs en personnel soignant à flux tendu, transformant la présence auprès du patient en gestion administrative protocolaire au détriment du relationnel personnalisé. Ils réduisent également l’accès aux soins à une technicité qui l’éloigne de la proximité par les concentrations de structures sur le territoire. Ce qui les rend d’autant plus pernicieuse est leur résonnance avec le réalisme et la mise en concurrence d’un corps de psychiatres qui tire son pouvoir à être l’intermédiaire de l’Etat via les préfets et à coller au pouvoir de l’administration.
- et la privatisation de pans entiers du service public, par des restructurations gestionnaires fondée sur les économies d’échelle au détriment de l’accès aux soins et de leur continuité. L’arme budgétaire et sa gestion l’emporte ainsi au quotidien sur les nécessités du soin, dans un management d’entreprise fondé sur une rentabilité efficiente, par la création de structures de gestion public-privé (CHT et GCS). Ces nouvelles gouvernances préconisent une gestion et un financement activité par activité, rompent la continuité généraliste du soin et ses temporalités, logique comptable qui clive la continuité des parcours thérapeutiques.
Elle éloigne les équipements de proximité, et substitue aux soignants les travailleurs sociaux dont ce n’est pas la compétence, au détriment d’une véritable articulation en réseau, indispensable à la vie sociale.
L’action alternative et la résistance à ces textes est de montrer et de s’opposer à cette gestion d’entreprise et, dès l’automne, au plan de santé mentale annoncé, qui ne peut être que destructeur de la politique généraliste de secteur, ignorant la nature du soin psychique et les moyens nécessaires à sa réalisation. Nous observons, en effet, que le plan de 2005 a certes permis le financement d’actions des associations de patients et de familles (en particulier les GEM), mais, aussi et surtout, a mis en place des restructurations budgétaires fondées sur la seule urgence symptomatique, la sécurisation des services, et une réduction des lits et des places sans réels projets alternatifs. Son application a donc produit le déplacement du travail social d’accompagnement vers l’associatif et le privé, eux-mêmes soumis à des restrictions budgétaires, hors de la fonction d’intérêt général d’un réel service public.
Cette action alternative s’appuie, en conséquence, sur notre expérience de secteur au sein de la communauté, avec une psychiatrie d’accueil telle qu’elle s’est développée dans les pratiques d’insertion gérées avec les patients ou par les patients, dans la reconnaissance de leurs droits citoyens, et celles des pratiques d’accueil et de crise. Ces dernières sont paradigmatiques d’un travail de soin psychique dans la vie sociale. Elles permettent un accès aux soins 24h sur 24 du tout venant en souffrance psychologique fondé sur la parole du patient et de ses proches dans une dimension multiple de l’approche du symptôme et une négociation qui vise à rechercher un consentement aux soins. L’urgence est alors d’être là dans un lieu d’hospitalité pensé comme une approche institutionnelle du sujet et de protection, y compris pour les patients suivis.
Ce décentrement, en première intention, de l’accès aux soins de la réponse d’hospitalisation, permet de préciser l’intérêt thérapeutique d’une hospitalisation, donc de la limiter à sa stricte nécessité. Il créé une interface entre la demande sociale et l’élaboration soignante avec sa possible reconnaissance comme dispositif par les tiers politiques et sociaux comme intégrateur du soin dans la cité, ce qui est le sens premier d’un secteur psychiatrique généraliste. Dans un tel cadre la contrainte reste exceptionnelle et réduite aux situations qui échappent durablement à toute négociation. C’est bien cet acquit historique qui est attaqué aujourd’hui.
Le soin contraint ne peut se dérouler que comme traitement sanitaire obligatoire dans un lieu hospitalier professionnalisé. C’est sans doute ce qui a amené l’AN à supprimer toute référence au « soin sans consentement », source d’inconstitutionnalité et d’une multiplication des contentieux. La pratique de la contrainte indique qu’elle est rarement thérapeutique et est à l’origine d’un accroissement considérable des refus et des ruptures de soin. Elle transforme par la violence faite au sujet le sens soignant des CMP et met à mal les avancées du travail institutionnel d’accueil et psychothérapique. Au nom de « bonnes pratiques » médico-administratives qui ont déjà largement cours s’instaure le retour aux pratiques d’enferment comme une règle et non l’exception, créant de véritables trappes psychiatriques, avec malheureusement le concours d’un grand nombre de psychiatres contempteurs du soin contraint ambulatoire.
L’expérience clinique montre qu’avec des moyens adéquats et une conception relationnelle du soin fondé sur le relationnel et l’échange intersubjectif, le soin contraint devient une prescription très limitée. Je parle en particulier de l’expérience de centres d’accueil et de crise ouverts 24h sur 24 sur le territoire.
C’est donc bien une autre psychiatrie qui est possible, avec une indépendance professionnelle du psychiatre par rapport aux décisions administratives d’Etat du Préfet. Elle passe par le refus d’une société de « surveillance », d’insécurité, d’inégalités sociales, d’atteinte au service public, et d’une politique répressive généralisée dans tous les champs de cette société contre tous les droits fondamentaux et les libertés individuelles. Cette autre psychiatrie est un aspect fondamental d’une démocratie à construire FACE A CETTE SOCIETE REPRESSIVE DONT NOUS NE VOULONS PAS.
Nous appelons donc après la campagne pour le RETRAIT de cette loi scélérate, dont le seul amendement possible proposé par la CCDDH étant sa réduction aux articles liés à la décision du Conseil Constitutionnel du 26 novembre 2010, décisions dont nous demandons l’élargissement dès le début de la contrainte, son ANNULATION. Nous nous engageons à mener une campagne de résistance et de désobéissance en lien avec tous ceux qui ont combattu cette loi, et tous ceux qui vont en mesurer l’inapplicabilité et ses effets nocifs pour le soin psychique. Cette lutte nécessite la mise en placed’un OBSERVATOIRE des hospitalisations sous contrainte, en lien avec le contrôleur des libertés.
ANNEXE : Chiffres depuis la Loi du 27 Juin 1990
L’application de la loi se traduit par une augmentation de 28,7% entre 1997 et 2003 (chiffres officiels émanant des Commissions départementales hospitalisations psychiatriques : en 1997, 59721, en 2005, 738O9). Ainsi on passe de 9,8% d’internements (PV+HO) en 1985, à 12,25% d’hospitalisation sous contrainte (HDT+HO) en 2005. En 20 ans il y a un accroissement de 150%, selon la statistique d’activité des établissements (SAE), il y aurait eu 77755 entrées dans le cadre d’une hospitalisation sans consentement en établissement psychiatrique
Mesures de contrainte HDT . 43687 en 1995, 60366 en 2005 dont 45% en urgence, en 2009 62185 à la demande d’un tiers(HDT). Les chiffres des hospitalisations à Paris confirment ces tendances : le total des HDT passe de 913 en 1997 à 2327 en 2007.
HDT en urgence Cette médicalisation de l’internement se traduit par l’envol des HDT en urgence (pas d’obligation des 2 certificats instaurée par la loi de 90). Ainsi en 2005, il y a 60366 HDT avec diminution de 6,4% par rapport à 2003, mais avec 27017 en procédure d’urgence soit 44,8% du total (pour 37,4% en 2000.). On constate également une diminution des levées entre 2003 et 2005 : 49243 pour 53133. Durée en 2009 : 36436 sup à 15j, 9183 sup à 3 mois, 1933 sup à 1 an.
Mesures de contrainte HO Pour 2009, , 15570 sous le régime de l’hospitalisation d’office (HO), durée : 11204 sup à 15j, 4754 sup à 3 mois, 1440 sup à 1 an.
Sorties d’essai : Le détournement et l’extension des sorties d’essai font qu’elles se généralisent aux HDT (11186 sorties d’essai en HDT en 1999, pour 46 départements ; 22088 en 2005, 61000 en 2009), et il n’y a plus de sortie directe en HO avec l’extension du pouvoir préfectoral (21702 en HO en 2005, 30000 en 2009
Admissions : nombre croissant de 298000 en 1984, 487000 en 1999, 600000 en 2005, et environ 430000 en 2009),
Nombre de lits : baisse du nombre global des lits d’hospitalisation (82550 en 1984, 71280 en 1997, 58000 en 2006 et moins de 50000 en 2009) liée aux restructurations financières, avec la réduction de la durée de séjour et le développement de structures alternatives à l’hospitalisation
Admissibles
La loi de 90 substitue dans le texte le trouble mental à l’aliénation. Il traite de la situation de dangerosité et non plus du seul acte dangereux qui risque de se perpétuer. Le trouble se naturalise en se médicalisant de façon exclusive : le HDT (art.3212-1 du code de la santé publique) est ce qui rend impossible le consentement, avec des soins immédiats qui s’imposent sous surveillance constante en milieu hospitalier. Le HO est associé à un trouble de l’ordre public et à la sûreté des personnes.(3213-1). La loi introduit la contrainte aux soins plus que la sûreté et l’assistance. La Cour Européenne des Droits de l’Homme, par la convention de 1979 la dénonce comme contraire à une légitimité fondée sur la permanence et la persistance du trouble.
La loi en légalisant les sorties d’essai, sous surveillance médicale, font de celles-ci un suivi médical avec obligation de soin, sous menace de ré internement. C’est un premier pas vers le traitement ambulatoire obligatoire. Il faut noter également que cette contrainte s’applique au médecin.
Ces chiffres sont à resituer dans la demande de soins psychiatriques en France, pour lesquels le Rapport Joly de Juillet 97 estimait à 20% de personnes suivies en psychiatrie, à 15% des prescriptions médicales générales, et à 5% le nombre de personnes hospitalisées au moins 1 fois dans l’année (dont 43% sous contrainte), sur un chiffre de 1,2 millions de consultants en psychiatrie.
Prisons et droits des détenus : pour en finir avec l’une des humiliations de la République ?
Jean-Claude BOUVIER
Magistrat ?????????????
La prison, humiliation de la République : ces termes forts renvoient aux conclusions d’une commission d’enquête diligentée par le Sénat en juin 2000 sur les conditions de détention en France (un rapport est également fait par l’Assemblée Nationale) ; ils traduisent le constat d’une situation dramatique dans les établissements pénitentiaire - les parlementaires faisant notamment état de droits de l’homme bafoués en raison de la surpopulation et de l’application de dispositions exagérément sécuritaires, de maisons d’arrêt enfreignant la règle de l’encellulement individuel et d’un arbitraire carcéral fondé sur l’absence d’une réelle législation.
Le travail effectué par les parlementaires en 2000 fournit une base indispensable pour toute réflexion politique sur une réelle évolution du monde carcéral et doit être utilisé aujourd’hui pour comprendre quels peuvent être les leviers du changement. Les rapports reprennent ainsi une dimension essentielle de l’univers pénitentiaire – exploré en 1999 par la commission relative à « l’amélioration du contrôle extérieur des établissements pénitentiaires» présidée par Monsieur CANIVET : l’existence en France d’un droit pénitentiaire essentiellement constitué par des règles internes à l’administration pénitentiaire et historiquement délaissé par le législateur. Cet état de fait a conduit, selon les termes du professeur martine HERZOG EVANS à « une importance anormale et aberrante de textes issus de l’administration pénitentiaire elle-même, laquelle, abandonnée des décideurs, était ainsi autorisée à élaborer son propre droit ».
Dans ce contexte, la commission Canivet – et à sa suite les rapport des deux chambres parlementaires – recommande l’élaboration d’une loi pénitentiaire permettant de codifier « les missions de l’Administration, les droits des détenus et les conditions générales de détention ».
Il a fallu attendre le 24 novembre 2009 pour qu’une loi pénitentiaire voit enfin le jour - mais la première partie, qui a trait aux dispositions relatives au service pénitentiaire et à la condition de la personne détenue, est peu satisfaisante. En définitive, et en dépit des objectifs affichés, elle reste encore éloignée du cadre de référence des règles pénitentiaires européennes. Ce premier chantier reste toujours en cours.
Mais il n’est pas le seul à mener, tout aussi essentiel soit-il. L’amélioration des conditions de détention est indispensable mais elle ne peut constituer une étape suffisante – tant l’enfermement est générateur d’une désocialisation et d’un isolement préjudiciable à tout individu. Une véritable politique alternative à l’emprisonnement doit être menée afin de limiter le recours à l’incarcération et de mettre fin à sa prééminence. La loi pénitentiaire du 24 novembre 2009, dans sa deuxième partie, a bien étendu les conditions d’octroi des aménagements de peine mais elle ne remet pas en cause une césure à l’oeuvre dans la politique des aménagements de peine : des profils à risque – ou considérés comme tels en raison de leur seule qualité de récidiviste, de la nature des infractions commises et de l’évaluation de leur dangerosité criminologique – se voient restreindre l’accès aux aménagements de peine, le législateur entendant leur réserver prioritairement l’application de mesures de sûreté (surveillance judiciaire, surveillance de sûreté et rétention de sûreté) exécutées aux termes de l’incarcération et reposant essentiellement sur la surveillance, le contrôle ou la neutralisation (aucun projet d’insertion n’est prévu et certains de ses dispositifs sont indéfiniment reconductibles) ; les autres détenus - les délinquants primaires condamnés à des courtes ou moyennes peines, les individus condamnés pour des délits n’encourant pas de peine de suivi socio-judiciaire, les sortants de prison dès lors qu’ils n’ont pas été condamnés à de longues peines – constituent quant à eux le cœur de cible des aménagements de peine et autres dispositifs d’alternative à l’incarcération.
Cette subdivision doit être remise en cause et ce, pour au moins deux raisons. D’une part, elle repose sur des catégorisations discutables – élaborées à partir des nouvelles représentations de la dangerosité et non pas à partir du profil spécifique de chaque individu. D’autre part, dans un contexte social et politique anxiogène où une culture de la peur est entretenue, elle conduit inévitablement à l’inexorable extension des dispositifs de sûreté – ceux-ci ayant alors un effet contaminant. A cet égard, le parcours de la mesure de surveillance judiciaire est édifiant : créée le 12 décembre 2005, elle est originellement réservée auxcondamnés à une peine privative de liberté d’une durée égale ou supérieure à dix ans en raison d’une infraction pour laquelle le suivi socio-judiciaire est encouru ; en 2010, le seuil est abaissé à sept ans ; en 2011, elle est également applicable pour les personnes condamnées à une peine égale ou supérieure à 5 ans, pour un crime ou un délit (de quelque nature qu’il soit) commis une nouvelle fois en état de récidive légale…
La mise en œuvre d’une autre politique d’aménagement de peine, accessible à l’ensemble des personnes détenues et tendue vers l’insertion, ne peut toutefois être envisagée sans la recherche d’une réelle efficacité propre à la crédibiliser. C’est évidemment là une affaire de moyens et de choix : un nécessaire rééquilibrage entre la part budgétaire actuellement consacrée à l’extension du parc pénitentiaire et celle relative au bon fonctionnement des services et des personnels chargés de l’insertion des personnes condamnées devra être opéré. Mais il apparaît également essentiel que le suivi des condamnés en milieu libre puisse être diversifié et adapté à des profils spécifiques de délinquants. Cet objectif passe notamment par la mise en œuvre en détention de processus d’évaluation du risque de passage à l’acte et par une prise en charge sur l’extérieur reposant, le cas échéant, sur des dispositifs rigoureux de contrôle et de surveillance restrictifs de liberté… une réforme de la probation délicate à admettre.
Quelle police pour quels rapports avec la population ?[1]
Ce texte s’appuie sur des résultats d’enquêtes, terminées ou en cours, portant sur les rapports entre les habitants des quartiers populaires et les forces de police. En effet, en 2008, j’ai notamment réalisé une enquête sociologique de deux années sur les confrontations violentes entre la population et les « forces de sécurisation » dans des quartiers dits « sensibles ». Cette enquête était commanditée par l’institut national des hautes études de la sécurité (INHES). Aujourd’hui, je termine pour la haute autorité de lutte contre les discriminations et l’égalité (HALDE) devenue « défenseur des droits », une enquête sur le « discernement policier », dans des terrains également considérés comme « sensibles » par les forces de l’ordre à Paris, à Saint-Denis et à Marseille.
Tout d’abord, il est important de souligner qu’il existe plusieurs types de police dans les quartiers populaires. Sans entrer dans les détails, il existe des polices du renseignement et des polices urbaines. Mais qu’ils soient en civil ou en tenue, ce sont les policiers appartenant à ce dernier type qui, en tant que « policiers de rue », notamment les « patrouilleurs », représentent des « agents de première ligne » et se confrontent, quotidiennement, à la violence des rapports sociaux au sein des grands centres urbains. En effet, comme le souligne Christian Mouhanna (2011 : 49) : « Non seulement le travail du policier patrouilleur est le moins noble dans la classification policière, mais, en plus, il est celui qui comporte le plus d’incertitudes, et donc le plus de risques potentiels. » Dans ce cadre, Jean-Marc Berlière et René Lévy (2011 : 459) soulignent que le sociologue américain, Everett Hugues (1996), a construit la notion de « dirty work », signifiant le « sale boulot », pour décrire les métiers considérés comme pénibles à l’instar de celui que pratiquent les « policiers de rue » : « De leur côté, les policiers amenés à plonger dans les arrière-cuisines de la société, les tréfonds de la perversion humaine, pataugeant en permanence dans la vase des affaires et côtoyant quotidiennement le mal, le crime, le mensonge… n’ignorent rien de l’envers de la tapisserie et sont sans illusion sur une société et une humanité dont ils sont en quelque sorte les égoutiers. En résulte une vision noire, un pessimisme, qui se traduisent dans les rapports qu’ils entretiennent avec la société, le public et les « clients ». »
En outre, notamment depuis les émeutes urbaines spectaculaires de l’automne 2005[2] (Le Goaziou, Mucchielli, 2006), certains de ces policiers ont développé des modes d’intervention se référant « à des styles policiers aux allures militaires » (Ocqueteau, 2010 : 8). En effet, contrairement aux années 1980-2000, au moins depuis l’arrivée de Nicolas Sarkozy au gouvernement en 2002 en tant que ministre de l’intérieur, il semble qu’une « police de guerre » a peu à peu remplacé une « police de paix ». En particulier pour des questions de moyens financiers mais aussi de communication politique de type « sécuritaire »[3], la « police de proximité », c’est-à-dire des îlotiers (souvent à pieds) affectés à des quartiers au sein desquels ils assurent des missions de prévention des désordres incivils mais aussi de renseignement (à part quelques exceptions comme par exemple aux Halles à Paris) a globalement été remplacée par des « forces de sécurisation » et d’intervention qui utilisent des moyens plus dissuasifs et répressifs pour imposer l’ordre public dans la rue.
Néanmoins, suite à l’électrochoc des émeutes de 2005 puis de Villiers-le-Bel[4], (même si le pouvoir exécutif rechigne toujours à reconnaître l’utilité de la « police de proximité » aussi appelée « police communautaire » dans les pays anglo-saxons), à travers la mise en place très médiatisée (en 2008) des unités territoriales de quartier, les UTEQ[5], dans certaines cité (aujourd’hui appelés BST signifiant brigades spéciales de terrain[6]) puis récemment avec l’annonce du ministre de l’intérieur Claude Guéant de la création expérimentale d’unités de « patrouilleurs dans les quartiers[7] », en creux, l’Etat reconnaît que la coupure des « forces de l’ordre » avec leurs implantations territoriales est négative pour le maintien de l’ordre public. Comme l’indique Frédéric Ocqueteau : « Toute perte de confiance de la population envers des policiers non insérés dans un tissu urbain provoque quasi mécaniquement des déficits d’information qui affectent la « performance » des polices. » (Ocqueteau, 2010 : 8)
Pour autant, la mise en œuvre des UTEQ/BST dans certains territoires étudiés (Saint-Denis, Marseille) n’a pas été perçue par la majorité des habitants de ces quartiers comme une « force de régulation » mais comme une « force militaire d’occupation ». En effet, dans un contexte de peur exacerbée de la part de beaucoup de policiers vis-à-vis des « jeunes de cité » considérés comme de potentiels « tueurs de flics » (notamment depuis les tirs d’armes à feu contre les « forces de l’ordre » lors des émeutes de Villiers-le-Bel » en 2007), les UTEQ/BST ont d’abord investi brutalement les cités qu’ils étaient chargés de reconquérir et de reprendre aux « dealers ». En présupposant que tous les habitants des quartiers populaires, qu’ils soient délinquants ou sous leur influence, pouvaient se rebeller violemment contre les « forces de l’ordre », les UTEQ/BST sont entrées dans les cités armées de « Flash-balls » (lanceur de balles de défense à visée laser avec munitions en caoutchouc) de dernière génération (visée laser), de grenades anti-encerclement, de boucliers et de casques lourds. Ainsi, au lieu de favoriser un rapport de « confiance réciproque » avec la population des quartiers populaires, les UTEQ ont alors favorisé un « rapport de défiance », voire de « réification réciproque ».
La production de la « réification réciproque »
Selon les acteurs sociaux (travailleurs et animateurs sociaux, médiateurs…) des quartiers étudiés, lorsque les policiers veulent se présenter comme potentiellement plus violents que les jeunes rebelles qu’ils sont sensés mettre hors d’état de nuire, au lieu d’amoindrir les velléités de jeunes de la cité de se conduire de façon violente, au contraire, les policiers excitent leur volonté d’en découdre et de se mesurer avec les forces de l’ordre. De nombreux acteurs sociaux affirment, en effet, que lorsque la police circule dans le quartier avec des casques, des boucliers et des armes de défense bien visibles comme si la cité était, à tout moment, prête à basculer dans l’émeute urbaine, cette manière de se présenter, contrairement à l’effet dissuasif recherché, est une véritable invitation, notamment auprès des plus jeunes adolescents, à la confrontation et au « caillassage : « Le lendemain de leur visite au collège, les policiers de l’UTEQ sont passés devant la grille de l’établissement. On (équipe éducative) a rigolé parce qu’ils étaient casqués… Je pense que tout le monde a vu les péplums avec les romains… César et ses soldats. Et bien, les policiers longeaient les grilles avec les boucliers levés pour entrer dans la cité. Et bien les gamins, quand ils ont vu ça, ils ont dit : « Ouais, on va les caillasser ! » On a donc bloqué le collège pour que les élèves ne sortent pas mais c’est un appel, c’est une tentation. » (Médiateur scolaire)
Curieusement, les policiers donneraient donc envie à ces jeunes d’entrer dans des rapports de confrontations et de se mesurer avec eux : « La police a essayé de m’expliquer, parce que je travaille beaucoup avec le médiateur de la police, qu’elle a besoin de se montrer et de tester le territoire, de défier le quartier. Mais, moi, je pense que leur mission c’est d’abord d’assurer la sécurité des citoyens sur n’importe quel territoire. On ne peut pas venir dans un quartier et avoir à l’esprit de se dire : il faut que je me montre plus féroce que les féroces avec lesquels je vais avoir affaire. » (Médiateur scolaire)
En outre, des intervenants sociaux affirment qu’il n’est pas rare que des « policiers de rue », notamment des UTEQ, ressemblent beaucoup aux « jeunes de cité » avec lesquels ils se confrontent s’inscrivant ainsi dans une dynamique « ludico-provocatrice » avec les jeunes des quartiers qui favorise la production d’un cercle vicieux en matière de confrontations violentes. Autrement dit, des policiers « immatures » utilisent le même vocabulaire outrancier que certains « jeunes de cité » et privilégient un rapport de force. Un médiateur scolaire de collège, également habitant d’un quartier populaire depuis plus de trente ans, raconte que ces dernières années, il a été plusieurs fois témoin de comportements incorrects de la part des policiers, notamment des violences verbales de la part des forces de l’ordre intervenant dans sa cité pour disperser des regroupements de jeunes. Il décrit également des « défis de regard » dont certains policiers peuvent faire preuve lorsqu’ils rencontrent des jeunes du quartier ce qui, selon lui, n’existait pas auparavant. En effet, les policiers d’aujourd’hui, intervenant dans les cités, sont majoritairement jeunes et auraient la même mentalité de « défi » qui habite les « jeunes de cité » depuis les années 1990, ce qui est propice à provoquer des étincelles. Selon ce médiateur, les policiers et les jeunes participent donc au jeu potentiellement dangereux du « chat et de la souris ». En effet, à l’instar de jeunes rebelles provocateurs, de jeunes policiers se complaisent à entrer dans une relation de « provocation réciproque » : « J’habite dans un quartier populaire depuis 1971. J’ai 50 ans donc j’ai un vécu important dans les quartiers. J’ai connu les PPU, donc les polices de proximité ; j’ai connu l’UTEQ, maintenant, je crois les BST. En fait, j’ai constaté que les effets de groupes, notamment des regroupements de jeunes, sont propices aux confrontations avec la police. Les jeunes et les policiers sont attirés par les effets de groupes. Quand les jeunes voient un groupe de policiers compact, les jeunes sont attirés même s’ils n’ont pas l’intention d’agresser les policiers. Or, je peux témoigner de la violence des paroles des policiers à ce moment-là. Ils ne sont pas du tout courtois. Il y a aussi leur comportement, leur façon de marcher dans le quartier, de croiser des jeunes et à tout prix, les fixer pour faire un défi de regard. Ça, c’est une chose qui n’existait pas, par exemple, avec les policiers des années 70-80. » (Médiateur scolaire)
Ainsi, en règle générale, les acteurs sociaux engagés dans les quartiers populaires décrivent des policiers d’intervention et de sécurisation comme étant bien trop agressifs, grossiers et faisant souvent usage de la force de façon disproportionnée : « L’UTEQ, je ne veux pas les voir, ce sont des cow-boys ! (…) Lors d’une intervention dans le quartier, des policiers de l’UTEQ parlaient aux gamins comme à des chiens : « Fermez-vos gueules ! C’était extraordinaire de vulgarité dans les mots, cela m’a marqué. Dispersez-vous, cassez-vous ! » (Assistante sociale)
Par conséquent, au regard de leurs modes d’intervention musclés, des propos insultants de certains policiers, des acteurs sociaux n’hésitent pas à affirmer qu’ils sont prêts à entrer en confrontation avec les forces de l’ordre lorsqu’ils considèrent qu’ils se conduisent mal : « Quand je vois l’UTEQ, je suis en confrontation avec eux, je leur gueule dessus notamment quand ils pourchassent un gamin et qu’ils escaladent l’enceinte du collège. (…) Ils (les policiers) n’arrivent pas à entendre qu’ils doivent faire attention et respecter les horaires du collège. Quand ils passent la grille à 15h55, ils se retrouvent au milieu de la cours alors qu’il y a 580 gamins. » (Assistante sociale de l’éducation nationale)
D’ailleurs, plusieurs acteurs sociaux rencontrés ont même été personnellement impliqués dans des rapports violents avec les forces de l’ordre. En effet, selon ces intervenants, des policiers font un amalgame entre les délinquants implantés dans les cités et des habitants, voire des professionnels sociaux en relation avec la population des « zones urbaines sensibles », notamment les jeunes dont certains sont effectivement délinquants. Or, cet amalgame entraîne des incompréhensions mutuelles, voire des violences qui génèrent de la frustration, un sentiment d’humiliation, du ressentiment et dans tous les cas, une forte méfiance vis-à-vis des policiers : « Bien que je suis éducateur de prévention dans le quartier, alors que j’étais en scooter, je me suis fait braquer par l’UTEQ parce qu’elle cherchait des jeunes les ayant insultés dans la cité. C’était en plein été et ils (policiers) faisaient peur à tout le monde en les braquant lorsque les gens se penchaient à leur fenêtre. (…) J’ai fait une garde-à-vue suite à une altercation avec l’UTEQ, la semaine dernière, en pleine après-midi vers 16h30, alors que j’étais posé calmement dans mon véhicule. Des policiers ont fait un gros barrage devant tout le monde : « Ne bouge pas ! » Ils (policiers) m’ont sorti du véhicule comme un malpropre alors qu’ils me connaissent, ils savent que je suis éducateur ici mais étaient de mauvaise foi : « Qu’est-ce que vous faites ici alors que vous êtes immatriculé dans le 92 ? » Je discutais calmement avec un jeune du quartier devant la boulangerie et au moment où je suis rentré dans mon véhicule, ils m’ont sauté dessus. Je me suis exprimé calmement en leur disant qu’ils savaient qui j’étais et ils m’ont dit : « C’est comme ça ici, il faut montrer la force, il faut que l’on se fasse respecter ! (…) Je leur ai demandé si le contrôle nécessitait de me maltraiter de façon aussi virulente : « Je ne comprends pas. Je ne vous ai rien fait, j’ai fait ce que vous m’avez demandé de faire, je ne comprends pas pourquoi… » C’est vexant. En tant qu’humain, c’est rabaissant quand même. Peut-être que cela peut être compréhensible quand les gens répondent aux policiers en les insultant mais quand on reste calme… Moi, je suis enseignant, je suis prof de sport de combat, la première des choses, c’est de savoir se contrôler, c’est ce que j’enseigne aux gamins ; ce n’est pas moi qui vais mal me comporter et me mettre à leur (policiers) niveau. » (Educateur de prévention)
De nombreux « jeunes de quartier » confirment les propos des acteurs sociaux et font également le récit d’expériences personnelles dans lesquelles ils ont été victimes de contrôles d’identité musclés suite à des « vexations réciproques ». En effet, ces jeunes, alors qu’ils n’avaient, selon eux, rien à se reprocher d’un point de vue pénal, relatent des histoires vécues où lors de contrôles d’identité, des policiers inutilement agressifs ont, finalement, pour sauver leur face, entraîné les jeunes contrôlés à refuser de se laisser totalement dominer lors du contrôle donnant alors des arguments aux policiers pour faire usage de la force physique à leur encontre. Or, ces confrontations violentes entre des policiers et des jeunes au sein même de leur cité, généralement, génèrent rapidement des attroupements d’autres jeunes et d’une partie de la population, notamment des parents, qui se solidarisent avec les jeunes et invectivent les forces de l’ordre obligeant alors celles-ci à demander du renfort et, en définitive, à se confronter avec une population hostile vis-à-vis de la présence policière. Une telle situation, notamment parce qu’elle produit une très vive émotion, des sentiments d’indignation et de révolte du côté de la population, peut alors vite déboucher sur une situation insurrectionnelle et pré-émeutière propice à la constitution d’un cercle vicieux de la violence : « Quand on a pris des coups de matraque par l’UTEQ lors du contrôle, il y avait du monde dans le quartier. Quand les gens, les parents et les familles ont vu ça, un père de famille est venu et a demandé aux policiers : « Pourquoi vous faites-ça ? Ils sont calmes ces jeunes. Ils ne font rien du tout ; vous les prenez ; vous les contrôlez alors qu’ils ne font rien. » Lui, il s’est alors fait insulter et même taper par un policier de la BAC qui est venue en renfort alors qu’il était handicapé (COTOREP). Après je n’ai pas tout vu car j’étais embarqué dans le camion de la police mais on m’a dit qu’en gros, ça s’est embrouillé dans toute la cité. Des gens sont venus, se sont plains, il y a des darones (mères de famille) qui sont venues pour voir ce qui se passait et pour demander aux policiers : « Pourquoi vous faites ça à mon fils ? Il n’a rien fait ! » Elles ont alors mangé un coup d’extinct, de gazeuse (bombe lacrymogène). » (Jeune de quartier)
Des habitants décrivent, également, des situations où des policiers motorisés se sont mis à la poursuite de jeunes de la cité circulant dans le quartier à moto prenant alors le risque, d’une part, de provoquer un accident mortel chez les jeunes fuyards et d’autre part, de produire des attroupements de jeunes hostiles pouvant se révéler dangereux pour les policiers et la population. Ainsi, si ce type de comportement « ordalique » est doublement condamné par les « habitants – observateurs », c’est parce que dans ces situations tendues, les risques encourus par les policiers pour appréhender des petits délinquants peut entraîner, notamment par crainte, des violences disproportionnées pouvant entraîner la mort d’une personne et/ou déclencher des violences émeutières.
Des jeunes dénoncent également les comportements « racistes » de certains policiers intervenant dans leur quartier qu’ils menacent de représailles s’ils osent les maltraiter : « Aujourd’hui, je me suis embrouillé avec eux (policiers de l’UTEQ). Demain, ils vont me voir tout seul, ils vont descendre (de leur fourgon), ils vont m’embrouiller et faire comme si il ne s’était rien passé. Ca marche comme ça avec eux. La police, ce sont des racistes ! Même les blacks, ce sont des racistes. Ils passent, ils te regardent mal, ils t’insultent et quand tu réponds ils t’embarquent directement. Ils servent juste à nous faire chier. Ils nous martyrisent toujours. (…) Les policiers, là, l’UTEQ, ils se croient au-dessus de nous parce qu’ils ont des armes mais qu’ils enlèvent leurs trucs et cela ne va pas être pareil. Ils se croient toujours au-dessus de nous mais ce sont des êtres humains comme tout le monde. Ils nous prennent pour des chiens. Ils cherchent la merde avec tout le monde les keufs, même avec ceux qui ne font rien. (…) Moi, on ne m’insulte pas. S’ils (policiers) m’insultent, je ne vais pas fermer ma gueule. Ils savent que s’ils m’insultent cela ne va pas se passer normalement. » (Jeune rebelle)
Pour la grande majorité des « jeunes de quartier » rencontrés, en particulier ceux en âge d’aller au collège, les forces de l’ordre, notamment les policiers de l’UTEQ/BST, sont donc avant tout perçus comme des provocateurs, voire des agresseurs et non pas comme des gardiens de la paix au service de leur sécurité et de celles de leurs familles. Pour ces jeunes, il paraît alors normal d’être en confrontation avec la police et inconcevable de tisser des relations humaines avec les représentants de l’ordre : « A la base, ils (les policiers de l’UTEQ/BST) sont là pour parler avec nous mais comme, nous (jeunes de quartier), on ne veut pas parler avec eux, ils cherchent la merde. Mais nous, on ne parle pas avec la police ! C’est interdit de parler avec la police dans le quartier. (…) Si on (jeunes rebelles) voit une dame parler avec la police, on va se dire qu’elle va dire des trucs, ce qui se passe à la cité… Tout se sait dans la cité. (…) On ne peut pas avoir du respect avec la police car eux, ils cherchent qu’à nous envoyer en prison.» (Collégiens)
Dans cette optique, les jeunes indiquent qu’au sein des quartiers et même en dehors de ceux-ci, s’ils ont des ennuis, des vols par exemple, ou des embrouilles comme des violences avec d’autres jeunes, ils ne leur viendraient pas à l’idée de faire appel à la police pour trouver une aide. En effet, ils feront prioritairement appel à une « solidarité de cité » et à leur groupe d’appartenance pour régler leurs différends : « Nous, on se débrouille nous-mêmes, on n’a pas besoin de la police. Ici, dans la cité, tout le monde se connaît. S’il m’arrive quelque chose, il y aura toujours quelqu’un de la cité qui va voir. (…) Même si ma mère elle se fait voler son sac, je ne vais pas voir la police. Moi, les mecs qui volent, je les connais tous et un jour je vais savoir c’est qui et alors là… » (Jeune rebelle)
En fait, lorsque des « figures d’autorité » instituées, des enseignants et des policiers en particulier, se comportent de manière injuste, ont des comportements humiliants à l’encontre d’habitants, aux yeux des « jeunes de quartier », il est alors juste de se révolter pour préserver sa dignité. Chez une partie des jeunes, l’usage disproportionné de la force et de la violence par les forces de l’ordre favorise donc le développement d’une « fonction défouloir ». En effet, la police incarnerait une sorte d’exutoire[8] dans le sens où, en raison du comportement outrancier de certains policiers incités à contrôler, appréhender et soumettre les jeunes plutôt qu’à dialoguer avec eux, de nombreux « jeunes de cité » considèrent qu’il est légitime de s’attaquer aux policiers et aux représentants de l’Etat et des institutions, pour se venger de toutes les épreuves, les injustices et les humiliations qu’ils vivent en tant que représentants d’une « catégorie stigmatique » (Goffman, 1974). D’autant que le sentiment d’ennui des « jeunes de quartier » est propice à l’expression de provocations vis-à-vis des policiers pour « réveiller la cité ». Des acteurs sociaux soulignent que pour certains jeunes, les confrontations violentes avec des policiers représentent, en effet, une échappatoire à leur expérience de la « galère » (Dubet, 1987). Autrement dit, pour ces jeunes, les policiers sont les « boucs émissaires » de leur misère. Pour des jeunes de quartiers ghettoïsés, la confrontation avec la police est donc un moyen d’assouvir leurs pulsions mortifères liées aux « épreuves du ghetto » (Boucher, 2009).
En définitive, les interactions conflictuelles et tendues journalières entre la police et des habitants de quartiers populaires, pouvant inclure de jeunes acteurs sociaux, sont donc propices au développement du ressentiment, voire d’une « haine réciproque ». Dans les quartiers étudiés, la police est en effet plus réactive (problem solving policing) que préventive (community policing) et exprime une grande méfiance contre tous les habitants de la cité, ce qui a des conséquences négatives sur leurs relations. Pour la police, nous avons vu que les « jeunes turbulents » mais aussi leurs parents et les acteurs sociaux, issus des quartiers populaires qui accompagnent des jeunes, sont essentialisés : ils représentent de potentiels complices ou des acteurs directs d’actes criminels. Les habitants des cités ont alors la « forme de l’informe » selon l’expression de Didier Lapeyronnie (2008), celle de pauvres potentiellement incivils, agressifs et violents qu’il faut empêcher de nuire. Comme je l’ai montré dans une enquête ethnographique sur les « internés du ghetto » (2010a), les habitants (en particulier les jeunes) sont en fait confrontés à une routinisation des processus de stigmatisation conduisant à leur réification (Honneth, 2008). Ils sont chosifiés et déshumanisés (suppression de la reconnaissance élémentaire) par certaines forces de police répressives aux yeux desquelles les « cités » apparaissent être un « terrain de guerre ». Leurs habitants courent alors le risque d’être considérés comme des « ennemis de l’intérieur » et traités comme tels, autrement dit, subir toutes les violences. Niés en tant que « sujets » (capacité de construire un rapport de soi à soi et de produire sa propre existence), les « jeunes turbulents » peuvent donc produire à leur tour une « désubjectivation », voire une animalisation de leurs « réificateurs » (policiers). Ces policiers incarnent alors des « anti-sujets » (Wieviorka, 2008). Associés à des « figures » d’injustice, de violence et de racisme, les jeunes refusent alors de considérer leurs adversaires comme des « sujets », réduisant ainsi les policiers à de simples choses contre lesquels il est attendu de pouvoir se venger.
Le monopole de l’usage de la force en question
Pour les acteurs sociaux de front line et les « jeunes de cité » (Marlière, 2008), la production d’un rapport exclusivement autoritaire et provocateur ainsi que la mobilisation quotidienne d’une violence considérée comme disproportionnée sont donc les arguments prioritairement avancés pour expliquer l’exacerbation des mauvaises relations entre les « policiers de rue » et la population des quartiers populaires. Dès lors, si « l’usage de la force » apparaît être au cœur des difficultés relationnelles entre la « jeunesse populaire » et les forces de l’ordre et si l’on souhaite réfléchir à une amélioration substantielle de leurs relations, il paraît alors indispensable d’interroger « la fonction policière » et son rapport à la force ainsi qu’à la violence. Effectivement, au-delà de « l’indétermination irréductible » (Monjardet, 1996) du travail policier, celui-ci est aussi largement associé à la « détention de la force ». Frédéric Ocqueteau (2008 : 270) rappelle, en effet, qu’en travaillant sur le monde policier depuis les années 1980, Dominique Monjardet (1996) avait bien souligné que « les polices sont toujours partie prenante de la « configuration violente » et contribuent à dessiner ses contours. » Dans les sociétés démocratiques, face à la force, la police est en fait dans une contradiction incessante puisqu’elle est « l’instrument de la force dans des sociétés qui se fondent sur la prohibition de la force, elle exprime en permanence la contradiction entre la force et la loi, et le caractère insoluble et permanent de cette contradiction. » (Monjardet, 1996 : 281)
Au-delà de son aspect théorique, nous devons alors nous demander comment « l’habilitation spécifique de l’usage de la force » donnée aux policiers dans les sociétés contemporaines est-elle comprise dans le cas français ? En outre, dans les quartiers populaires, est-il envisageable et à quelles conditions, de mettre en place un type de police limitant l’usage de la force plutôt que son utilisation courante ?
S’appuyant sur le concept wébérien (1963) de « monopole étatique de la violence physique légitime », Egon Bittner (1990 ; 1991), chercheur américain de référence sur la sociologie de la police en tenue, affirme que la police, en effet, se définit avant tout par sa capacité effective à recourir à la force selon les exigences de la situation d’intervention plutôt que par son usage systématique (mécanisme de distribution « virtuelle » de la force coercitive). Les réflexions et analyses proposées par Bittner (2001) sur la définition du rôle de la police dans les sociétés modernes nous amène donc à formuler une question centrale : dans le but de préserver la paix, dans quelles conditions une société démocratique peut-elle institutionnaliser et réguler l'exercice de la force par une organisation spécialisée afin que la violence coercitive dont elle peut faire preuve soit utilisée avec discernement, c'est-à-dire, exercée dans l'intérêt général, uniquement lorsque celle-ci est strictement nécessaire et mobilisée de façon non disproportionnée et injustifiée ?
Or, historiquement, le modèle français de police est caractérisé par trois aspects : sa centralisation sous l’autorité directe du pouvoir exécutif (il s’agit d’une police d’Etat) ; une orientation politique et stratégique dominée par une priorité exclusive accordée à l’«ordre public » dans la plupart des missions de police ; l’institutionnalisation d’une « police politique » spécialisée (la « haute police » de Foucher, ancien ministre de l’intérieur sous Louis Napoléon) pouvant intervenir dans l’observation et l’analyse du champ politique et culturel. Ainsi, au regard d’autres expériences, notamment britanniques et québécoises qui privilégient une approche « communautaire » (Brodeur, 1994) mettant l’accent sur les responsabilités locales de la police par rapport aux besoins de la « communauté » territoriale, l’approche française est taxée de « modèle continental autoritaire » par les promoteurs de la première approche. Cependant, nous avons vu que ce « modèle autoritaire » est difficilement conciliable avec la volonté d’améliorer les rapports entre la police et la population. Contrairement au « modèle communautaire », notamment caractérisé par l’existence d’une « police bienveillante » issue de la société civile dont la mission est de « servir » les citoyens et dont l’un des objectifs est de limiter l’usage de la force coercitive, en France, en règle générale, la police de voie publique s’inscrit dans des modes de relations où elle « commande » aux citoyens. En effet, alors que dans le modèle « communautaire » le soutien de la population envers la police doit permettre la prévention du crime, dans le « modèle autoritaire », c’est toujours la « peur du gendarme » qui doit permettre de prévenir le crime. Une telle perspective implique donc une « méfiance réciproque » structurelle entre la police et la population qui, comme nous l’avons vu, peut conduire à une « haine réciproque » dangereuse dans les quartiers populaires.
Pourtant, sur le terrain, de nombreux policiers de sécurité publique, même s’ils reconnaissent souvent qu’ils ont choisis de devenir policier par goût de l’action et de l’adrénaline que procure certaines interventions de police potentiellement dangereuses dans les « cités », ces policiers soulignent aussi qu’ils se considèrent avant tout comme des « gardiens de la paix » et ne souhaitent donc pas entrer dans des « jeux de provocation » pouvant exister entre des « jeunes de cité » et de « jeunes policiers » : « Personnellement, lorsque j’ai affaire à un individu, si la personne est correcte avec moi je vais également être correcte avec elle et même si elle a un lourd passé, qu’elle a fait de la prison et qu’elle est fichée chez nous (police) plusieurs fois…Du moment qu’un individu est correct avec moi je suis correct avec lui, je ne vais pas m’amuser à le titiller, ce n’est pas mon rôle, je n’ai pas que ça à faire. » (Gardien de la paix)
En fait, pour ces fonctionnaires de police, ce qui importe avant tout c’est de lutter contre la « vraie délinquance » plutôt que de participer à des « jeux de provocation ». Ces policiers ne se considèrent donc pas comme des « redresseurs de tord » dont la tâche serait de neutraliser, quitte à les « provoquer », des groupes d’individus spécifiques, en particulier, les « jeunes de banlieue ». Ils se considèrent plutôt comme des agents de la tranquillité publique au service de tous les citoyens quelles que soient leurs origines sociales et culturelles : « C’est un avis personnel. Je suis là pour servir tout le monde. Que les gens soient noirs, verts, jaunes, bleus, qu’ils soient commerçants, Rmistes, cadres, maçons… je suis là pour servir tout le monde et appréhender la personne qui a commis un délit ou un crime quelque soit sa couleur de peau ou sa religion. » (Gardien de la paix)
En effet, pour ces policiers, au-delà des apparences, des stéréotypes et des représentations « négatives » ou « positives » des individus qui circulent dans la rue, ce qui leur semble essentiel, c’est d’agir de façon professionnelle, c’est-à-dire, de n’utiliser la force coercitive contre un individu « qu’à partir du moment où celui-ci a commis un délit ou n’a pas eu une attitude correcte. » (Gardien de la paix)
Ces policiers affirment alors que la démonstration et l’imposition de la force, dans la plupart des cas où ils entrent en relation avec des jeunes ou des habitants des quartiers populaires, ne sont pas nécessaires, voire attisent les confrontations violentes. Ainsi, ils relatent des récits d’expériences (violences intrafamiliales, conflits de voisinage, regroupements de jeunes…) où ce sont d’abord les compétences dialogiques et de médiation de policiers se considérant avant tout comme des « gardiens de la paix » plutôt que comme des agents du maintien de l’ordre qui ont permis d’apaiser les tensions et de trouver des solutions sans utiliser leur habilitation spécifique à l’usage de la violence qui, dans ces situations, ne nécessitaient pas d’être mobilisée de prime abord. Cependant, ces gardiens de la paix insistent aussi sur le fait que cette conception du travail de policier leur est propre. Ils expriment donc une conception très singulière de l’action policière dans les « zones sensibles » qui n’est pas nécessairement partagée par la majorité de leurs collègues intervenant en tant que policier de sécurité publique.
Dans une optique analogue, même s’ils apparaissent encore marginaux et peu reconnus par l’institution policière, nous avons aussi rencontré des policiers, notamment à Marseille, qui interviennent dans des services de police originaux comme l’unité de prévention urbaine (UPU). En effet, contrairement à l’injonction sécuritaire actuelle, faite à beaucoup de policiers intervenant dans les quartiers populaires, ils assument pleinement une préoccupation sociale et construisent des relations de travail et de confiance avec des acteurs sociaux et des jeunes des cités au sein desquelles ils agissent. Dans la pratique, sans armes ni uniformes, ces policiers ne rechignent pas à travailler avec des intervenants sociaux, bien au contraire, pour contribuer à la prévention sociale des désordres. En ce sens, ils assument aussi pleinement être des « gardiens de la paix » en participant à la cogestion de la sécurité avec des acteurs sociaux, des institutions locales et une partie de la population. En revanche, ces policiers ne confondent pas non plus leur rôle avec celui des travailleurs sociaux puisqu’ils reconnaissent également que lorsqu’ils coopèrent avec les acteurs sociaux et les habitants, ils en profitent aussi pour collecter du renseignement pour les autres services de police, notamment la police judiciaire et pour viser de façon préventive des délinquants connus (les anglo-saxons parlent de intelligence led policing). En fait, en soutenant l’idée qu’il est préférable et plus opérationnel d’entretenir des relations de « respect réciproque » avec les habitants et les acteurs sociaux des quartiers populaires plutôt que de garder une distance avec la population, tous ces policiers s’inscrivent dans une forme de police dite de « résolution de problème » (les policiers sont à l’écoute des difficultés des citoyens et essayent d’y apporter des réponses concrètes). En effet, Christian Mouhanna (2011 : 70) indique que la police de « résolution de problème » inverse le schéma classique de la police française centralisée : « Elle incite le policier à partir des récriminations du public afin de trouver des réponses. D’où des diversités de pratiques et de priorités d’un secteur à l’autre. Ici, le policier fera de la médiation entre les jeunes et les anciens de la maison de retraite lassés de voir les ballons des premiers s’écraser contre la paroi de leur hall. Ailleurs, dans une zone commerciale, son collègue sera au contraire plus répressif. Dans un troisième site, leur homologue préfèrera avant tout toute autre action, rebâtir des liens avec la population locale, ce qui passe par la mise en place d’activités de loisirs pour les jeunes, de réunions de discussions parfois interminables pour expliquer les nouvelles missions de la police, ou bien des simples prises de contact dans la rue. »
Pour autant, même si ces policiers sont convaincus que la « police de résolution » est généralement préférable à la mise en œuvre d’une police de maintien de l’ordre souvent génératrice de tensions et de confrontations, ceux-ci soulignent également que, dans beaucoup de quartiers populaires, l’accroissement de la précarité, voire la « ghettoïsation » de certaines cités rend très difficile la construction de liens avec la population. En effet, dans ces territoires, la violence du processus de ghettoïsation, l’absence de mixité sociale et culturelle, le sentiment d’enfermement dans lesquels sont englués des habitants génèrent chez certains d’entre eux, en particulier des jeunes révoltés vis-à-vis de leurs mauvaises conditions socio-économiques et de leurs expériences de discrimination et de stigmatisation, des réactions et des contre-conduites individuelles et collectives également violentes à l’encontre des acteurs et des institutions paraissant incarner un « ordre injuste ». En effet, l’expérience collective de la pauvreté dans les quartiers ségrégués est propice à la revendication d’une « culture de cité» spécifique ayant ses codes particuliers, notamment l’expression ludique de rapports de violences. Dans cette optique, les confrontations violentes avec la police fait partie de la socialisation juvénile de «jeunes de cité » qui s’inscrivent dans une «culture agonistique» et guerrière ultra viriliste. Dans ces quartiers, l’ethnicisation des rapports sociaux participe aussi à détériorer les liens sociaux entre les habitants et à produire une « culture de cité » où les rapports de force, notamment avec les personnes et les institutions externes au quartier, peuvent être violents. Chez des «jeunes de cité» se percevant comme des victimes du racisme et de discrimination de la part de représentants de la société française «intégrée» majoritaire, notamment incarnée par la police, l’explication «raciale» des rapports sociaux inégaux ouvre alors la porte à la production de contre-conduites et de réactions racistes pensées comme légitimes. Les difficultés d’insertion professionnelle massives que vivent de nombreuses familles engendrent également des stratégies de survie, des trafics illégaux, producteurs de rapports sociaux violents d’abord entre les habitants, mais aussi entre des habitants auto-organisés dans l’illégalité (business de cité) et des acteurs sociaux, en particulier la police, perçus comme des étrangers et des « figures de contre-pouvoirs » illégitimes et dérangeants pour l’organisation spécifique du « quartier ghetto ». En effet, notamment en raison des difficultés financières dans lesquelles ces familles se trouvent, pour participer à la société de consommation, même si elles y sont contraintes, des familles sont impliquées dans les trafics illégaux. Dans ce cadre, beaucoup d’habitants des zones urbaines paupérisées n’ont donc pas intérêt à ce que les rapports entre la police et les habitants s’améliorent dans les quartiers où ils agissent (Venkatesh, 2011). Par ailleurs, le développement de l’emprise du «bizness de cité» engendre la peur des représailles et le refus de dialoguer avec les policiers. Par conséquent, dans ces quartiers ghettoïsés, la population est prise entre deux feux, celui des trafiquants et celui des policiers : les trafiquants imposent leur loi dans la cité tandis que beaucoup de policiers en charge du maintien de l’ordre dans ces territoires assimilent tous les habitants à des délinquants potentiels. En effet, dans mes enquêtes et dans bien d’autres investigations sociologiques sérieuses, des habitants décrivent des situations où étant en situation de détresse nécessitant des secours, la police est apparue peu réactive pour venir en aide à la population. En revanche, la population décrit de nombreux cas dans lesquels des policiers n’ont pas hésité à utiliser la force de façon disproportionnée lors de contrôles d’identité musclés et vexatoires ou lors de courses poursuites ayant entraîné l’interruption de paisibles fêtes de quartier intergénérationnelles et la mise en danger de jeunes enfants, de personnes âgées, malades ou fragiles par l’utilisation des « flash-balls » et des gaz lacrymogènes notamment. Ce traitement policier inéquitable produit alors des sentiments d’indignation et de révolte du côté de la population propice à la constitution de vifs ressentiments contre les forces de l’ordre.
Dans ce contexte, remplacer une police de maintien de l’ordre par un autre type de police moins autoritaire, plus proche de la population et à l’écoute de leurs besoins, au-delà d’une posture théorique et/ou idéologique condamnant une approche strictement sécuritaire des pratiques policières, nécessite donc d’agir parallèlement sur l’environnement social, économique et politique des quartiers populaires les plus défavorisés. En effet, au regard de la radicalisation des interactions sociales au sein de territoires urbains paupérisés, ethnicisés et ségrégués, il faut prendre garde de ne pas développer une vision irénique, voire démagogique de ce que devrait être une police démocratique de proximité (notamment caractérisée par la présence de policiers de quartier à pieds connaissant bien la population) sans prendre en considération la réalité socioéconomique de certains « quartiers ghettos » en France aujourd’hui (Boucher, 2010 ; Lapeyronnie, 2008). Comme l’ont souligné les événements émeutiers de l’été 2011 en Grande-Bretagne qui ont, notamment, révélé la « crise » de la « police communautaire » dans ce pays miné par de fortes disparités économiques et sociales (Joly, 2007), il semble effectivement difficile de favoriser l’établissement de contacts privilégiés et de relations interpersonnelles entre des « policiers de proximité » et la grande majorité de la population vivant dans des territoires ghettoïsés alors qu’il existe des inégalités criantes, en particulier un chômage massif, qui représentent un terreau fertile pour que se développent des rapports de violence, des processus de « méfiance réciproque » et que s’épanouissent de nombreux trafics.
Ainsi, si idéalement la police républicaine démocratique doit être au service des citoyens, la mise en œuvre et la pérennisation de celle-ci parait possible que si l’on parvient à éradiquer les processus socio-économiques et politiques qui, actuellement, transforment certains quartiers populaires en « cités ghettos » au sein desquelles les règles élémentaires de la citoyenneté et de l’« intégration républicaine » (entendue comme un processus devant assurer la cohésion sociale par la participation active de l’ensemble des personnes et des citoyens vivant sur le sol national à la coproduction de la société) sont bafouées. En effet, dans les quartiers populaires, si les policiers doivent travailler avec et pour les citoyens, encore faudrait-il que les habitants de ces territoires se considèrent et soient considérés, d’abord comme des citoyens à part entière et non comme des « ferments de désordres » potentiels à contrôler et réprimer. Par conséquent, comme nous y invitent Robert Castel (2003) ainsi que des spécialistes de la police comme Maurice Chalom (1998 : 34) cité par Pierre Favre (1999 : 753-754), dans les quartiers populaires et plus largement sur l’ensemble du territoire national, avant de combattre le « sentiment d’insécurité », souvent confondu avec le « sentiment de vulnérabilité », en faisant des démonstrations de force, orchestrées médiatiquement, soulignant que la police donne une priorité à la lutte contre le crime, ne vaudrait-il pas mieux s’attacher à lutter pratiquement contre la vulnérabilité sociale et économique ? : « La vulnérabilité qu’éprouve la population est en fait indépendante de la criminalité proprement dite. Entre insécurité et criminalité (…) c’est la première qui, à terme, produit la deuxième et non l’inverse. »
N’est-ce pas, en effet, même si cette idée est décriée depuis plusieurs années par les tenants d’une posture « libérale-sécuritaire » considérant que la production des incivilités et de la délinquance doit d’abord être associée aux responsabilités individuelles des personnes, le développement de la vulnérabilité particulièrement forte dans les quartiers populaires qui participe à la fragmentation sociale et à l’accroissement du crime entraînant alors la production d’un rapport dichotomique entre la police et de nombreux habitants de ces territoires en difficulté ?
En fait, dans un contexte de ghettoïsation d’une partie des quartiers populaires, au-delà du débat crucial entre « police de quartier » (de proximité, communautaire ou de territoire) et « police de maintien de l’ordre », n’est-ce pas la nature même de la police française définie durant la révolution française qui est de nouveau posée ? En effet, en travaillant sur l’histoire de la police en France, Jean-Marc Berlière et René Lévy (2011 : 16) soulignent que les acteurs de la révolution française avaient voulu résoudre la contradiction entre police et liberté en affirmant que la police française devait être une « police citoyenne » au service des droits de l’Homme. Ainsi, dès la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen du 26 août 1789, les principes essentiels (de la police) sont établis et affirment que la « force publique » est instituée pour garantir la liberté, la sûreté, la propriété, la résistance à l’oppression, les droits de l’Homme et « l’avantage de tous et non pour l’utilité particulière de ceux auxquels elle est confiée. » Citant le rapport sur la police générale du 15 avril 1794, Jean-Marc Berlière et René Lévy (2011 : 16) indiquent également que, s’appuyant sur ce raisonnement, les Conventionnels et Saint Just ont fait l’éloge de la « bonne police » en l’opposant à la « mauvaise » : « Il n’est point de gouvernement qui puisse maintenir les droits des citoyens sans une police sévère ; mais la différence d’un régime libre à un régime tyrannique, est que dans le premier, la police est exercée sur la minorité, opposée au bien général, et sur les abus ou négligences de l’autorité, au lieu que dans le second, la police de l’Etat s’exerce contre les malheureux livrés à l’injustice et à l’impunité du pouvoir. »
Or, il est étonnant de constater que cet éclairage historique est toujours d’une criante actualité. La définition de la « mauvaise » police décrite par les conventionnels fait tout à fait échos aux récriminations exprimées par de nombreux acteurs des quartiers populaires enquêtés, en particulier les jeunes, les intervenants sociaux et même quelques policiers. En effet, au regard de leur expérience dans leur quartier mais aussi de leur sensation qu’il existe un traitement inégal entre la « délinquance ordinaire » et les « illégalismes des puissants » (Godefroy, Mucchielli, 2010), autrement dit, les fraudes, la corruption et la délinquance d’affaires, les habitants des cités populaires rencontrés semblent questionner la « fonction policière » aujourd’hui. Nous pourrions ainsi résumer leurs interrogations à propos de la police en formulant cette question : la police de sécurité publique n’est-elle pas devenue, notamment sous l’influence de l’« injonction sécuritaire » de la dernière décennie (Mouhanna, 2011), de la régression sociale associée à la désindustrialisation (Boucher, 2004) et à l’expansion de la mondialisation ainsi qu’à des choix économiques « ultralibéraux », une profession principalement mobilisée pour servir les intérêts particuliers de ceux qui détiennent le pouvoir plutôt qu’un service public de la sécurité et de la paix sociale contribuant à l’intérêt général ?
*
* *
Pour passer d’une « police de guerre » à une « police de paix », il est donc important de changer plusieurs éléments structurels de la police française actuelle. En premier lieu, il s’agit de changer la « culture policière » en favorisant l’idée qu’il est plus valorisant de garantir la tranquillité et la paix sociale plutôt que de soumettre les citoyens. Le développement de cette perspective pourrait alors contribuer à changer cette bizarrerie française qui fait que la « police de maintien de l’ordre » est la règle alors que la « police de proximité » est l’exception dans les quartiers populaires. Autrement dit, il s’agit de repenser la maîtrise de « l’habilitation spécifique à l’usage de la force » accordée aux policiers. En effet, la transformation de l’approche agonistique historique de la police française associée à un « modèle autoritaire » en une autre approche moins guerrière et plus en phase avec les besoins de sécurité des citoyens nécessite, non seulement de penser mais aussi de faire reconnaître et accepter chez l’ensemble gardiens de la paix que les formes de contrôle et d’encadrement « interne » mais également « externes » des modes d’interventions policiers est fondamentale dans une société démocratique. Un Etat démocratique et responsable, malgré les réticences corporatistes de certains représentants des forces de l’ordre tenant mordicus aux dispositions « militaires » de leur corps, doit s’organiser pour penser l’usage et la régulation de la violence policière pouvant être exercée au nom des citoyens afin de garantir la tranquillité publique, la paix sociale et la démocratie. Ainsi, pour réussir à établir une relation de « confiance réciproque » entre la majorité de la population et la police de voie publique, il s’agit de promouvoir des types de contrôle des modes d’intervention policiers adaptés au « style » de police souhaité par le pouvoir politique qui, dans une société démocratique, est l’émanation de la souveraineté populaire, et la société civile. Dans une optique démocratique, la relation police, public, politique, constitue donc le mécanisme fondamental de la légitimation de l’action policière. Dans cette perspective, c’est donc bien le contrôle du risque de l’arbitraire policier qui est en jeu : il s’agit d’articuler l’efficacité en matière de respect de l’ordre public avec la protection de la liberté et des droits des citoyens. Dans la pratique, pour réussir cette articulation, comme nous y invite Jean-Louis Loubet del Bayle (1992), en particulier pour limiter la production de « violences illégitimes », il s’agit alors de combiner des formes de « contrôle interne » institutionnalisés (centres de formation initiale et continue, supérieurs hiérarchiques, organes internes spécialisés d’inspection)et informels (autodiscipline, intériorisation des normes implicites et/ou explicites régulant l’activité policière, contrôle interpersonnel par les groupes de pairs (ex : jugements des collègues, syndicats, associations, amicales))avec des modes de « contrôle externe » institutionnalisés (contrôle politique (ex : institutions parlementaires), institutions judiciaires (ex : juridictions de jugement, juges, procureurs), organes administratifs non gouvernementaux indépendants, contrôles sociétaux (ex : Ombudsman)) et informels (contrôles sociétaux (ex : comités de citoyens, groupes de pression de professionnels, associations de défense des droits de l’Homme, médias)) de l’usage de la force policière. En effet, au-delà des consignes formulées par la direction et l’administration policière soulignant l’importance de mesurer l’usage de la force lors des interventions de police, la connaissance des processus d’« inversion hiérarchique »[9] mais aussi des formes de disjonction importantes entre le pouvoir formel et l’autorité réelle (Monjardet, 1996 : 73-74 ; Ericson, 1982) au sein de la police (paradoxalement, lors de nos observations au sein de plusieurs écoles de police, nous avons constaté que de nombreux jeunes fonctionnaires rechignent à reconnaître d’autres « figures d’autorité » que celles de la police), il paraît important de renforcer les types de contrôle « interne » et « externe » des activités policières en intervenant sur deux niveaux : celui de la formation et de celui de l’intervention.
Dans la pratique, durant leur formation, en plus de réfléchir sur le passé quelquefois douloureux (période de l’occupation et de la guerre d’Algérie notamment) de la police, les jeunes policiers doivent pouvoir questionner et être questionnés à propos de ce que représente « l’habilitation spécifique à l’usage de la force », bien au-delà de la crainte transmise par les formateurs sur les conséquences administratives et judiciaires au cas où ils utiliseraient leur arme à feu alors qu’ils ne sont pas dans une situation de légitime défense. Dès le début de leur formation, il s’agit donc de faire comprendre aux apprentis policiers qu’au cours de leur carrière, ils entretiendront un rapport intime à la violence mais qu’ils devront contrôler leur usage de la force[10] et en rendre compte devant l’administration, les représentants de la société civile, voire la justice.
En intervention, les officiers et la hiérarchie intermédiaire doivent aussi se montrer « exemplaires » (socialisation « modèlisante »), autrement dit, bien sûr ne pas faire un usage personnel disproportionné de la force mais aussi et surtout, ne pas couvrir des « violences illégitimes » commises par des policiers étant sous leurs ordres, même lorsqu’elles peuvent paraître anodines. En effet, les historiens de la police (Berlière, Lévy, 2011 : 211) soulignent que lorsque l’institution policière est tolérante vis-à-vis des « bavures » et que les policiers se sentent couverts, alors, l’institution libère les violences policières. Or, les travaux de Cédric Moreau de Bellaing (2009) ont montré que les services internes de l’inspection générale des services (IGS) et de l’inspection générale de la police nationale (IGPN) qui ont la charge d’effectuer un contrôle sur les activités et pratiques de la police française ne sanctionnent que très rarement les faits de violences illégitimes contrairement aux faits de corruption. En effet, Moreau de Bellaing montre, notamment, que dans les faits de violences policières incriminées, à part dans des cas de violences disproportionnées caractérisées et médiatisées, pour la justice, les policiers bénéficient d’une « présomption d’innocence » et d’un « surcroît de crédibilité ».
En second lieu, il faut changer le logiciel d’évaluation de l’activité policière : passer d’une « culture du chiffre » à une « culture du discernement » (adapter les procédures policières au contexte de la situation pour éviter un usage disproportionné de la force) au sein de laquelle les policiers pourront plus facilement se considérer comme des acteurs de la régulation démocratique des rapports sociaux (ce qui inclus la lutte contre les discriminations ethno-raciales) au lieu de se penser, presque exclusivement, comme des agents de la répression au service d’un Etat beaucoup plus « sécuritaire » que « solidaire ». En effet, dans la pratique, nous avons vu que le retour de l’« incertitude de l’existence » (Hatzfeld, 1989), autrement dit, de décomposition des modes de régulation socioéconomique mais aussi d’accroissement des injustices, des violences et des inégalités sociales produites par les logiques « hyper capitalistes » (Reich, 2008) contemporaines entraînent le durcissement des « logiques policières guerrières » révélant ainsi le triomphe de l’«Etat de police » sur l’« Etat de droit » solidaire (Delmas-Marty, 2010). Dans ce cadre, Jean Hugues Matelly et Christian Mouhanna (2007) ont ainsi bien montré que le moyen privilégié par le système hiérarchisé et centralisé de la police française pour évaluer l’activité policière réside encore beaucoup sur des statistiques mesurant principalement les pratiques répressives et judiciaires des policiers (taux de criminalité, taux d’élucidation, nombre de personnes interpellées…). Ce mode d’évaluation statistique des activités de police favorise alors un type de management se concentrant sur des objectifs chiffrés pouvant se révéler en complet décalage avec les spécificités des terrains au sein desquels interviennent les gardiens de la paix. Par ailleurs, l’évaluation strictement statistique des activités de police empêche de prendre en compte des éléments qualitatifs fondamentaux, en particulier les interventions policières concourant à la régulation et à la pacification des relations sociales dans un territoire (prises de contacts avec la population, actions de secours, participation à des réunions partenariales, organisation d’activités de loisirs et de médiation…). Dans ce contexte, Christian Mouhanna (2011 : 17) affirme alors qu’à côté du recueil des chiffres de l’activité policière traditionnelle, il devrait exister un autre moyen pour évaluer la performance policière en l’associant à la situation réelle des relations entre la police et les citoyens : « Plus concrètement, la satisfaction du public en termes de service rendu par les policiers dans les secteurs où l’on a le plus besoin d’eux apparaît comme un type d’indicateur très intéressant, d’autant que l’on peut montrer que l’amélioration de cette satisfaction du public va souvent de pair avec une amélioration du moral des policiers locaux, ou du moins de ceux qui s’investissent dans une relation intense avec les habitants de leur secteur. »
Pour autant, il faut prendre garde de ne pas diaboliser tous les policiers. En effet, contrairement à beaucoup d’idées reçues, mes enquêtes montrent que la majorité des policiers critiquent et, en raison des restrictions budgétaires touchant les services publics, subissent la « régression sociale » (Généreux, 2010). En fait, les policiers vivent une « injonction paradoxale » :
- les représentants de l’« Etat libéral sécuritaire » leur enjoignent de réprimer les phénomènes de violences individuelles et collectives en expansion ;
- or, au sein même des « gardiens de la paix », beaucoup d’entre eux ont conscience que ces phénomènes de violences sont d’abord liés au chômage, à la multiplication des inégalités, au délitement et à la marchandisation des formes de protection sociale mais aussi au développement de « logiques guerrières » et aux provocations formulées par des représentants de l’Etat (racailles). Les policiers sont alors entraînés dans le « cercle vicieux » de la violence.
Bibliographie
BERLIERE J-M., LEVY R., (2011), Histoire des polices en France. De l’ancien régime à nos jours, Paris, Nouveau monde.
BITTNER E., (1990), Aspects of Police Work, Boston, Northeastern University Press, 1990.
BITTNER E., (1991), « De la faculté d’user de la force comme fondement du rôle de la police », in Les Cahiers de la sécurité intérieure, 3, p. 221-235.
BITTNER E., (2001), « Florence Nightingale à la poursuite de Willie Sutton. Regard théorique sur la police », in Déviance et Société, vol. 25, n° 3, p. 285-305.
BOUCHER M., (2004), Repolitiser l’insécurité. Sociographie d’une ville ouvrière en recomposition, Paris, L’Harmattan.
BOUCHER M., (2009), « L’expérience du Ghetto » in Déviance et Société, vol. 33, n° 2, p. 221-248.
BOUCHER M., (2010), Les internés du ghetto. Ethnographie des confrontations violentes dans une cité impopulaire, Paris, L’Harmattan, coll. Recherche et transformation sociale.
BRODEUR J.-P., (1994), « Police et coercition » in Revue française de sociologie, XXXV, n°3, p. 457-485.
BRODEUR J.-P., (2003), Les visages de la police : pratiques et perceptions, Montréal (Québec), Les Presses de l’Université de Montréal.
BRODEUR J.-P., MULONE M., OCQUETEAU F., SAGANT V., (2009), Brève analyse comparée internationale des violences urbaines, Rapport d’analyse comparée sur les violences urbaines pour le SPVM, Centre international pour la prévention de la criminalité (www.crime-prevention-intl.org), Montréal (Canada), 47 p.
CASTEL R., (2003), L’insécurité sociale. Qu’est-ce qu’être protégé ?, Paris, Seuil.
CHALOM M., (1998), Le policier et le citoyen. Pour une police de proximité, Préface de Jean-Paul BRODEUR, Montréal, Liber.
DELMAS-MARTY M., (2010), Libertés et sûreté dans un monde dangereux, Paris, Seuil, coll. « La Couleur des idées ».
ERICSON R.V., (1982), Reproducing order : a study of police patrol work, Toronto, University of Toronto Press.
FAVRE, P., (1999), « Autour de la sociologie de la force publique de Dominique Monjardet. Quelques livres et articles récents de sociologie de la police en langue française » in Revue française de sociologie, XL – 4, p. 753-764.
GENEREUX J., (2010) La grande régression sociale, Paris, Seuil.
GODEFROY T., MUCHIELLI L., (novembre 2011) « Délinquance économique : l’impunité s’accroît en France » in Le Monde du 13 novembre 2010.
GOFFMAN E., (1974), Les rites d’interaction, Paris, Minuit.
HATZFELD H., (1989), Du paupérisme à la sécurité sociale, Nancy, Presse Universitaire de Nancy.
HONNETH A., (juillet 2008), « Réification, connaissance, reconnaissance : quelques malentendus » in Esprit, n° 346, p. 96-107.
HUGUES E., (1996), Le regard sociologique, essais choisis. Textes rassemblés et présentés par Jean-Michel CHAPOULIE, Paris, EHESS.
JOBARD F., (2002) Bavures policières ? La force publique et ses usages, Paris, La Découverte.
JOLY D., (2007), Emeutes. Ce que la Grande-Bretagne peut nous apprendre sur la France, Denoël.
LAPEYRONNIE D., (2008), Le ghetto urbain, Paris, Robert Laffont.
LE GOAZIOU V., MUCCHIELLI L., (sous la dir.), (2006), Quand les banlieues brûlent… Retour sur les émeutes de novembre 2005, Paris, La Découverte/coll. Sur le vif.
LOUBET DEL BAYLE J.L., (1992), La police. Approche socio-politique, Paris, Montchrestien.
MARLIERE E., (2008), La France nous a lâchés ! Le sentiment d’injustice chez les jeunes des cités, Paris, Fayard.
MATELLY J-H., MOUHANNA C., (2007), Police : des chiffres et des doutes, Paris, Michalon.
MOREAU DE BELLAING C., (2006), La police dans l’Etat de droit. Les dispositifs de formation initiale et de contrôle interne de la police nationale dans la France contemporaine, thèse de science politique, IEP de Paris.
MOREAU DE BELLAING C., (2009), « Violences illégitimes et publicité de l’action policière » in Politix, vol. 22, n°87, p. 119-141.
MONJARDET D., (1996), Ce que fait la police, sociologie de la force publique, Paris, La Découverte.
MONJARDET D., (2001), « Vivre le métier de policier » in Informations Sociales, n°92, p. 24-31.
MOUHANNA C., (2011), La police contre les citoyens ?, Nîmes, Champ social.
OCQUETEAU F., (2008), « L’influence des travaux de Dominique Monjardet sur une nouvelle génération de chercheurs » in MONJARDET D., Notes inédites sur les choses policières (1999-2006) suivi de "Le sociologue, la politique et la police", sous la direction de CHAUVENET A., OCQUETEAU F., Paris, La Découverte, coll. "Textes à l’appui / Sociologie", p. 269-280
OCQUETEAU F., (2010), Polices et politiques de sécurité - Concilier efficacité et respect des libertés, Problèmes politiques et sociaux, n° 972, Paris, La documentation française.
REICH R., (2008), Supercapitalisme, Paris, Vuibert.
VENKATESH S., (2011), Dans la peau d’un chef de gang, Paris, Ecole des loisirs.
WEBER M., (1963), Le savant et le politique, Paris, Plon.
WIEVIORKA M., (2008), Neuf leçons de sociologie, Paris, Robert Laffont
Droit et écologie dans la campagne de 2012…
Paul Ariès
Politologue
Directeur du sarkophage, journal d’analyse politique
La question posée est simple : comment utiliser le droit pour faire avancer la cause écologique. Il est important tout d’abord de différencier deux usages possibles du droit. 1) Tout d’abord, le procès civil ou pénal intenté aux fauteurs de dommages écologiques : on assiste depuis trente ans à une multiplication de ce type d’affaires en France et à l’étranger. Ce droit de l’environnement reste d’ailleurs principalement jurisprudentiel et civil. Ces procès ont cependant trois limites : ils reposent souvent sur une inégalité considérable de moyens (notamment en raison des coûts des expertises) entre fauteurs et victimes des dommages ; ensuite le risque écologique est très difficilement prouvable au regard des normes juridiques : comment satisfaire, par exemple, à la règle des trois unités (unité de temps, de lieu, d’action) pour des dommages comme le trou dans la couche d’ozone, l’érosion de la biodiversité, etc ; enfin ce premier type de procès fonctionne largement dans le cadre du droit existant, il part donc de ses présupposés c'est-à-dire de la hiérarchie actuelle des normes juridiques. Exemple : le droit des publicitaires à afficher prime celui des citoyens à être protégés de toute agression. 2) Les procès issus de la désobéissance civile ont pour objectif de faire avancer le droit en retournant l’accusation, il ne s’agit donc pas d’un retour à l’illégalisme du XIXe siècle, mais de l’interpellation de la justice via l’opinion publique grâce à la mobilisation citoyenne. Les actes délictueux sont revendiqués et ne sont donc pas commis dans l’ignorance ou le mépris de la loi, mais au nom justement d’une conception jugée supérieure du droit, c’est-à-dire, le plus souvent au nom d’une autre hiérarchie des normes juridiques et des valeurs morales. C’est ce que j’ai pu argumenter chaque fois que je fus cité comme « témoin », par exemple, lors du procès pour le démontage du McDonalds de Millau ou lors de ceux intentés contre les déboulonneurs anti-pub de Montpellier ou contre les faucheurs volontaires d’OGM. Ces procès sont recherchés afin d’interpeller l’opinion, bref pour organiser un retour au politique. Ils sont donc proches de ceux intentés dans le cadre des « tribunaux d’opinion ». Le premier fut le tribunal Russel de 1966 pour juger des crimes de l’armée américaine au Vietnam. Le plus célèbre est cependant le Tribunal Permanent des peuples, fondé à Bologne en 1979, par le théoricien/sénateur socialiste Lélio Basso. J’ai lancé, en 2012, avec René Balme, le Maire de Grigny (Rhône), au lendemain de la nouvelle catastrophe nucléaire Japonaise, l’idée d’organiser un nouveau tribunal Russel pour juger des crimes du nucléaire civil. Le but est toujours le même : dénoncer sous une forme juridique, et pas seulement moral ou politique, des actes jugés répréhensibles : il s’agit certes de sentences sans effets juridiques immédiats mais dont le but est de mettre le droit en scène au nom d’une certaine efficacité du discours juridique (concepts et mécanismes) entendus comme médiation nécessaire du politique. Ce type de coup peut être parfois mal porté : ainsi lorsque vingt lauréats du prix Nobel intentent, sous l’égide de l’ONU, un procès à l’Humanité pour dégradation de l’environnement…On peut se demander en effet si c’est l’Humanité qui est globalement responsable, ou plus exactement si cette mise en avant d’une responsabilité anthropique indifférenciée ne sert pas à masquer la responsabilité des pays riches, c'est-à-dire in fine du capitalisme productiviste. La Banque mondiale estime que les pays pauvres supporteront 80 % des effets négatifs du réchauffement climatique alors qu’ils ne sont à l’origine que de 24 % des émissions des GES Les émissions de GES des Etats membres du G8 n’ont globalement pas cessé d’augmenter entre 1990 et 2004 (+ 28 % au Canada, + 16 % aux Etats-Unis, + 6,5 % au Japon, - 0,6 % en Europe grâce à une délocalisation des industries les plus émettrices de GES…Seule la Russie a réduit massivement ses émissions (- 32 %) mais en raison de l’effondrement de l’URSS. Les notions et les mécanismes juridiques ne sont jamais neutres politiquement (socialement), c’est pourquoi, il y a une véritable lutte au couteau entre plusieurs conceptions juridiques…Or, les gauches françaises sous-estiment trop les enjeux dans ce domaine et apparaissent en retard par rapport aux propositions de certains pays du Sud en matière notamment de justice écologique. Un premier conflit oppose ceux qui veulent laisser à l’ONU (notamment à sa Commission) la responsabilité de conduire la lutte contre les dérèglements climatiques et ceux qui entendent la confier aux grandes institutions du capitalisme financier international comme le G8 ou le G20. L’ONU, parce qu’elle est une organisation plus démocratique, entend mieux certaines revendications des pays pauvres même si son idéologie reste foncièrement capitaliste. Ainsi dès son traité fondateur, la Convention Cadre des Nations Unies sur le Changement Climatique (CCNUCC), en charge depuis le Sommet de la Terre de Rio de 1992 des négociations sur le climat, admet l’idée d’une « responsabilité commune mais différenciée » c'est-à-dire que reconnaissant la responsabilité historique des pays industrialisés, principaux pollueurs et émetteurs de gaz à effets de serre, elle considère que les efforts en matière de lutte contre le dérèglement climatique doivent reposer principalement sur les pays riches. C’est pourquoi le premier cycle de négociations de la CCNUCC, conclu en 1997 par la signature du protocole de Kyoto, fixait des normes contraignantes pour ces seuls pays et ceci seulement jusqu’en 2012, dans l’espoir que les Etats-Unis et le Canada ratifieraient d’ici là (le protocole de Kyoto ne fut en fait appliqué que depuis 2005 c'est-à-dire lorsque 55 Etats représentant globalement 55 % des émissions mondiales de GES l’ont ratifié). Les négociations post-Kyoto n’ont cependant pas tournées au bénéfice de la CCNUCC. L’échec du sommet de Copenhague (décembre 2009) et le faux-accord de Cancun (décembre 2010) ont permis aux adversaires de l’institution onusienne d’avancer leurs pions. Le Président Sarkozy a ainsi justifié cet échec par la lourdeur des mécanismes onusiens et expliqué ce qu’il considérait être le meilleur système de gouvernance mondiale : « à terme, le système auquel je rêve (…) c’est un système très simple où nous aurions le FMI en charge de la stabilité financière, monétaire et de la lutte contre les déséquilibres, une organisation mondiale de l’environnement en charge de l’application des règles environnementales, une organisation agricole qui ne soit pas divisée en multiples organisations, une organisation mondiale du commerce et un ordre mondial qui se mettra en place par la biais de la question préjudicielle qui organisera les rapports entre ces entités internationales. » (Conférence de presse du 24 janvier 2011). Ce choix de sacrifier les mécanismes collectifs contraignants au bénéfice d’engagements unilatéraux ne constitue pas uniquement un changement procédural mais une modification de paradigme en matière de lutte contre les dérèglements climatiques. C’est l’idée même d’une « responsabilité partagée mais différenciée » qui est ainsi remise en cause. Les pays pauvres, regroupés au sein de G77, l’ont bien compris, c’est pourquoi ils ont dénoncé ce sabotage de l’ONU (sic) tout en rappelant que les grands émetteurs de GES ne seront pas les premiers à subir les conséquences négatives du réchauffement alors que les pays les moins industrialisés, dont les émissions sont marginales, seront les premiers à les subir avec la montée des eaux, la perte de la biodiversité, les sécheresses, la famine, etc. Depuis Copenhague, les Etats-Unis ont choisi d’imposer de façon plus brutale leur vision, en faisant pression sur les Etats pauvres pour qu’ils votent en leur faveur et en sanctionnant ceux qui votent contre (ainsi la Bolivie et l’Equateur ont perdu une part conséquente de leur aide au développement pour avoir conduit à Kyoto le combat contre les positions étasuniennes). Aussi, un nouveau texte très proche de celui refusé à Kyoto a été imposé à Cancun puis officiellement adopté, malgré l’opposition de la Bolivie, c‘est à dire en violation du principe juridique de l’unanimité qui présidait jusqu’alors aux décisions dans ce domaine. Conséquence : chaque Etat est désormais libre de choisir l’année de référence pour calculer ses engagements en matière de réduction de GES, et ceux qui ne retiendraient pas 1990, comme année de référence, échappent au caractère contraignant de leurs engagements. Il ne s’agit cependant pas seulement d’un jeu de dupes ni même de l’adoption du mécanisme des engagements unilatéraux mais d’un véritable changement de l’esprit même de la lutte contre le dérèglement climatique avec la remise en cause du principe de la responsabilité différenciée, c'est-à-dire l’oubli du passé donc du passif des pays riches. Cette solution est inacceptable puisqu’elle efface la responsabilité particulière des pays du Nord. La justice écologique ne peut pas davantage se réduire à la seule notion de justice climatique, car il y a beaucoup d’autres problèmes que celui du seul réchauffement climatique comme l’érosion de la biodiversité, comme la crise de l’accès à l’eau potable et celle de l’alimentation, etc. L’objectif désormais est de rentabiliser les actions dites « propres » en permettant aux firmes d’obtenir des certificats d’émissions négociables (« droits à polluer ») en échange des projets d’investissement « écologiques » réalisés dans des pays pauvres ou émergents (Chine). Ce mécanisme aboutit à privilégier les projets les plus rentables financièrement et participe à la création d’un véritable marché carbone avec ses bulles financières et ses spéculateurs. Il produit aussi des effets négatifs comme on le voit avec le dispositif de lutte contre la déforestation (REDD) qui aboutit à remplacer les forets primaires par des plantations industrielles d’essence à croissance rapide contribuant ainsi à la destruction des écosystèmes. Les acteurs du nucléaire et certains pays comme la France et les Etats-Unis souhaitent d’ailleurs faire reconnaître le nucléaire comme une industrie « propre » donnant droit à des certificats d’émissions ; les fabricants d’OGM font également pression pour faire reconnaître les « semis directs » (sans labour) comme des MDP (mécanismes de développement propre), ce qui ferait officiellement des OGM des instruments de lutte écologiques et spéculatifs.
Les gauches françaises ne seront à la hauteur de ces enjeux juridico-politiques que si elles portent à la fois cette critique et si elles participent à l’élaboration de véritables alternatives. Les conditions d’une autre politique ont été développées notamment par les organisations et mouvements sociaux regroupés au sein de la coalition CJN ! (Climate Justice Now ! ). Elles comprennent une série de propositions comme la reconnaissance de la dette climatique via des transferts financiers ou de technologies des pays industrialisés vers les pays du sud ; l’abandon des politiques extractives (pétrole, charbon, gaz, uranium, gaz de schistes) et néo-extractivistes (monoproductions notamment agricoles) ; le rejet des mécanismes de marché au profit de taxes sur les émissions et de mécanismes de soutien à l’agriculture de proximité. « L’Accord des peuples », issu de la Première Conférence mondiale des peuples sur le changement climatique et les droits de la Terre Mère organisé à Cochabamba en Bolivie, fédère également une série de propositions : l’exigence que l’ensemble des pays membres de la CCNUCC s’engage sur des objectifs de réduction de leurs émissions de GES sur la base naturellement du principe de la « responsabilité commune mais différenciée », la reconnaissance de la dette écologique des pays industrialisés avec la mise en place d’un fonds d’adaptation au profit des pays pauvres et l’accueil et intégration des réfugiés climatiques. « L’Accord des peuples » demande également que soit adoptée une Déclaration universelle des droits de la Terre Mère comme charte additionnelle à celle des Nations-Unies, il recommande la mise en place d’un Tribunal international pour la justice climatique et environnementale, doté de pouvoirs de sanction permettant de juger les Etats et les industries coupables de pollution. Il prône enfin l’organisation d’un référendum mondial sur la question du changement climatique, par le biais duquel les citoyens de la planète seraient invités à se prononcer sur les principales propositions de l’accord de Cochabamba
Les gauches françaises pourraient d’ici 2012 faire campagne notamment sur deux thèmes.
1) Celui de la justice écologique (conception plus large que la seule justice climatique). Cette éco-justice doit être entendue de deux façons. Tout d’abord elle concerne les relations Nord/Sud avec la reconnaissance de notre dette écologique envers les pays les plus pauvres. Ensuite elle concerne les relations entre les riches et les pauvres de chacun de ces pays. Il s’agit donc avec la justice climatique de prôner une option préférentielle pour les pauvres qui renoue d’ailleurs avec l’histoire même de cette notion apparue initialement aux Etats-Unis, au milieu des années 1980 dans le cadre de la lutte contre les inégalités sociales/raciales. La notion de justice écologique est le résultat de nombreuses études réalisées afin d’établir un lien entre la composition éthno-raciale des populations et la proximité des sites dangereux : un rapport de 1987 précise que les trois cinquième des noirs et des hispaniques vivent dans des communautés où se trouvent des sites de déchets non surveillées ; un second rapport de 1992 établit si la couleur de la peau est effectivement le meilleur indicateur de localisations des déchets toxiques, elle explique aussi les différences de traitements mis en œuvre : la pollution dans les quartiers pauvres est toujours considérée comme moins grave ; les sanctions prises sont plus rares et plus faibles et les actions entreprises pour nettoyer les sites moins fortes. Cette notion de justice écologique est donc essentielle en France aussi pour montrer le caractère de classe de l’origine des dommages et de leurs conséquences mais aussi pour inventer des alternatives qui ne pénalisent pas les plus pauvres au nom de l’écologie. Je rêve d’une campagne électorale où l’on ferait l’inventaire des inégalités sociales en matière de qualité de vie, face à la localisation des déchets toxiques et des industries dangereuses. Je rêve d’une campagne qui ne se bornerait pas à dénoncer cette situation immorale mais qui avancerait des mesures concrètes comme la gratuité du bon usage pour réparer ces préjudices de classe.
2) Celui de non-extraction. L’un de ses emblèmes de ce combat est le projet équatorien ITT/Yasuni c'est-à-dire le renoncement à exploiter 850 millions de barils (pétrole situé dans un parc naturel), en échange d’une contribution internationale couvrant 50 % de la manne financière qui aurait été possible. La gauche doit s’engager en faveur de ce projet, mais elle doit aussi affirmer que cette politique de non-extraction nous concerne aussi, puisque la meilleure façon d’être fidèle au projet Yasuni c’est de faire mille projets Yasuni, c'est-à-dire de laisser dans notre sous-sol les ressources rares ou dangereuses comme les gaz de schistes. Ce combat anti-extractiviste n’a de sens que si nous affirmons qu’il ne s’agit surtout pas de remplacer le pétrole par une autre énergie afin de continuer à vivre de la même manière. Ce combat est donc inséparable d’un nouveau modèle de société fondé sur le « buen vivir » (le bien vivre), par opposition au « bien être occidental » entendu comme la société capitaliste. Je rêve d’une campagne où l’on apprendrait à conjuguer le « Bien vivre », la « vie bonne », les « jours heureux » avec le principe de non-extraction des ressources les plus dangereuses. Je rêve d’une campagne où le « bien vivre », la « vie bonne », les « jours heureux » viendrait s’opposer à la notion de « juste-adaptation », ce nouveau maître mot gouvernemental qui vise à adapter la planète aux besoins du toujours plus, aux besoins du productivisme, au moment même où le pouvoir fera adopter le premier plan national français d’adaptation.
Réformer la justice ? Non, la refonder
François Delapierre
Secrétaire national du Parti de Gauche
Le sentiment dominant que je retiendrai de cette journée, c’est que la justice n’est pas une institution à amender ou réformer mais qu’il faut la refonder totalement. Nous sommes dans ce moment particulier où des ordres qui tenaient de l’évidence vacillent. Des formules qui avaient hier un sens indiscuté apparaissent soudain vides ou absurdes. Il en va ainsi de la formule rebattue « j’ai confiance en la justice de mon pays ». Si quelqu’un la prononçait de nouveau dans ce moment, une majorité de nos concitoyens penserait qu’elle est folle ou en train de mentir. Bien sûr cette formule est une fiction. Elle relève parfois de l’autopersuasion. Mais cette fiction jouait un rôle social essentiel. Elle faisait que chacun se tenait tranquille en attendant le verdict. Elle était utile à la pacification de la société. Toute société repose sur des fictions. Par exemple le fait que l’on fasse confiance aux personnes que l’on a élue repose sur une pure croyance. Il n’y a aucune preuve scientifique permettant d’établir qu’une personne élue majoritairement ferait le bien de son pays. Mais on veut bien le croire car on se dit que la société marche mieux comme cela.
J’ai ressenti dans beaucoup d’interventions que l’institution judiciaire est en train de perdre sons sens non seulement pour les citoyens mais également pour ceux qui en font leur métier et y engagent leur existence. Cette question du métier et de son sens est souvent négligée dans le combat traditionnel syndical et politique. Mais elle est décisive car on ne retire pas seulement un salaire de son activité professionnelle. On s’y construit, c’est là aussi que l’on donne un sens à sa vie. C’est particulièrement évident pour tous ceux qui participent au service public de la justice. Pour travailler dans la justice, il faut croire à la justice. Il faut croire au minimum que l’institution judiciaire peut être juste. Les juges par exemple ne peuvent être transformés sans dégâts en radars automatiques qui distribuent des peines planchers à la chaîne car ce n’est pas cela qui les a fait venir vers ce métier. D’où ce sentiment d’absurdité qui touche tant de professionnels du secteur. Même si bien sûr la question de la réduction des moyens est première, car elle est la cause de tout, à partir d’un certain seuil son effet n’est pas seulement quantitatif. C’est la croyance même dans un service public de la justice qui est affecté et donc son fondement le plus essentiel. Par exemple, des juges dits de « proximité » doivent juger des dossiers en trois minutes trente afin de respecter les délais. Donc ils ne jugent pas. Autre absurdité soulignée par un intervenant, le fait qu’aujourd’hui le ministère de la justice ne connaît pas la totalité des délits pénaux.
Je vois de telles situations dans de nombreux services publics. A l’hôpital public, à cause des restrictions budgétaires, un chef de service doit décider s’il il va soigner telle ou telle personne et en faisant cela il sait qu’il abrège la vie d’une personne alors que le sens même de son métier est inverse. Cela tient un temps, les gens préfèrent contourner cette vérité mais la réalité finit par reprendre le dessus. Elle le fait de manière parfois dramatique, avec une souffrance au travail qui peut conduire au suicide. Mais elle est aussi moteur d’engagement et de réinvention du métier lui-même. Je vois surgir au sein même de votre corps, des syndicats qui vous représentent, un nombre croissant de gens de métier qui s’interpellent et qui se mobilisent pour redéfinir, repenser ensemble ce qui fait leur identité professionnelle. Cette journée a permis d’esquisser ce que pourrait être la rencontre entre ce mouvement et des citoyens engagés pour une refondation générale de la République par le moyen d’une révolution citoyenne. Cette rencontre peut se produire dès lors que chacun part d’un terrain commun, l’intérêt général du pays. Il faut redisposer les institutions par rapport à ce qui est nécessaire au pays. Il ne faut surtout pas le faire en vase clos. Les universités n’appartiennent pas aux universitaires, ces derniers ont un mandat de la société pour faire tourner les universités. L’Etat donne des orientations du type « tous les jeunes doivent avoir accès à l’université après le bac » et les universitaires gèrent par la suite car c’est leur métier de savoir comment faire en pratique. De la même manière pour la justice, il faut que le peuple, après débat, soit en capacité d’indiquer des finalités conforme à sa conception de l’intérêt général et c’est d’elles que l’organisation du système judiciaire doit se déduire.
Ainsi, abroger toutes les mesures prises par la droite en matière de justice serait évidemment positif mais ne suffirait pas à donner un sens à cette institution. Le secrétaire général du syndicat de la magistrature a défendu ici l’idée d’une révolution de la justice. C’est u nmot très fort. Une révolution telle que nous l’entendons ne peut être que citoyenne, procéder d’un débat entre tous les citoyens et pas seulement entre professionnels, qui y participent en tant que citoyens nourris de leur expérience professionnelle. Il faudra faire en sorte que la question de la politique pénale ne soit pas seulement l’affaire des politiques, que les citoyens puissent s’en saisir, que l’on démocratise la politique pénale par le biais de débat publics où chacun pourra discuter les objectifs principaux assignés à la justice. Pour être concret, on peut dire qu’il y a une exigence d’intérêt général à faire reculer la fraude fiscale. C’est un enjeu central pour un pays, à l’heure où on nous dit que la Grèce croule sous les dettes à cause des fraudes fiscales. Ce n’est pas une décision qui peut être prise uniquement au niveau d’un ministère, cela mérite une mobilisation et un débat dans la société pour qu’ensuite le système judiciaire puisse s’organiser en fonction des décisions prises. De même, c’est un enjeu d’intérêt général que l’entreprise ne soit pas une zone de non droit. Le socialisme vient de cela : la république sociale de Jaurès c’est l’idée qu’on a fait la révolution et transformé le sujet en citoyen dans la cité mais qu’il reste un serf dans l’entreprise. Cela mérite quand même qu’on en discute dans une élection présidentielle et qu’à partir de cela dans le pays cela devienne un objet politique. Si le peuple adhère à cet objectif, il faudra voir comment la justice peut contribuer à faire régner le droit dans le monde de l’entreprise. A partir de telles finalités, on peut recréer de l’adhésion, de la légitimité, de la lisibilité à notre système judiciaire. Là au moins les gens comprennent. Ils sont prêts à se mobiliser pour cela et donc à intervenir car il faut que les citoyens s’en mêlent. C’est le rapport des citoyens à la justice qui s’en trouve transformé. Usagers du système judiciaire, nous ne sommes pas simplement des victimes ou des coupables, nous sommes des citoyens avant tout !
Je suis convaincu que sur les questions de justice, que l’on considère souvent comme trop pointues ou trop passionnelles pour que le peuple s’en mêle, on n’arrivera à rien si on ne peut pas s’appuyer sur une opinion éclairée. Les évolutions qui ont lieu dans le système judiciaire ne sont pas uniquement l’œuvre d’un Nicolas Sarkozy, Christian Estrosi, Ciotti et cette petite bande de fous qui sont là à souffler sur les braises et qui sont habités d’une obsession sécuritaire. C’est aussi l’expression d’une pression de la société, une pression qui doit être combattue. Il faut que lorsqu’on juge le patron, la moitié de l’entreprise soit là, et que le journal local couvre l’affaire de manière aussi importante qu’un fait divers. On ne peut faire l’impasse sur la bataille culturelle à mener pour que les citoyens changent leurs attentes vis-à-vis de la justice. Il faut un peuple éduqué sur les questions de justice. C’est aussi un enjeu de la participation des citoyens à la justice. Celle-ci peut être éducative, comme par exemple la participation à un procès d’assise où l’on me dit qu’elle transforme le regard des jurés qui ressortent grandis de cette expérience.
C’est lorsque l’on a arrêté les principes qui doivent orienter la justice que l’on peut l’organiser avec un objectif d’efficacité. En la matière, je serai d’accord pour dire que les institutions judiciaires et policières doivent produire des résultats évaluables. Mais comme nos objectifs sont différents nous récusons les indicateurs actuels. Par exemple, l’indicateur de remplissage des prisons doit être remplacé par un indicateur de déremplissage des prisons. Le recul de la récidive est un bon indicateur, ce n’est pas pareil que le « zéro récidive ». La capacité à atteindre cet objectif fait partie de la professionnalité des professionnels de la police et de la justice.
Celle-ci doit être pleinement reconnue par la société. En réalité, je crois que cela est difficile car on pense que la compétence du juge est trop souvent réduite à « connaître la loi » alors que sa professionnalité s’exerce aussi dans sa manière de rendre la justice. Si l’objectif par exemple est fixé en termes de réinsertion, la manière dont la peine est décidée compte beaucoup car elle contribue à déterminer le sens de la peine pour la personne qui va être punie et ça ne peut pas se régler dans la minute avec des indices de productivité. Il est également difficile de reconnaître une professionnalité aux personnes remplissant les missions de service publique de la justice car ces professions renvoient à une certaine forme de violence, notamment pour les fonctionnaire de polices ou les surveillants de prisons qui exercent plus directement qu’un magistrat par exemple une forme de violence voulue par la société mais qu’elle a tendance à mettre à distance, à refuser de voir. Cette professionnalité est niée enfin par les discours anti-magistrats de Nicolas Sarkozy ou les politiques du chiffre imposées aux fonctionnaires de police qui en font des rouages inertes dans des chaines de statistiques agrémentées de primes de salaires. Cela sachant que ce n’est pas une politique qui contribue à la sûreté publique. Flic c’est un métier et ce n’est pas attraper à vingt quelqu’un qui peut pas se défendre. La société a donc intérêt à ce que ces professionnels soient bien formés.
Autour de cette intervention citoyenne reconnaissant la professionnalité des intervenants du secteur judiciaire, j’insiste sur la nécessité de mener une bataille culturelle sur les questions de sécurité. L’idéologie sécuritaire est le résultat de ceux qui la répandent. Ce n’est pas une fatalité ni un mouvement naturel de la société. C’est une fabrication politique qui dépasse les frontières des partis, que vous retrouvez aussi bien à droite à gauche. C’est une conséquence du libéralisme qui a été embrassé par la droite et la grande majorité des sociaux-démocrates. Quelqu’un comme Tony Blair exprime ça magnifiquement, il est l’archétype de la conversion du mouvement socialiste historique à la ligne démocrate. Il vous dit que le capitalisme est amoral mais comme l’objectif n’est plus de le combattre et qu’en même temps aucune société ne peut fonctionner sur la base d’un système pareil eh bien on va y injecter de l’ordre moral. Cette thèse s’est répandue en France avec les propos de Lionel Jospin qui disait « j’ai eu tort de croire qu’en luttant contre le chômage, j’allais faire reculer l’insécurité ». Avec de tels discours, on comprend que l’idéologie sécuritaire devienne irrésistible. Elle est irrésistible car personne dans le champ politique n’y résiste. Il faut donc que des forces résistent pour faire reculer l’emprise de l’idéologie sécuritaire. C’est une responsabilité que nous nous donnons au Parti de Gauche. Cela ne peut se faire efficacement avec une vision Bisounours de la société. L’idéologie sécuritaire fonctionne car elle désigne un ennemi. Contrairement à ce que pense une certaine bienpensante, nos sociétés sont fondées sur des rapports conflictuels. Il y a une conflictualité politique qui doit s’exprimer, c’est la base de la démocratie. Il y a une conflictualité sociale qui doit s’exprimer, ce ne serait pas sain que les gens se laissent faire les poches en souriant et pour combattre cela ils doivent être capables de nommer ceux qui leur font les poches. Cette conflictualité là est étouffée, non dite, tue parfois par ceux qui, c’est le rôle de la gauche, ont la charge de l’exprimer. Alors que Nicolas Sarkozy, lui, nomme clairement des ennemis. En ce qui nous concerne, nous avons des ennemis que nous nommons et qui en plus sont bien connus, c’est le cas par exemple des évadés fiscaux. Il est frappant de voir tant d’intervenants du champ social mener devant nous une réflexion politique sur leur métier. C’est un encouragement pour les militants politiques que nous sommes à se saisir de ces questions et à en faire un des objets de la campagne législative et présidentielle qui nous attend.
[1]Manuel Boucher, sociologue, Président de l’association des chercheurs des organismes de la formation et de l’intervention sociales (ACOFIS) et responsable du réseau thématique « Normes, déviances et réactions sociales » à l’association française de sociologie (AFS).
[2]Du 27 octobre au 17 novembre 2005, la France va connaître les plus grandes émeutes urbaines de son histoire contemporaine suite à la mort de deux jeunes de Clichy-sous-Bois électrocutés après une poursuite avec la police. Pour rappel, sur 21 nuits d’émeutes (d’abord en région parisienne puis dans 300 cités populaires sur l’ensemble du territoire national) on peut notamment comptabiliser la mobilisation de 11 500 policiers et gendarmes par jour aidés par 7 hélicoptères, 30 000 poubelles incendiées, des centaines de bâtiments publics, d’entreprises et de bus dégradés ou brûlés, 4800 interpellations, 600 peines d’emprisonnement, surtout en comparaison immédiate. Dès lors, après une panique médiatique et politique, le « couvre feu » est décrété le 8 novembre et prolongé jusqu’au 4 janvier 2006. Ces émeutes ont par ailleurs essentiellement éclaté dans des « zones urbaines sensibles » se caractérisant par le cumul de nombreuses difficultés socio- économiques (logements sociaux dégradés et exigus, peu de mixité sociale, forte population immigrée, beaucoup de familles nombreuses, un taux de chômage 2 à 3 fois plus fort qu’ailleurs, de nombreux jeunes en échec scolaire, des épreuves de la discrimination, des problèmes de petite délinquance et d’incivilités, une quasi absence de représentation politique et un fort sentiment d’enfermement).
[3]En arrivant au ministère de l’intérieur en 2002, Nicolas Sarkozy demande aux responsables policiers de donner la priorité aux missions d’investigation et de répression. En outre, lors d’une visite fortement médiatisée à Toulouse, le 3 février 2003, en s’adressant aux policiers présents, il affirme la posture répressive et viriliste de la police et stigmatise la « police de proximité » en sermonnant les policiers intervenant dans les quartiers populaires qui confondent leur fonction de représentants de l’ordre avec celles d’animateurs sportifs et de travailleurs sociaux. Ainsi, le ministre de l’intérieur de l’époque participe à renforcer l’image repoussoir que beaucoup de policiers s’identifiant d’abord à l’autorité fondée sur la force et le pouvoir de sanction ont déjà des travailleurs sociaux, en particulier des assistants sociaux auxquels ils craignent d’être assimilés.
[4]Les émeutes de Villiers-le-Bel, en banlieue parisienne, ont lieu du 25 au 27 novembre 2007 suite au décès de deux jeunes de 15 et 16 ans renversés par une voiture de police dans une rue de leur cité alors qu’ils circulaient sans casques sur une « mini-moto ». Or, au cours de ces émeutes opposant quelques centaines de jeunes aux forces de l’ordre, des émeutiers vont utiliser des armes à feu (souvent à grenaille) et blesser près de 150 policiers selon le ministère de l’intérieur.
[5]Présentées comme des unités de police expérimentées, les UTEQ sont chargées de s’implanter dans des « quartiers sensibles » (les premières UTEQ sont notamment mises en œuvre en Seine-Saint-Denis et à Marseille. En juin 2010, on compte 34 UTEQ sur l’ensemble du territoire national) et de les sécuriser.
[6]Le 17 août 2010, le ministre de l’intérieur, Brice Hortefeux annonce le remplacement des UTEQ par les BST en mettant l’accent sur le volet dissuasif et répressif de ces brigades de terrain devant œuvrer dans un « bassin de délinquance » plutôt que dans un quartier en fonction des besoins de la population. En outre, il indique que les BST ne seront certainement pas des « policiers d’ambiance ou des éducateurs sociaux » pas plus que des « grands frères inopérants en chemisette qui font partie du paysage. » Voir, « Hortefeux renomme sa police de proximité » in le Monde du 18 août 2010.
[7]En avril 2011, le ministre de l’intérieur Claude Guéant annonce également la création expérimentale d’unités de « patrouilleurs dans les quartiers ». Il indique que ces «patrouilleurs» circuleront généralement en binômes, à pied, en vélo, à rollers ou en voiture, notamment pour entretenir le «contact avec la population», «observer, écouter, se renseigner, interpeller à des créneaux horaires adaptés à la réalité de la délinquance». En revanche, Le ministre de l'intérieur réfute tout retour à la police de proximité, créée par la gauche de gouvernement et supprimée par Nicolas Sarkozy.
[8]Les historiens qui travaillent sur la police et la société soulignent que les rapports difficiles et ambivalents entre la police et la population ne datent pas d’hier et qu’elle est depuis très longtemps, pas seulement en France, accusée de beaucoup de choses, « de tout et de son contraire » (absente, en retard, inefficace, envahissante, menaçante, omniprésente…). En revanche, ils indiquent également qu’en France, notamment, ces dernières années, il est indéniable que le problème s’est nettement aggravé et que les raisons sont assez claires : « Défenseurs d’un ordre établi d’autant plus contesté qu’il semble condamner au désespoir et au chômage des millions d’exclus, les policiers, figures symboliques et emblématiques du pouvoir, de lois injustes, de la contrainte et de la « répression », constituent un exutoire idéal pour les opprimés, exclus, marginaux, opposants et contestataires, un paravent pratique pour les responsables politiques. » (Berlière, Lévy, 2011 : 458)
[9]Dans le travail de la police, notamment dans la rue, de nombreuses initiatives importantes sont directement produites par les policiers de terrain. Dès lors, même si la hiérarchie policière tente de s’organiser pour commander (organisation bureaucratique), celle-ci est néanmoins assez dépendante des informations que les policiers lui font remonter.
[10]Lors d’un entretien collectif dans une école de police avec un groupe d’apprentis gardiens de la paix, plusieurs jeunes policiers ont dénoncé le fait que durant les séances de boxe, leurs formateurs leur demandaient de porter réellement les coups entre eux, même lorsque qu’il s’agissait de couples pugilistiques mixtes, sous prétexte que dans la rue, les coups sont également portés.

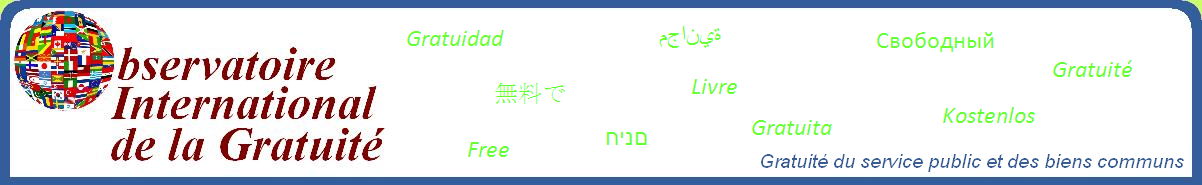




/https%3A%2F%2Fstorage.canalblog.com%2F45%2F62%2F1297332%2F98675872_o.jpeg)