> Culture
.
IL Y A DE LA VIE ENTRE LES INDUSTRIES CAPITALISTES
DE LA CULTURE ET L’APPAREIL CULTUREL D’ÉTAT
Jean-Louis Sagot-Duvauroux
Jean-Louis Sagot-Duvauroux est essayiste, dramaturge, co-fondateur et co-animateur de « Blonba », structure de création artistique et d’action culturelle au Mali. Dans ce texte, il reprend et développe le thème de son intervention devant le groupe Orfeo du Commissariat général du Plan (séance plénière du 8 mars 2005)
1/ UNE MODIFICATION FONDAMENTALE DANS LES RELATIONS ENTRE LA CULTURE ET LE POUVOIR
Longtemps, la conduite de l’innovation culturelle (création artistique et littéraire, recherche scientifique, pensée théorique, inventions sociales) s’est effectuée dans un rapport dialectique entre pouvoir politique et liberté des créateurs. Cette dialectique était représentée sous la figure d’un affrontement entre deux vérités. Galilée prétend que, contrairement à l’imagerie biblique, la Terre tourne autour du soleil. L’inquisition affirme le contraire au nom du livre saint. Molière pense que l’hypocrisie religieuse est une menace pour les individus et il écrit Tartuffe. Le roi pense que le respect des dévots est une garantie pour l’ordre public et il interdit Tartuffe. Au nom de la vérité des comportements, Manet ou Nabokov représentent des scènes jugées scandaleuses par l’ordre moral et se heurtent à ceux qui voient dans cette représentation une insulte à l’éternelle vérité. Souvent, la contradiction se résout en un compromis qui entraîne le consensus. Giotto ou Masaccio placent les sujets de leurs images dans une perspective optique dont l’Homme est la mesure et le centre, contestant radicalement la vision théocentrique de la peinture byzantine. Mais ils bourrent le cadre humaniste de sujets pieux. Néanmoins, ce qui caractérise l’évolution des savoirs et des formes est un débat dans lequel se confrontent deux systèmes de vérité essayant l’un et l’autre de convaincre de leur fiabilité.
Aujourd’hui, on assiste à un bouleversement de ce paradigme. La conduite de l’innovation culturelle est en train de passer entre les mains du capitalisme financier. La friction entre la vérité conservatrice de l’ordre établi et celle de la liberté de création s’efface devant un critère totalement nouveau, hétérogène à la question du langage : l’augmentation du taux de profit. Les grandes firmes capitalistes qui prennent une place de plus en plus déterminante dans l’émergence et la distribution des connaissances et des formes nouvelles, c’est-à-dire dans la production de langage, n’ont plus comme critère déterminant la fiabilité, même controversée, du langage, mais la capacité des produits culturels à générer un taux de profit suffisant pour qu’elles puissent se financer sur le marché des capitaux. Lorsqu’il explique le fonctionnement et le « sens » de l’entreprise TF1, Patrick Le Lay ne fait qu’exprimer sans fard cette réalité nouvelle : l’usage du langage, sa fiabilité, n’est plus le critère. Le critère n’est plus endogène à l’usage du langage. Celui-ci, devenu une marchandise lancée dans la danse du capitalisme financier, établit sa valeur non plus d’abord dans son usage, mais d’abord dans sa capacité à s’échanger contre de l’argent.
Or le langage, la création artistique, l’innovation scientifique et à fortiori la pensée théorique ne sont pas des lave-linge. Le lave-linge sert à la fois à valoriser le capital de la firme qui le produit et à laver le linge de celui qui l’achète. Mais ses capacités lavatoires, sa fiabilité mécanique ne sont en rien mises en cause par sa forme marchandise. Le langage, lui, est un « bien d’usage » qui a cette particularité de se dissoudre quand on lui applique ce traitement. Si le téléspectateur sait que le choix des informations diffusées par TF1 n’a pas pour critère décisif leur fiabilité, leur vérité, mais leur capacité à proposer aux annonceurs du « temps de cerveau disponible », c’est l’usage même du langage qui s’effondre. Alors la société est traversée par un trouble dévastateur : « On ne peut plus croire en rien ».
En même temps que s’effectue cette modification aux effets considérables, on voit apparaître la revendication nouvelle de « démocratie culturelle ». Devant le poids pris par la mécanique du marché des capitaux sur la conduite de notre civilisation et la production du langage, l’affirmation que le pouvoir du peuple conserve une légitimité est évidemment rafraîchissante. Mais il n’est pas certain que cet enjeu soit toujours au cœur de ce qui est représenté sous le mot d’ordre. En dépit d’une bonne volonté sans équivoque, les expériences placées sous le drapeau de la démocratie culturelle sont très souvent la mise en scène, la mise en transparence de l’ancien débat entre pouvoir politique et créateurs. Elle se traduit généralement par des rencontres « aristocratiques » entre professionnels de la culture et autorités publiques bien intentionnées avec comme objectif l’établissement de règles contrôlables dans la gestion de leur ménage incommode. Or ce face à face manifeste une double impotence : incapacité à répondre avec la puissance nécessaire à l’hégémonie montante du critère capitaliste sur la production du langage ; incapacité à conduire la démocratisation culturelle.
2/ ARISTOCRATIE CULTURELLE
Paradoxalement, le projet de « démocratisation de la culture », au sens de sa large diffusion dans toutes les couches de la société, a été raté par les politiques publiques et réussi par le marché capitaliste. C’est le marché qui a conduit cette révolution liée à l’explosion des moyens technologiques, mais également à l’élévation du niveau d’études, voire au développement du temps libre. Il a mobilisé pour ça des capitaux sans commune mesure avec le problématique horizon du 1 % culturel que s’est fixé le budget de l’Etat. Bien entendu, il l’a fait à sa main, avec ses Fauchon, ses Leader Price, et surtout la mutilation brutale de tous les possibles ne répondant pas à ses critères.
On doit s’interroger sur l’échec relatif des politiques publiques de démocratisation de l’accès à l’innovation culturelle. Il est lié, me semble-t-il, à des raisons ataviques qui affaiblissent structurellement l’impact de l’intervention publique. Sans aller trop avant dans l’analyse, on peut pointer quelques figures qui structurent de l’intérieur la représentation et la mise en œuvre des politiques culturelles publiques.
a/ La figure romantique de la création
De l’âme du « créateur » naît une œuvre qui se détache de lui, circule et s’offre, pure de toute salissure, à la dégustation de l’amateur averti. Cette représentation, encore tout à fait dominante, quoique aujourd’hui soumise à de fortes tensions, est comme une version sublimée de l’aliénation des biens d’usage sous la forme de marchandises. Ce qui singularise l’acte artistique, ce qui le relie à la réalité sociale dans laquelle il surgit est minimisé, virtualisé, de telle sorte qu’on puisse en attendre, individu par individu, une satisfaction symbolique équivalente en tout lieu. Tout est là pour qu’en marge du grand marché se mette en place un petit marché, une niche spécialisée dans le commerce des œuvres sublimes, avec ses magasins et ses publics exceptionnels (l’exception française ?). La forme officielle d’accès aux œuvres sublimes est celle de la consommation marchande de luxe (l’achat d’un ticket d’entrée manifestant par son prix souvent élevé la « valeur » de l’œuvre). S’y adjoint presque toujours, et de façon parfois massive, un système de passe-droit, gratuité réservée aux élites culturelles et politiques, souvent les mêmes qui plaident contre la gratuité, pour les autres, au motif qu’elle dévaloriserait les œuvres. Dans la représentation comme dans les modalités d’accès, on est devant un processus actif de constitution d’une aristocratie culturelle. Cette « formule » est évidemment mal outillée pour proposer une alternative convaincante aux pratiques et aux effets du «grand marché» sur la vie artistique. D’ailleurs, elle s’incline spontanément devant sa logique pour justifier le niveau et la forme de ses tarifications : « Les gens sont prêts à payer 40 € pour un concert de Johnny Hallyday. Ils doivent être capables d’en payer 20 pour une grande œuvre de création ». L’argument entérine la ressemblance supposée des processus : un désir préexistant se payant un produit avec le sentiment d’en avoir pour son argent. Mais le parallèle entre une consommation culturelle de masse et une consommation culturelle d’élite produit deux effets très favorables à l’empire du marché : il brouille la représentation de la rencontre avec la création, qui justement n’est pas faite pour combler un désir préformé ; il met en scène un jugement aristocratique sur le bon et le mauvais goût, jugement qui recouvre presque exactement l’inégalité sociale. Dans ce vice de représentation, il y a une soumission non pensée à la logique esthétique et sociale du marché. Cette soumission affaiblit inévitablement la capacité de l’appareil culturel d’Etat à représenter l’intérêt public.
b/ Prééminence du critère de l’histoire de l’art
Le système public d’aide à la création distingue les œuvres sublimes à partir d’un critère qui s’est peu à peu imposé comme le seul pertinent : l’avancement de l’histoire de l’art. Une œuvre est jugée créative en fonction de son apport à l’histoire de son champ, en raison de sa capacité à faire histoire dans son champ. Les métiers artistiques qui répondent le mieux à ce repérage prennent le pas sur les autres : la mise en scène pour le théâtre, la chorégraphie pour la danse contemporaine, tous les arts de conceptualisation, au détriment par exemple de l’art de l’acteur ou du danseur (et de leur éventuelle notoriété) qui passe au rang de critère subalterne. Même déclassement pour les effets de l’événement artistique sur la vie sociale ou politique, critère exogène, longtemps déterminant, mais aujourd’hui jugé de second rang sous le rapport de l’histoire de l’art. Le critère unique, ou du moins dominant, de l’histoire de l’art est aussi celui qui échappe le plus aux cercles extérieurs à l’aristocratie culturelle. Impossible de se l’approprier sans une fréquentation assidue des nouveautés, fréquentation assidue que son prix et le temps qu’elle nécessite rend impossible à presque tous, sauf à ceux pour qui c’est gratuit. Un des résultats du processus est l’effondrement de la critique. Les non-assidus, c’est à dire presque tous, se taisent de peur de « dire des bêtises ». Quant à ceux qui savent, ils sont globalement ceux qui vendent. A l’instar du grand marché de la culture pour tous, le petit marché des œuvres sublimes remplace la critique par sa promotion. Segmentation assurée entre public averti et public naïf, coupure assurée avec l’armée de ceux qui ne tentent même pas l’expérience[1].
c/ Ethnocentrisme
La position prééminente du critère de l’histoire de l’art dans le système institutionnel public est en profonde cohérence avec la représentation moderne, occidentale, progressiste, vectorielle, impériale de l’histoire telle que l’Occident se l’est construite. L’histoire – histoire militaire comme histoire de la poésie – est pensée sous la forme d’un vecteur unique tendu vers le progrès. Elle se juge sur des podiums. Le Lagarde et Michard est un podium. L’institution théâtrale française (théâtres nationaux, CDN, scènes nationales, scènes conventionnées) est un podium. Elle recrache ce qui ne trouve pas place dans l’organigramme. Les arts non-blancs ne trouvent pas place dans l’organigramme. Ils sont entassés quai Branly. Sauf quand les non-Blancs s’inscrivent d’eux-mêmes dans l’organigramme, par exemple quand ils produisent des textes dans les genres littéraires repérés dans l’organigramme ou montent des spectacles qui entrent dans la boîte.
Cette représentation autour de laquelle se structure le système culturel public et toute la construction de l’aristocratie culturelle manifeste une lourde incapacité à prendre en compte les autres sources de la culture humaine, les autres lignées culturelles de l’humanité. Il faut nécessairement que celles-ci se conforment d’une manière ou d’une autre à l’histoire, aux catégories et au fonctionnement de la culture impériale pour espérer trouver une place dans le réseau. S’il existe à la marge un certain intérêt pour le « mélange des cultures », il s’opère à travers des processus concrets qui ressortissent davantage à la digestion qu’au métissage.
Une fois encore, le système culturel public se trouve en état de faiblesse structurelle pour réunir les forces disponibles autour d’un enjeu majeur de la société contemporaine, enjeu porté par la partie la plus populaire des couches populaires : la construction d’une culture planétaire respectueuse de la diversité. Une fois encore, le marché, lui, investit le champ pour son compte et avec ses critères. Les bacs « Musique du monde » ne manquent pas de clients.
Ces quelques éléments idéologiques du blocage de l’appareil culturel d’Etat pourraient se décliner autour d’autres axes qui révéleraient les mêmes difficultés à répondre aux enjeux d’une culture ouverte à tous, à porter l’intérêt public face au marché capitaliste : propriété intellectuelle, métier de directeur de structure, décentralisation et rapport avec les élus, tarification et marketing des institutions publiques, concurrence entre institutions publiques, exclusivités exigées par des institutions publiques contre d’autres, etc.
3/ DÉMOCRATIE CULTURELLE ?
Face au dramatique enjeu de civilisation que porte la privatisation des processus de création de langage et leur assujettissement à la mécanique capitaliste du taux de profit, le système culturel public en place n’apparaît pas comme une instance de résistance adaptée. Par certains aspects, on pourrait même dire qu’il entrave les mouvements à l’œuvre dans la société. Cette situation est nouvelle. Dans le temps de sa construction, le système culturel public s’est trouvé dans une tension positive. Il a porté de réelles espérances et de vraies avancées. Jusqu’à présent, il permet l’émergence de centaines d’œuvres importantes qu’aurait inévitablement dédaignée la mécanique marchande. Il assure l’existence et les perspectives de milliers de professionnels. Mais les politiques culturelles publiques ont changé de configuration. Elles assignent désormais à ce système une place périphérique et une fonction de plus en plus conservatrice. Les grandes options de politique culturelle ne sont plus du ressort du ministère de la culture. Elles sont des choix de politique industrielle : cession de la communication de masse aux grands groupes du capitalisme financier ; libéralisation des concentrations dans les industries culturelles ; ouverture à la mondialisation capitaliste du secteur ; construction libérale de l’Europe… Placé en périphérie, l’appareil culturel public se concentre sur quelques bastions où se jouent la survie d’arts non-industrialisables et/ou l’enjeu politique de l’influence française : patrimoine, spectacle vivant, protection d’une industrie audiovisuelle nationale. Son action la plus voyante concerne le maintien d’une niche étatique pour les œuvres sublimes et la mise en œuvre de son fonctionnement aristocratique. La rectification apportée par Renaud Donnedieu de Vabres par rapport à son prédécesseur consiste dans une gestion madrée de cette enclave contre les menaces les plus voyantes du marché, tandis que dans le reste du champ culturel, l’hégémonie capitaliste s’approfondit avec le soutien actif de l’autorité publique.
En même temps que cette marginalisation, le changement de paradigme dans la conduite de l’innovation culturelle produit aussi des résistances populaires. Ces résistances surgissent partout où il apparaît aux consciences que le critère capitaliste dénature en son axe l’activité humaine. C’est à l’évidence le cas pour la culture. La question de la diversité culturelle est en train de devenir une ligne de force du mouvement alter-mondialiste. Elle hante des révolutions populaires comme celle du Chiapas. La « propriété intellectuelle », un des piliers du système, est attaquée. La publicité, symptôme le plus obscène de la dictature de l’argent sur la vie culturelle, provoque de spectaculaires mouvements de révolte. A côté des mastodontes de la culture « concentrée », on voit foisonner une économie multiforme constituée de petites unités réunissant leurs acteurs autour de l’usage des biens produits et non pas de la recherche du profit maximum. Même hantées par les figures de la consommation, les luttes sociales « classiques » pour la diminution du temps de travail contraint sont de plus en plus explicitement raccordées au développement d’une libre activité dans laquelle la culture tient potentiellement une place essentielle. Le marché peine à domestiquer Internet qui, jusqu’à présent, fuit de partout.
Si une force est aujourd’hui capable d’affronter l’hégémonie du critère capitaliste sur l’innovation culturelle, c’est du côté de ces mouvements autonomes de la société qu’on la voit monter. L’intervention publique peut-elle s’y articuler efficacement et contribuer à son essor ? Autrement dit, une « démocratie culturelle » au sens technique du terme peut-elle s’articuler au mouvement autonome de la société pour favoriser une appropriation par tous de l’innovation culturelle ?
Je propose trois lignes d’action, nullement exhaustives, mais qui portent sur des aspects de l’institution culturelle publique où se structure son fonctionnement aristocratique.
a/ Désintimider, changer de mondanité
- Samedi soir, tu fais quoi ?
- Samedi soir, je sors.
- Et tu sors où ?
- Je sors au théâtre.
Si on analyse ce court dialogue, on y lit la prévision de deux événements : une sortie de week end, une pièce de théâtre. Souvent, les deux événements ne sont pas distingués.
- Samedi soir, tu fais quoi ?
- Samedi soir, je vais au théâtre.
« Je vais au théâtre » est une double annonce, l’annonce d’une mondanité et l’annonce d’un moment de culture, mais une double annonce présentée dans un unique énoncé, de telle sorte que la mondanité et la rencontre avec la création semblent n’être qu’un seul et même acte.
Au Mali, on pourrait entendre un dialogue assez différent :
- Samedi soir, tu as fait quoi ?
- Samedi soir, j’étais au mariage de Mamadou Diarra.
- C’était bien ?
- Magnifique. Il y avait Dyéli Baba Sissoko [2]. Je n’ai jamais entendu raconter l’histoire des Diarra avec tant de force.
Encore un double récit : une mondanité, une rencontre avec la création. Mais un récit qui, lui, ne se présente pas comme un énoncé unique. On sait à quoi s’en tenir sur les deux événements. La référence artistique au griot Baba Sissoko est clairement distinguée de la mondanité proposée aux parents et amis de Mamadou Diarra. Les amis de Mamadou Diarra se sont rendus à son mariage pour le plaisir de cette mondanité. A l’occasion de cette mondanité, ils ont été mis en présence avec la création d’un poète connu.
Dans le premier dialogue, la mondanité est camouflée sous les apparences d’une pure rencontre avec l’art. Une mondanité est organisée par et pour les classes moyennes cultivées, par et pour l’aristocratie culturelle (avec ses rites, ses chapeaux et ses vestes noires, ses références et ses façons de parler, de tenir le verre de vin, de pester contre l’interdiction de fumer, avec les nombreuses connaissances qu’on y croise régulièrement) et elle se confond abusivement avec l’autre événement, la rencontre intime de la création. Pour ceux qui ne se sentent pas à l’aise dans cette mondanité-là, c’est rédhibitoire. Mais comme l’énoncé est unique – « je vais au théâtre » – le rejet d’une mondanité dans laquelle « on ne se sent pas chez soi » se traduit aussi par une unique expression de dépit : « Au théâtre, je me fais chier ! »
Il faut observer tous les lieux et toutes les initiatives qui distinguent la mondanité, inévitable, de la rencontre avec la création. Souvent c’est par un déplacement des lieux: friches, squats, « nouveaux territoires de l’art », théâtre itinérant, arts de la rue, happening politico-artistiques, réanimation de la vie rurale, certaines formes d’installations, etc. Parfois le déplacement s’opère par des « provocations » économiques, comme la gratuité. Certains artistes fondent leur action sur de telles mises en mouvement : Nicolas Frize, Armand Gatti…
L’institution elle-même peut s’y coller, plaçant ainsi dans une nouvelle position sociale ses grands avantages techniques et les œuvres qui vont avec. Nous l’avons tenté à Bonneuil-sur-Marne, à la salle Gérard-Philipe que dirigeait alors Christophe Adriani et où j’étais auteur associé. Régulièrement y furent organisées des moments de vie sociale où une mondanité décalée – concours de potage, réveillon de nouvel an, débat politique… - s’accompagnait de mises en formes confiées à des créateurs : graphisme, photographie, travail d’écriture, création théâtrale, jazz contemporain, musique à danser… Presque à chaque fois, ces événements ont amené à la salle un public populaire désintimidé qui s’appropriait vraiment, et sans façon, les œuvres proposées. Il faut dire aussi que l’expérience a suscité l’hostilité de la tutelle politique tiraillée entre la tentation populiste d’une programmation à succès et l’intérêt électoral d’un équipement offrant un service spécifique aux classes moyennes cultivées dans une ville encore très ouvrière.
b/ Mutuelles de publics
Les tarifications et les formes de paiement usuelles dans l’institution culturelle publique miment le système commercial et le rapport de consommation. Chacun se présente au guichet en consommateur individuel, « achète sa place » et se trouve fondé à souhaiter en avoir pour son argent. Cette forme est triplement menteuse. Un public est toujours pour une part un collectif pris dans une pratique sociale et dans un acte artistique. L’usager de l’équipement culturel n’achète pas sa place, mais apporte une contribution, d’ailleurs minoritaire, au financement du spectacle ou du musée. La rencontre avec la création exclut le rapport de consommation où un désir préétabli rencontre, pour un juste prix, son exacte satisfaction.
Avec quelques autres, j’ai lancé l’idée des mutuelles de publics. Une loi votée sous le gouvernement Jospin ouvre désormais le champ de la forme mutualiste bien au-delà du secteur de la santé, où s’est historiquement situé son développement. Prenons le cas du théâtre. Une mutuelle donnerait sa vraie forme à l’implication matérielle et immatérielle des spectateurs. La cotisation mutualiste prend la forme d’un acte de soutien conscient à une aventure artistique. Les prestations matérielles (tarifs préférentiels) ou immatérielles (participation de nature diverse à la marche du théâtre) éloignent du rapport de consommation.
La Mutuelle ne méprise pas les contraintes financières. Mais elle remet l’argent et le marché à leur place, « mauvais maîtres, bons esclaves ». Elle constitue potentiellement une vraie force économique non capitaliste capable d’influer sur le développement de l’activité créatrice, une force distincte du pouvoir économique capitaliste, du pouvoir politique et potentiellement de l’aristocratie culturelle. Dans un théâtre, a minima, la cotisation mutualiste se substitue à l’abonnement. Mais l’abonnement est un contrat d’achat entre une structure et un individu. Pas la cotisation que le mutualiste verse à sa mutuelle. Ce changement de forme ouvre la voie à la constitution d’une vraie communauté humaine impliquée et notamment aux échanges immatériels, parties intégrantes du fonctionnement mutualiste, dont on voit bien qu’en matière artistique, ils sont l’essentiel.
La Mutuelle est une construction collective qui manifeste le caractère social de ce qui se passe quand des humains se réunissent pour partager autour de l’art. Elle est un espace nouveau où penser mutuellement les moyens d’élargir le cercle. Par exemple, les invitations peuvent être en partie mises à disposition de la Mutuelle. Il s’agit alors, par exemple, d’inviter une voisine qui hésite à venir au théâtre et à qui on propose une première expérience. Un système de gratuité sélective jusque là constitutif de l’aristocratie culturelle se transforme en vecteur de démocratisation.
La Mutuelle s’appuie sur le puissant mouvement de l’économie sociale, sur une histoire, sur une alternative déjà à l’œuvre. Elle rencontre des enjeux fondamentaux de la société contemporaine et y raccorde le développement culturel.
La Mutuelle peut constituer une vraie force autonome avec laquelle les pouvoirs publics devront compter. Dans une ville où les mutuelles de public réunissent deux ou trois mille personnes, il est plus difficile de baisser la subvention du théâtre. Dans les crises comme celle des intermittents, une union des mutuelles de spectateurs desserre le face à face ravageur entre professionnels de l’art et pouvoirs publics ou privés. Elle ouvre la voie à des alliances articulées entre professionnels et publics, à des formes d’action nouvelles.
Des mutuelles de publics peuvent se construire autour d’institutions théâtrales, mais aussi de compagnies. On peut en imaginer dans les médiathèques publiques ou autour d’éditeurs hors système. L’idée commence à faire son chemin. Elle rencontre aussi de fortes résistances : autorités publiques peu désireuses de voir se constituer des forces sociales autonomes ; directeurs d’institution craignant que la mutuelle ne pèse à la façon de l’audimat ; forces politiques et syndicales méfiantes devant un mouvement mutualiste qui s’est largement laissé contaminer par les critères capitalistes…
c/ L’utopie du hors marché
Il se passe quelque chose du côté de la poésie. Cet art prestigieux se porte bien. Il est très pratiqué. Il bénéficie statistiquement de l’élévation globale du niveau culturel. Mais il est en train de se configurer d’une manière qui donne beaucoup à réfléchir sur le rapport entre la société et la création. Dans leur écrasante majorité, les poètes n’espèrent pas monnayer leur production à un niveau qui leur permette de s’acheter ce qu’il faut pour vivre. Ils pratiquent leur art à côté d’activités « alimentaires ». La poésie est presque entièrement rendue à la libre activité, celle qu’on exerce dans le temps libre. Dans la majeure partie des cas, l’édition de la poésie n’est pas capitalistiquement rentable. Elle est donc très souvent assurée par des éditeurs artisanaux dégagés du critère du taux de profit. La poésie s’échange aussi beaucoup dans les rencontres ou par Internet. Son histoire devient floue. Son embrigadement dans une histoire vectorielle à podium est de plus en plus malaisé. La poésie s’invente d’autres histoires, réseaux qui se rencontrent, se contaminent, se séparent. Sous cette nouvelle configuration, les classements impériaux s’affaissent. La parole poétique d’un griot malien échappe à l’obligation de classement dans l’histoire unique, ce qui revient toujours à un déclassement en arts et traditions populaires, arts premiers ou musique du monde.
Cette évolution de la poésie rencontre une des plus puissantes utopies sociales, celle qui s’exprimait naguère sous la revendication alors inscrite dans les statuts de la CGT : abolition du salariat ! Poésie. Voilà qu’un pan prestigieux de la production humaine peut se vivre hors marché. De a à z. Activité ou travail non monnayés, échange et jouissance non marchands. L’utopie à l’œuvre est celle d’une répartition complètement différente de l’activité humaine, avec la plus grande part vouée à la libre activité, la moins importante et la plus subalterne à l’activité vendue. Longtemps, cette répartition a été socialement distribuée entre ceux pour qui « travailler c’est déchoir » et ceux que le régime social condamnait à un vie de labeur contraint. Le mouvement social, la hausse de la productivité et la diminution déjà effective du temps de travail vendu permettent d’envisager un partage tout à fait nouveau dans l’histoire humaine : la semaine de deux jours, et le restant voué à la libre activité ! On voit bien les liens qu’entretient la vie culturelle avec l’idée même de libre activité. On comprend aussi qu’un grand nombre d’artistes ou de créateurs « professionnels » verraient dans ce nouveau partage du temps et de l’argent une transformation miraculeuse de leurs conditions d’existence. On peut enfin imaginer que cet état de fait ouvrirait de vraies perspectives culturelles à des millions de gens qui aujourd’hui n’y pensent même pas.
Cette évolution à l’œuvre, directement articulée avec les luttes sociales contre le travail contraint, porte un bouleversement possible dans la manière d’envisager la place de la culture et de la création dans l’existence humaine. Elle rend déjà problématiques de vieux couples d’opposition très liés à la segmentation sociale : professionnels/amateurs, acteurs/spectateurs, culture savante/culture populaire… Elle rencontre l’opposition déterminée du marché capitaliste intéressé à engloutir le maximum de temps humain dans la danse des marchandises. Chacun peut comprendre que le capital travaille à faire passer pour du temps perdu la libre activité et la potentielle explosion de culture qu’elle porte en elle. Quant à nous, regardons attentivement l’herbe qui pousse dans les fissures du béton.
[1] A noter que le marché ne néglige pas ce critère par principe. Il le met même en scène dans certains arts dont la commercialisation joue sur la rareté (marché des arts plastiques). Le critère de l’histoire de l’art fonctionne alors comme instrument de raréfaction permettant d’écarter du marché la grande masse des œuvres qui ne trouvent pas place sur les branches de l’arbre généalogique. Mais l’industrie capitaliste de la culture sait aussi, en fonction la cible, jouer sur toute la gamme des critères : notoriété, lien à l’actualité, capacité à divertir, etc.
[2] Auteur de la littérature orale malienne contemporaine.
Jean-Louis Sagot-Duvauroux, philosophe et dramaturge :
« Il faut desserrer le rapport marchand dans le domaine culturel. »
L’affût : Dans un monde dominé par les échanges marchands, vous plaidez pour la gratuité. N’est-ce pas un peu irréaliste voire utopique ?
Affirmer que notre monde et surtout notre existence sont dirigés par les rapports marchands est, selon moi, une illusion d’optique. Nous nous organisons certes pour gagner de l’argent, mais tous les efforts que nous faisons le sont pour consacrer du temps à ce qui est sans prix dans notre existence. Si on y réfléchit bien, la part des biens produits hors marché, gratuitement (comme s’occuper de ses enfants ou prendre soin d’un ami malade, par exemple), est énorme. Simplement, le poids imposé par le marché est tel qu’il réussit à nous faire croire ou nous faire dire que ce qui n’est pas évaluable monétairement ne vaut rien.
L’affût : Quelle valeur et symbolique attribuez-vous à la gratuité concernant la culture ?
Prenons l’exemple des musées, dont la plupart sont payants en France et gratuits en Angleterre. Quand vous payez 10 euros pour entrer au Louvre, vous ressentez le désir d’en avoir pour votre argent, vous allez vous épuiser dans cet immense musée et vous mettre dans une position qui n’est pas la meilleure possible pour apprécier le bien que vous intériorisez. En revanche, vous pouvez passer dix minutes à la National Gallery de Londres, revenir le lendemain et y rester plus longtemps pour revoir un tableau qui vous aura frappé. Vous avez là une forme d’accès beaucoup plus appropriée que celle qui donne le sentiment que l’on achète quelque chose. Actuellement, on constate une tendance à la marchandisation de l’imaginaire de la culture et on trouve normal que l’art soit considéré comme une marchandise. Le rapport marchand sur la question culturelle doit véritablement être remis à sa place. La culture étant le lieu de la production du sens symbolique, dans de nombreuses civilisations il était et il est encore impensable que la culture soit payante. Je pense au théâtre dans la Grèce antique et aujourd’hui en Afrique où payer pour assister à un spectacle est imaginable. La gratuité nous rappelle que la production du sens et son existence n’ont pas de prix.
L’affût : Comment mettre en œuvre la gratuité dans le secteur culturel ?
En premier lieu il faut que la question de la gratuité soit toujours posée, et ensuite la résoudre en fonction. Il n’existe pas de solution unique et surtout, la gratuité ne saurait être une baguette magique. En revanche, desserrer le rapport marchand, faire en sorte qu’il ne submerge ni l’imaginaire ni la relation matérielle à la vie culturelle, est très important. Et dans ce desserrement, l’une des possibilités est la gratuité, pas toujours adaptée mais qui peut l’être, par exemple, dans le cas des musées. Dans le théâtre que je dirige [Le Théâtre de l’Arlequin à Morsang-sur-Orge (91), ndr], je n’ai pas mis en place la gratuité mais une tarification à 2,5 ou 10 euros, au choix du spectateur. L’effet provoqué est très intéressant : les gens savent qu’ils n’achètent pas une marchandise mais participent à une fonction sociale qui coûte de l’argent. Le fonctionnement des théâtres est aujourd’hui financé à 80 ou 90% non par la billetterie mais par la subvention. Il est possible, par exemple, de faire deux représentations de moins et le budget s’équilibre. Nous ne sommes pas dans une nécessité comptable qui ferait qu’on ne peut modifier la politique tarifaire.
L’affût : Cela suppose une plus grande intervention de la puissance publique, alors même que les subventions de l’État et des collectivités territoriales accusent une baisse…
Si les subventions baissent, c’est aussi parce que le sentiment public l’accepte d’une certaine manière. C’est une question de politique, de vision de la société qu’il faut développer. L’idée de financer les musées afin qu’ils soient libres d’accès relève simplement d’un choix sur le plan des politiques publiques. Certains pays le font, ce qui prouve que cela est possible. De plus, si vous rendez les musées gratuits et que vous augmentez de 50% votre fréquentation, l’argent investi par la collectivité est beaucoup plus rentable. On doit se reposer des questions politiques et notamment : veut-on que le marché ait moins de poids dans notre existence ? Si oui, réfléchissons à la gratuité. Elle présente d’énormes avantages, a apporté beaucoup à l’école, à la sécurité sociale, etc. et va conduire les gens à entretenir un rapport différent avec la culture.
L’affût : Cette gratuité peut-elle concerner l’ensemble des disciplines artistiques, et s’exercer à l’égard de toutes les catégories de publics ?
La généraliser à toutes les disciplines serait irréaliste. Certains spectacles sont faits pour être gratuits, par exemple dans les arts de la rue qui constituent un point de fuite très important du rapport marchand. Pour d’autres disciplines telles que le théâtre, la gratuité peut provoquer des perturbations, avec des spectateurs qui entrent, regardent le spectacle durant deux minutes et ressortent. Il existe des solutions intermédiaires, comme celle que j’ai adoptée dans mon théâtre, qui présente plusieurs caractéristiques de la gratuité. La principale est qu’elle ne reproduit pas, comme cela est le cas avec des tarifs proposés aux personnes à faibles revenus, aux jeunes, aux séniors, etc. la segmentation très négative de la société. Grâce à la gratuité ou un prix symbolique, le smicard comme le millionnaire sont accueillis de la même manière dans un théâtre. Je pense que la gratuité présente un intérêt précisément quand elle n’est pas réservée à une catégorie de publics mais généralisée. Que les services publics soient égaux pour tous fait du bien à la société. Cela contribue à modifier la composition sociale du théâtre, car les spectateurs issus des classes populaires notamment ne se sentent plus mis de côté parce qu’ils ne pourraient payer le tarif normal, mais respectés.
Les utopies à l’épreuve de l’art
Jean-Louis Sagot-Duvauroux
L’île
Il achète une péniche dans un temps où ça ne se fait pas encore quand on n’est pas marinier. Il habite sa péniche. D’abord en ville. Un jour il part. Les péniches voguent sur l’eau douce. La mer est leur indépassable horizon. Les fleuves se jettent dans l’horizon, mais ils s’y perdent. Les péniches ne vont pas si loin. Les plus aventureuses accostent à vue de la grande barrière salée.
En bout de sa course, le Rhône pousse des eaux métalliques vers le bleu de mer. Il longe ou cerne des terres éparpillées, spongieuses. Les industries qui bordent ce coin de Camargue ont volé la nuit. Les étoiles sont mangées par la lumière orangée des torchères. Les moustiques s’en moquent. Ils sont restés.
C’est là qu’un jour la péniche fixe son destin, au bord d’une île alluviale au statut juridique incertain inondée par les crues plusieurs mois dans l’année. L’île n’est ni bucolique, ni champêtre. Dans une petite anse, des troncs amoncelés la rongent, béliers inlassables et têtus mus par l’agitation des eaux et qui auront un jour raison de cette langue de boue. Les mulets, poissons-veaux, remontent de la mer imminente. Ils jaillissent et retombent à plat dans l’eau grise, se font parfois prendre au carrelet, puis manger. La végétation grêle, interdite d’enracinement, hésite entre figurer les aulnaies d’ici ou les mangroves d’au delà des mers.
Port-Saint-Louis, malgré son nom chevaleresque et sa tour d’autrefois, est une ville moderne et populaire, antipittoresque au possible. Quand le crépuscule arrive et qu’on quitte son univers orthogonal pour se rendre sur l’île en bateau, le flot semble presque menaçant. Les soirs d’hiver, où la nuit tombe vite, il paraît que les courtes lames de cobalt écrêtées par le mistral transpercent les passagers jusqu’à l’os.
Il existe une parenté entre Utopie et No man’s land. L’utopie n’a pas d’espace dans les lieux cartepostalisables. Le destin de Venise est clos. L’île qui fait face à Port-Saint-Louis restait ouverte à tout.
J’y suis allé un soir de printemps et m’y suis trouvé plongé dans un rêve tenace de l’enfance. D’abord, c’est loin. Non pas « loin de ». Loin tout court. Au sens où partout dans le monde certains lieux marquent leur distance avec ce qui communément nous attire, tandis que d’autres au contraire sont immédiatement proches, nichés dans les habitudes et dans les goûts dont nous avons hérité. Les enfants cherchent ce loin-là – souvent le fond du jardin – et ils y font leurs cabanes. Loin des regards prescriptifs et des raisons consacrées. « Campement de romanichels » disait notre mère, dans une irritation qui paradoxalement ricochait dans nos rêveries en roulottes bariolées et en voyages indéfinis. Les outils, les matériaux – branchages pour les parois, feuillages pour les rideaux, mousses en guise de moquette – traînaient partout, rappelant qu’en matière de cabanes enfantines, l’imaginer, le faire et l’habiter sont synonymes. Hélas, les huttes de Nifnif et de Noufnouf ne résistent ni au loup, ni au vent, ni au temps. Et la plupart des petits cochons, quand ils grandissent, se laissent finalement dévorer par le F3 cosy du prévoyant Nafnaf.
La cabane jamais ne devient maison parce qu’elle est un désir de maison, une demeure virtuelle qui poursuit ce rêve dont on dit qu’il traverse les nuits de presque tous les humains, la maison fantasmée, explorée, éternellement meuble et plastique où nidifie notre inconscient. C’est vrai pour Robinson Crusoë, pour les enfants de fond de jardin. C’est vrai, d’une autre façon, pour la cabane construite dans un bidonville en attendant l’attribution d’un logement HLM. C’est vrai pour les habitants de l’île, qui imaginent et font et habitent leur cabane, mais peu à peu la doublent d’une maison sur la terre ferme. Chez-soi encore non sédimenté, où tout encore reste signe vivant, vibrant, où tout est appel encore meuble du désir de chez-soi.
Bruno Schnebelin, l’homme à la péniche, a une taupinière pour abri, une motte de polyuréthane creusée de recoins, de hublots, de baies courbes et d’électricité solaire. Cabane adulte où le prenant désir de logis qui habite nos rêves enfantins est servi par la technicité non d’un enfant, mais d’une grande personne au savoir-faire éprouvé. La fragilité consubstantielle aux huttes enfantines n’est pas abolie pour autant : chaque année, l’eau du fleuve s’y installe et les meubles doivent alors se poser sur échasses pour échapper à la corrosion. C’est en regard du vent qui les emporte, des boues qui les menacent ou des loups qui les cernent que les cabanes métamorphosent le confort en signe poétique, qu’elles le transfigurent, le démultiplient et le libèrent de ses fonctions d’engourdissement.
Ça et là, le long de la berge qui fait face au parc de Camargue, pourrissent les ruines d’embarcations défaites. Après Bruno, d’autres se sont échoués-là. Chacun son rêve et chacun sa cabane. Telle posée sur le fleuve comme une araignée d’eau pousse au dessus des flots son bec de plexiglas – la chambre à coucher. Telle autre enfouie dans la végétation mime les simples cabanes. Aucune harmonie entre elles. Aucune recherche d’harmonie. Chacun chez soi et l’île pour tous.
L’île fut naguère, racontent ses habitants d’ailleurs peu bavards, un poulailler pullulant. Paons, poules, pintades, dindons et même nandous piétinant, raclant, retournant, fécondant le sol boueux. La nuit, cette volaille musclée se perche sur les branches pour échapper aux fouines qui darwinisent avec entrain leur criarde communauté. Le jour, elle plume le sol de tout brin d’herbe. L’île d’alors est noirâtre. Mais ni les mers, ni les fleuves n’arrêtent ceux des oiseaux qui savent voler et les règlements sanitaires ne reconnaissent pas l’autonomie des îles. Quand la peste aviaire commença à faire craindre les sternes, les courlis ou les bécasses de passage en Camargue, l’île dut égorger l’un après l’autre les centaines de volatiles amicaux qui, dit-on, se laissèrent saisir et saigner par des bipèdes qu’ils avaient connus débonnaires. Depuis, une herbe maigrelette a repoussé et les fouines sont au régime.
PLM n’est pas une notice explicative
À ma première rencontre avec l’équipe d’Ilotopie, la conversation se fixe d’abord autour d’un spectacle – mais le mot convient-il ? –, dont il m’apparaîtra plus tard qu’il est faussement limpide. À dire vrai, il est assez énigmatique. PLM, Palace à loyer modéré.
Ça se présente au premier abord comme une bonne idée, une idée ronde, cernée, une fable de gauche à morale progressiste. Devant l’entrée d’une barre HLM dans une cité populaire de Marseille est installé durant neuf jours un hall de palace avec grooms, femmes de chambre, chauffeurs de maître et musiciens d’ambiance. Les habitants de l’immeuble bénéficient gratuitement de ce luxe momentané. Croissants chauds et limousines sont à leur disposition sur simple appel téléphonique. Le soir, beaucoup s’habillent, descendent au milieu des dorures s’asseoir sur les banquettes de velours rouge et savourer leur accession momentanée aux signes extérieurs de richesse. Utopie sociale habilement mise en scène ? Provocation situationniste ? Dénonciation du déséquilibre structurel dans la répartition des richesses ? Ce sont en effet les premiers parfums qui affleurent et qu’on sent.
Plus tard, dans de tout autres circonstances, j’évoque avec une amie d’extrême gauche mon implication dans le livre qui se prépare sur Ilotopie. Immédiatement, elle fait la moue. « Es-tu au courant, me dit-elle en substance, de la saloperie qu’ils ont faite dans un quartier de Marseille ? » Elle parlait de PLM. Ainsi, ce qui m’était apparu dans le flou du premier abord comme une parabole transparente, clairement raccordée aux espoirs de ceux qui veulent un autre monde pouvait être ressenti par certains d’entre eux, dont l’opinion m’importait, comme une provocation réactionnaire, une insulte faite aux pauvres.
L’erreur – mon erreur et celle de mon interlocutrice – avait été de prendre PLM pour une fable morale, l’illustration d’une utopie sociale, une astuce de communication au service d’une cause, un calicot appelant à se mobiliser pour demain. L’utopie comme solution, non pas un vœu d’aller ailleurs irrigué par l’imagination et dérivé par les rencontres aléatoires, mais la remise à l’endroit, la réparation d’un monde mal fait. L’utopie portée par le réel comme la nuée porte l’orage, lue dans le réel, déduite du réel comme on déduit la solution d’une énigme mathématique, l’utopie tout entière en germe dans l’œuf du réel. Or cette utopie-là, cette conception-là de l’utopie, peut efficacement porter des révolutions héroïques, mais elle est impropre à dépasser les mécaniques de pouvoir renversées par les héros. Nous l’avons vu. Les révolutionnaires de ces révolutions-là n’ont fait que culbuter les pouvoirs – ils disaient parfois : remettre les choses à l’endroit – quand il aurait fallu prendre son balluchon et s’en dérouter. Les tête-à-queue des petits personnages de culbuto finissent un jour par se figer en soldats de plomb.
Ce qui caractérisait d’abord PLM, ce n’était pas le sens social aveuglant de la fable, la généralité d’un discours sur la société, mais au contraire la singularité et l’éphémère d’une mise en forme : cet immeuble-ci, dans cette cité, avec ces corps d’acteurs et non pas d’autres, ces choix de costumes, ce kitsch particulier, ce budget et les ruses qu’il avait fallu pour l’obtenir, ces habitants, ceux de l’immeuble et ceux des barres voisines, leurs accents, leur timidité ou au contraire leur assurance, leurs colères imprévisibles et leur conversion non programmée, ce temps de montage, ce démontage neuf jours plus tard, non pas dix, non pas huit, l’effet singulier de ces signes insolites non pas en général, mais dans ce paysage-là, pour ces humains-là.
Donc, nous pouvons imaginer une autre figure à nos vies, à nos lieux. Et l’ayant imaginé, nous pouvons l’inscrire dans le dessin de nos existences. Non pas comme mode d’emploi. PLM n’a pas été le mode d’emploi, la notice, la prescription d’un autre monde à construire. PLM a été la proposition d’un moment d’utopie vivante, chacun étant placé devant la responsabilité de s’en saisir ou non. Ou de la rejeter.
Modification des lieux produite par l’art de modifier les lieux (arts de la rue ?)
L’île (2)
Ni la maladie des oiseaux, ni l’heure des crues ne sont programmables. Il faut faire avec. Et ces imprévus toujours percutent le programme. L’utopie, quand elle se constitue non pas en théorie, mais en direct, est percutée par ces événements imprévisibles. Des humains choisissent de se construire un autre lieu. Ils en trouvent le plan dans le magma sans fond de la fantaisie imaginative, magma dont les laves épousent et transforment non pas l’univers abstrait des idées, mais les formes singulières des paysages traversés. L’île à la taupinière de polyuréthane est un fruit de ces éruptions. Mais elle ne va pas seule. Sans doute ne pourrait-elle pas tenir seule.
Dans la même durée, beaucoup des îliens ont construit sur la terre ferme le double de leur cabane, mais sous forme cette fois de maisons. Belles demeures camarguaises de Bruno, de Françoise. L’utopie des cabanes y a déposé ses alluvions. Il n’est pas difficile quand on découvre comment ces maisons s’organisent d’y reconnaître la trace des histoires sédimentées, comme dans la découpe d’une falaise de calcaire on peut lire, sous forme de coquillages pétrifiés, la trace apaisée d’océans disparus. D’ailleurs les maisons de terre ferme se sont concrètement ajoutées aux cabanes ilotopiques pour bénéficier d’utopies sociales anciennes, institutionnalisées par un processus analogue : l’école pour les enfants, la proximité de soins médicaux pris en charge par la sécurité sociale, la domotique contre les servitudes ménagères.
La lumière est double : celle, dans le filament de l’ampoule, dont nous sommes le combustible ; celle que diffuse l’ampoule et qui nous éclaire. Pour voir dans l’obscurité, nous ne devons pas craindre de produire nous même de la lumière, accepter parfois de nous laisser porter à incandescence. Mais il faut aussi savoir prendre le temps de s’asseoir sous la tranquille clarté que répand cette brûlure. Il en va ainsi de la passion d’amour, aveugle, incandescente, mais qui sait aussi prendre sens dans la patiente édification d’une vie commune, dans le sage refus de la tragédie. Apprendre à bien vieillir, à vieillir vivant.
Jeux de société, jeux d’eau
Je travaille beaucoup sur les utopies politiques et sociales : la gratuité, le dépassement des oppressions identitaires, l’émancipation humaine… Ce pli est certainement la cause de ma première erreur : avoir spontanément – et faussement – interprété PLM comme la notice explicative d’une utopie sociale restant à construire. De cette erreur en découle une seconde : Ilotopie première manière serait un bataillon d’agitateurs politiques. Et une troisième : lire dans son élégante dernière période un assagissement, une coda esthétisante, apolitique, après les provocations subversives des commencements. Les spectacles aquatiques des dernières années sont élégants et frontaux, sauf bien sûr pour les poissons et les oiseaux de mer que d’ailleurs ils dérangent.
Entre PLM écorchant la grisaille routinière des cités avec la complicité nécessaire des habitants et Narcisse guette, méditation délicate posée sur un miroir d’eau devant un public sagement assis sur la rive, il y a quinze ans d’écart. Le propos, l’univers imaginé, le positionnement des spectateurs, rien ne semble coller. Sauf la persistance de l’énigme.
L’histoire d’Ilotopie est rythmée de simili-slogans. Le premier, le plus célèbre, est une invitation sibylline : « De l’art dans vos épinards ». Voilà une phrase qui d’une certaine façon ne veut rien dire, pied-de-nez gouailleur, jeu de mots approximatif, volatil. Et pourtant, c’est bizarre, sans pouvoir l’enclore dans une explication satisfaisante, on a l’impression d’en comprendre quelque chose, le sentiment d’une signification diffuse, d’une vraie justesse. Rhétorique de l’imaginaire.
La coloration sociale de PLM, la savante et bucolique mélancolie de Narcisse guette, on aurait bien envie de tout de suite les caractériser, d’en donner la clef, mais quand on s’en approche, l’acte poétique semble se refuser à nos hâtives catégories. Et si, dans l’un et l’autre cas, il s’agissait tout simplement d’ouvrir le sens des paysages, de fissurer leur cohérence institutionnalisée pour y laisser pousser l’invention encore indéfinie de nouvelles significations, de symbolisations inédites, pour suggérer en pratique, pour mettre à l’épreuve le sentiment qu’on peut vivre autrement, s’autoriser à vivre d’une façon dont le programme n’est encore donné nulle part ? Y a-t-il rupture d’inspiration quand les artistes d’Ilotopie reproduisent sur un étang de Camargue le miracle de Jésus marchant sur les eaux, après qu’ils ont accompli quinze ans plus tôt la prophétie du sermon sur la montagne en ouvrant les portes du royaume aux locataires d’une HLM de Marseille ?
Entre les deux miracles, peut-être ne faut-il voir qu’une simple différence de topographie. Peut-être une simple migration d’une topographie vers une autre, une simple étape dans la promenade aléatoire de ceux qui font Ilotopie. Bruno dit qu’il n’aime plus les villes, qu’il a du mal, aujourd’hui, avec le paysage qui se fait dans les villes. Françoise s’attache à cette Camargue où elle est venue, qu’elle aime faire vivre, animer. Il n’en font pas une religion. C’est venu comme ça, comme une péniche se fixe pour un temps sur cette berge là plutôt qu’une autre. Évolution non programmée. Changement de goût.
On dira : c’est de l’art. Il arrivera même qu’on dénigre : ce n’est que de l’art. On oubliera souvent que justement, l’art, c’est du concentré de réel humain vivant, c’est-à-dire, avec quelques autres « champs d’expériences » spirituels ou éthiques, ce qu’il y a de plus réel, de plus vivant dans l’ordre de l’humain : l’espace où l’humain s’invente (autre sens d’utopie ?). Certes, il y a aussi la terre ferme, l’humain naturalisé, pétrifié, la maison de Nafnaf, le dictionnaire de l’Académie française, les ruines de Rome, l’humain sédimentaire, le dépôt solidifié de ce qui fut vivant et qui constitue la presque totalité de notre humanitude. Certes, ces continents hérités nous semblent souvent plus sérieux, en tout cas plus confortables, plus épais, plus assurés dans leur réalité que l’émergence indéchiffrable de la vie.
Au dessus de la falaise pétrifiée, il y a la frange herbeuse, vivante. Cette frange en effet n’est presque rien. Mais sans elle, rien. Sauf des traces mortes.
Il n’est pas impossible que ces moments d’art, PLM comme Narcisse guette, Le jugement dernier de Michel-Ange sur le mur de la chapelle Sixtine ou le chant râpeux des chasseurs mandingues soient la vraie patrie de l’utopie, le seul espace où elle s’inscrit dans le réel sans se perdre, sans risque de se transformer en son contraire. Il n’est pas impossible que la politique soit inapte à traiter sans danger l’utopie, surtout la politique polarisée comme elle l’est aujourd’hui autour de la conquête de places dans les pouvoirs publics. Embrigadées dans des enjeux de pouvoir même honnêtes, déclinées sous forme de programmes même révolutionnaires, puis appliquées par des bureaucraties même « de service public », les séductions d’un monde rêvé deviennent vite totalisantes, totalitaires. Voici ce qui est bon pour vous, pas autre chose ! En politique, l’utopie utile est ténue, une tension, une esquisse. Pour qu’elle serve, elle doit laisser le champ à l’invention qui ne se fait pas sur dossier, mais en marchant, ce qui implique qu’elle ne peut être d’avance trop précisée dans un programme, trop déduite de principes pré-existants. Libérer l’accès aux soins de santé est une belle, mais vague idée. Inventer le dispositif de la sécurité sociale se fait dans le feu de l’action, sur les séismes que provoquent l’occupation nazie, la Résistance, la Libération, avec les forces et les lourdeurs de la civilisation française et non la pure idéalité des idées justes. Aussitôt faite, aussitôt naturalisée par les esprits, la « sécu » cesse d’être une utopie. Elle devient un bon dépôt de l’histoire. Elle s’incruste dans le paysage.
Pour faire vivre l’utopie, pour la rendre utile en même temps que belle, peut-être faut-il inventer une alliance nouvelle entre l’art et la politique, une articulation où jamais l’un ne puisse devenir l’instrument de l’autre. L’utopie de PLM ne dit pas : les HLM devraient avoir des halls de palace. Elle en construit l’expérience bizarre, vivante et momentanée, puis elle en dépose la trace, la nostalgie dans les âmes. Comme l’ont laissée en nous les cabanes de notre enfance. Elle ameublit l’âme et la laisse en liberté. Elle ouvre l’imagination sans quoi les mondes nouveaux ne naissent jamais. Elle ne dessine pas des figures que la politique devrait reproduire. Elle dit à la politique : autorise-toi à imaginer !
Après Duchamp
Faire l’artiste chez Ilotopie, très souvent, c’est habiter des lieux insolites et deviner, avec les passants, ce que ça donne. « La vie en abribus - 1984 » : une petite famille d’acteurs installe ses jours et ses nuits sous la protection du mobilier urbain. « La mousse en cage - 1987 » : enfermés dans des volières à taille humaine, des personnages se laissent envahir par la mousse de polyurétane. « Champ d’expérience premier - 1993 » : habité de scènes étranges, un immeuble de quatorze étages et quatre vingt quinze pièces s’offre à l’exploration du public. « Réseaux Eden sous-sol - 1996 » : labyrinthe creusé dans la terre, terrier. « Confins - 2004 » : cockpits en fuseaux entrecroisés sur un trottoir de ville. « Fous de bassin - 2005 » : véhicules-habitacles à la surface de l’eau. Cabanes, cabanes, cabanes…
La cabane toujours joue avec le loup. Elle est faite pour nous rapprocher de la bête sauvage autant que pour nous en protéger. Ce refuge de l’intime n’est rien sans la bête sauvage. L’extrême dedans face à l’extrême-dehors. Dans les lotissements, pas de bêtes sauvage, pas d’extériorité. Dans les lotissements, l’intime et l’espace public se confondent. Même fonction. Même esthétique. Même régularité. Même clôture. On ne dit pas : c’est un lotissement avec dedans des maisons style lotissement. Lotissement se suffit à soi même. Ça dit tout. Ça dit la maison et ça dit la rue, l’art de la maison et l’art de la rue. À l’inverse, on peut dire : voici une île où il y a des cabanes. L’île est changée par la cabane qu’elle porte. Elle vire de sens, mais à cause de la cabane qui n’est ni maison, ni musée, ni club de vacances, elle reste île. Le paysage change de signification, mais il survit. D’ailleurs on dira sans y penser que Robinson habite une île déserte, ce qui est un abus de langage, puisque l’île, justement, n’est plus déserte depuis qu’elle porte la présence de Robinson et de Vendredi. Et pourtant, ça sonne vrai ! L’île occupée par les lotissements des tour operators cesse d’être île. Elle devient club de vacances. La cabane ajoute du romanesque à l’île, mais elle respecte son insularité.
Comme le théâtre, la rue désigne à la fois un art (une famille d’arts, un mouvement d’arts) et le lieu qui l’abrite. Mais il y a « du » théâtre en dehors « des » théâtres et il y a « de la rue » hors la rue. Arts de la rue ? Admettons. Il fallait bien une dénomination pour que les administrations publiques puissent se mettre en mouvement. Ilotopie entre dans la catégorie aministrative « arts de la rue ».
Arts dans l’espace public ? Admettons derechef. C’est bien, l’espace public. C’est important. Mais ce n’est pas une catégorie artistique, c’est une notion juridique. Et sur tout ce qui est juridique, le pouvoir a son mot à dire. Espace possédé par une personne publique, géré par un pouvoir public, ouvert au public sous réserve du respect des règles édictées par les pouvoirs publics. L’espace public n’est pas un no man’s land. D’ailleurs, quand des pouvoirs publics se laissent obnubiler par les règles de la possession privée – ce qui est aujourd’hui leur pente –, les règles qu’ils édictent pour l’espace public ressemblent à celles qui régissent les parties communes d’une co-propriété privée. L’espace public est à coup sûr un objet privilégié pour opérer le type de métamorphoses habituellement rangées sous la dénomination « arts de la rue ». Mais pourtant, il ne suffit pas à bien caractériser ces moments d’art. Chez Ilotopie, l’échappée hors des sites administrativement préconisés est récurrente. Il faut donc tenter une définition moins extérieure, moins liée aux catégories administratives.
Par exemple, on se souviendrait que le sens est la marque de l’humain et on en irradierait les paysages. Paysage privé, public, commun, urbain, rural, peu importe. Paysages pré-existant à leur irradiation. Paysages transformés à jamais par cette irradiation de signes, de sens.
Tous les paysages sont aptes à se gorger de signes. Après la mort de ma mère, son corps fut placé dans le funérarium de l’hôpital Bégin où elle avait vécu ses derniers jours, en face du lac de Saint-Mandé, dans le bois de Vincennes. Ce paysage, l’existence nous l’avait déjà badigeonné d’une première couche de sens : c’est là que maman nous emmenait en promenade quand nous étions enfants. L’Absence, dont le cadavre d’une mère est le signe le plus désarmant, s’est ajouté pour moi aux jeux d’autrefois. Elle teinte à jamais les ombrages du petit lac.
Ce que les événements de l’existence produisent sans qu’on l’ait voulu, l’art le re-présente et le condense librement. Art de donner du sens aux paysages. Art d’ajouter un sens nouveau aux paysages. Par exemple, PLM révèle qu’une cité marseillaise est apte à la transfiguration, ce qu’on n’osait croire. Par exemple, l’étang acquis en Camargue par le Conseil général des Bouches du Rhône devient pour une nuit le miroir de Narcisse-le-guetteur et le reste à jamais pour ceux qui l’ont vu.
1917, il y a presque un siècle, Marcel Duchamp propose de clore l’histoire de l’œuvre d’art, c’est-à-dire l’histoire du rapport de l’Occident moderne à l’art, par la voix d’une provocation jubilatoire : un urinoir industriel élevé à la dignité d’objet de contemplation par le sacre d’une simple signature. Inonder un urinoir non pas d’urine, son sens commun, mais d’un sens nouveau, « artistique ». Bientôt, les musées s’arracheront la relique, devenue du fait même un bon placement. Interdit d’uriner dans l’urinoir de sens devenu bon placement. L’urinoir de sens est placé dans un musée, lieu public, et protégé des urineurs d’urine par le pouvoir public chargé d’assurer la sécurité des bons placements. Il y a des procès en cours à cause de ça.
L’Occident, ogre naïf et postmoderne, a choisi de se peindre en fin de l’histoire. Mais en dessous, ça pousse trop fort pour qu’on s’en arrête là. Alors, fatalement, le point final se métamorphose en point de suspension.
Imaginons que la proclamation ne se fasse pas sous la forme de l’urinoir irradié par la provocation salutaire de Duchamp, objet finalement très muséographiable et très bégayant, mais que l’irradiation porte sur un paysage tout entier, qu’après le retrait du rayonnement, le paysage retrouve à peu près sa forme et son usage anciens, sa vie propre, et qu’il en reste cependant comme magnétisé, humanisé (arts de la rue ?)
Ilotopie, compagnie estampillée « arts de la rue », entretient un rapport très aléatoire, désinvolte à l’espace-rue que lui affecte la nomenclature administrative. L’important semble être dans l’irradiation d’un espace qu’on peut électriser, mais dont il est impossible de faire « son œuvre ». Par exemple la rue, ou encore l’étang du Conseil général des Bouches-du-Rhône, ou tout autre espace métamorphosable en fontaine de symboles. L’art d’Ilotopie n’est pas caractérisé par un type de lieux, mais par un certain rapport à des lieux de tous types. Ce rapport, la plupart des compagnies dites « de rue » l’établissent elles-aussi, même implicitement, avec les endroits où elles déploient leur art. Mais Ilotopie en fait en quelque sorte son programme, sa grande liberté. Si l’art est dans le rapport de sens qui s’établit avec un espace – un espace qui préexiste à ce rapport et qui lui survivra –, si l’œuvre n’est pas un objet, si l’œuvre n’existe que dans l’acte, dans le moment où du sens est volontairement conféré à un espace, c’est-à-dire à un moment d’existence pour ceux qui sont placés dans cet espace, alors quelque chose de l’intuition de Duchamp sort du bégaiement. Interdit d’uriner dans l’urinoir muséographié ! Mais qui empêchera le pêcheur à la ligne d’aller taquiner la brème dans la pièce d’eau où, la semaine précédente, il s’est laissé tourner la tête par les « Fous de bassins ». Le pêcheur et la pêche et la brème subsistent, mais leur poésie s’en trouve à jamais modifiée, enrichie.
Cette ouverture provoque un autre étrange effet. À première vue, difficile de trouver une unité dans le catalogue d’Ilotopie. On se demande même s’il existe une esthétique, un style Ilotopie, style au sens où d’œuvre en œuvre on reconnaît sans peine la grâce des vierges de Botticelli, le ton des amants durassiens, les mélodies marines de Claude Debussy ou la classique élégance des façades dessinées par Mansart. Qu’est-ce qui réunit l’habillage réaliste et goguenard de l’Autobobus avec le graphisme abstrait du Labyrinthe calibreur ? Quelle parenté entre les simples corps peints des Gens de couleur et la monumentale machine-tunnel des Liaisons capitales ? Comment faire le lien entre l’observation mise en scène de son propre anus absorbé par la défécation (Théâtre des commodités) et la grâce de mirages technologiques glissant au fil de l’eau (Le fleuve étonnant) ?
Avançons l’idée qu’il y a du ready made dans l’art d’Ilotopie, et plus généralement dans la visée des arts de la rue. « L'attitude du ready-made consiste à choisir un objet manufacturé et à le désigner comme œuvre d'art » (Wikipedia). L’objet n’est pas représenté. Il est là. L’objet n’est pas l’œuvre de l’artiste qui le signe, qui le dé-signe. L’artiste invite à le voir autrement et c’est l’acte de le regarder qui vire de sens. Mort de l’œuvre.
Avançons l’idée qu’une inspiration de même nature, qu’une tension analogue est à l’origine du déport d’artistes de théâtre ou de plasticiens vers « la rue ». La rue est un paysage qu’il n’est pas absurde de prétendre manufacturé. Un étang du Conseil général des Bouches-du-Rhône n’est pas non plus une pure création divine. On y sent la patte de l’administration départementale, pas toujours très humaine, mais en tout cas très peu divine. L’analogie s’arrête là. La différence de volume entre le ready made de Duchamp et le ready pas complètement made d’Ilotopie bouleverse la donne. La différence de statut juridique aussi. Un urinoir est une bonne vieille marchandise, très disponible à la mise en rayon. Rayons de quincaillerie. Rayons de musée. Les rues, les paysages ou les trous du cul sont trop turbulents pour s’aligner dans les rayons.
Prendre un objet trouvé et le désigner comme objet d’art ? Si l’objet est un paysage, la signature (la désignation) change d’échelle. Avançons l’idée que l’art d’Ilotopie consisterait à signer d’une signature à l’échelle un paysage qui se serait trouvé sur sa route. Dans Gens de couleurs, l’homme peint en rouge qui vient caresser le rouge d’une voiture de pompier provoque chez le passant l’acte de regarder différemment le rouge-pompier, d’ouvrir la carapace de son sens commun et de laisser sourdre la fontaine à désaltérer l’imaginaire.
Le changement d’échelle libère la signature. Envie de chic ? Envie de sophistication ? Envie de drôlerie ? De poésie ? De provocation ? De politique ? Envie que la signature elle-même se re-présente ? Qu’elle prenne la forme d’une représentation ? Pourquoi se gêner ? Impossible dans cette configuration d’être englué dans l’histoire occidentale de l’œuvre d’art dont Duchamp nous suggère qu’elle est épuisée sans toutefois parvenir à franchir ce point final. Duchamp signe « Duchamp ». Il n’y a pas, sur un urinoir, beaucoup de place pour la signature. Ilotopie, les « arts de la rue », eux peuvent s’en donner à cœur joie.
J’habite la région parisienne. C’est Éric qui chaque fois vient me chercher à la gare d’Avignon TGV, puis m’amène dans sa vieille fourgonnette vers le delta du Rhône, sa fourgonnette qu’il aime avec tendresse et qui naguère fut, me dit-il, sa cabane à roulette. D’abord, pas très causant. Ils sont comme ça, à Ilotopie. Ensuite, restrictif : Ilotopie, non, pas complètement ; oui, c’est vrai, j’en suis, mais je suis ailleurs aussi. Ilotopie n’est pas une secte. Au Citron jaune, le désormais « Centre national des arts de la rue » construit sur la terre ferme par la compagnie pénichière, la cloche qui sonne à l’heure du repas indique non pas une habitude de secte soixantehuitarde, mais les impatiences professionnelles de Jeff, bon cuisinier qui n’aime pas qu’on mange froids les plats chauds.
Peu à peu, Éric et moi, nous parlons. Longuement. La route est longue. Il me raconte la Thiérache natale, l’embourgeoisement refusé, l’art de refuser l’embourgoisement, la pâtisserie, premier emploi – mais aucun gâteau dans la fourgonnette –, la famille, admise par défaut, aimée néanmoins, problématique. Le sexe, non, nous n’en parlons pas.
À l’occasion, Éric est acteur chez Ilotopie. Il a longuement hésité à passer du statut de plasticien-Rmiste, qu’il apprécie, à celui d’intermittent du spectacle, moins précaire, moins chiche, mais plus contraignant. Il s’est un jour trouvé pris dans l’art. L’histoire est imprécise. Plasticien ? Comédien ? Difficile à dire.
La première fois que nous nous rencontrons, Éric est dans son rôle d’artiste. C’est au « château d’Avignon », belle propriété publique sans rapport avec le chef-lieu du Vaucluse, où se déroule, sous l’impulsion de Françoise, le festival Envies Rhônements. Il m’en reste le souvenir d’une lumière dorée de jour finissant sous les grands arbres. De petites et calmes foules autour de moments d’art délicats. Récits. Acrobaties. Beaucoup de douceur. Des moustiques et des aérosols antimoustiques. Françoise m’amène vers Éric, désigné pour être mon accompagnateur et mon documentaliste. Tranquille, il attend le chaland auprès de ses boîtes à images vélocypédiques. Le spectateur unique de ce spectacle intime se met en selle, coince son regard dans les oculaires, pédale sur le vélo machiné qui tourne à vide. Au rythme des adducteurs défile un vieux film érotique en noir et blanc. Il y a aussi cette chanson des années 30 que pousse une voix de femme à l’ancienne : « Ah les p’tits cochons, les p’tits cochons, les p’tits cochons, ah qu’ils sont mignons, ah qu’ils sont frais, ah qu’ils sont roses… Ah les p’tits cochons, les p’tits cochons, les p’tits cochons, ah qu’ils sont mignons avec leur queue en tire-bouchon ». À la nuit tombée, derrière le château, se donne le chef d’œuvre de Lotte Reminger, Le prince Achmed, premier long métrage de dessin animé, entièrement réalisé en papier découpé. Les gracieuses silhouettes de ce film muet sont emportées dans des péripéties sans fin au son d’un trio qui joue pour nous en direct. On oublie les moustiques.
Éric aimerait que tous les acteurs d’Ilotopie, les acteurs persistants, les disparus et les intermittents, soient inscrits dans le livre. Mais il est difficile de retrouver les noms. Ça le tracasse. L’île est centrifuge et centripète à la fois. Fusionnelle, non. Beaucoup de silences entre les cabanes. Peu d’obligations, sauf la cloche impérative des repas au Citron jaune, pour ceux qui s’y trouvent à l’heure prescrite.
Les voyages Avignon – Port-Saint-Louis, nous les faisons souvent à la nuit tombante. Faubourgs d’Avignon, faubourgs d’Arles, Alpilles masquées par l’obscurité, lumières industrielles sur la Camargue aplatie. Éric ne sait pas trop me dire ce qui est prévu pour le couchage. Il n’est pas certain non plus qu’il y aura à manger. Nous nous arrêtons devant une pâtisserie-boulangerie-épicerie-charcuterie pour parer à toute éventualité. Moi surtout. Éric ne semble pas préoccupé par le jeûne potentiel dont il a levé la menace.
Inquiétude sans objet. Je dormirai chez Françoise. Tout est prévu. Tout, sauf le gigot, qui est bien là, dépêché par Bruno, mais encore congelé. Françoise coupe du saucisson pour patienter en causant sous la mezzanine.
- Le gigot, vous croyez que je peux le mettre directement au four ?
- Il aurait peut-être fallu le sortir plus tôt du congélateur ?
- C’est vrai.
J’ai faim. L’ambiance n’est pas ascétique, pas vraiment. La maison est belle, l’accueil souriant. Mais il y a comme de la distraction, du jeu autour du gigot qui cuit en même temps qu’il dégèle. Les mots s’entrecroisent courtoisement, mités de légers silences. Comme une inattention, comme une attention plus vaste que le tour de table, une attention à trous d’air. J’ai le sentiment (et la honte) d’être seul à me laisser envahir l’imagination par cette bonne grosse faim de gigot, cette faim ronde qui appelle, appelle la viande même s’il faut la manger approximativement cuite. Bruno est venu dîner avec nous. Il m’observe. Je lui demande s’il a vraiment envie qu’on fasse le livre sur Ilotopie. Il répond oui, distraitement, mais il dit aussi qu’il n’aime pas se retourner, qu’il ne souhaite pas laisser de traces. Françoise plaide pour le livre. À l’heure qui convient, Bruno se retire en famille dans sa maison de terre ferme, juste à côté de chez Françoise. Françoise me montre mon lit, le chemin de la salle d’eau et me tend une serviette de bain.
Bruno pour les lignes de fuite et Françoise remet dans l’axe. Voilà ce qu’au premier abord on croit comprendre. On dirait aussi que ce n’est pas si vrai que ça, la répartition de leurs rôles respectifs. Le rôle d’Éric, le rôle de co-auteur qui lui est proposé pour ce livre, Éric y va à reculons. Il ne veut pas écrire sur commande. Secrétaire de rédaction ? Fourgonettophile ? P’tit cochon camouflé sous des cernes d’épagneul ? Ilotopien se refusant aux îles ? La théorie qui court chez Ilotopie, c’est que les acteurs sont le matériau d’autre chose, le matériau du dessein d’Ilotopie. Simple matériau ? Éléments d’installations plasticiennes façon crèches vivantes ? Mais sortis du rôle d’acteur, c’est tout autre chose. Pourquoi les acteurs-matériau d’Ilotopie ont-ils tant d’arrière- plans ?
Après Duchamp (2)
L’urinoir de Duchamp est enchaîné à l’histoire dont il proclame la fin. L’urinoir de Duchamp est une parole dont l’unique objet est l’histoire occidentale des œuvres d’art. C’est de ça (qui n’est pas rien) et de ça seulement qu’il parle. En prenant peu à peu son autonomie par rapport au roi, au pape, aux grandes causes à défendre, aux grandes saloperies à protéger, aux objets, aux visages, aux dogmes à représenter, l’art d’Occident a ouvert la liberté des formes comme rarement dans l’histoire humaine. Mais à la fin de ce chemin de haute civilisation, il n’a plus trouvé que lui-même à métamorphoser. Faire art est devenu faire histoire dans la lignée occidentale de l’art. Cette histoire s’est épurée, raréfiée jusqu’à sa limite, jusqu’à son ultime frontière. Cette histoire s’est peu à peu présentée en unique critère pertinent pour juger des œuvres d’art : ton œuvre vaut parce qu’elle fait histoire dans l’histoire occidentale de l’art. Elle a décrété l’absolue liberté, l’absolu détachement de l’œuvre d’art.
Mais au moment où toute métamorphose est décrétée possible, l’Évangile des œuvres selon l’Occident cesse d’ouvrir le ciel. Il reste de la place pour imaginer encore des œuvres à la façon de la modernité occidentale, libres de toute attache, mais c’est comme si elles pouvaient au mieux colorier les alvéoles restantes de ce possible désormais clos. Elles ne bougent plus l’histoire, cette histoire. Le concept, immuable et lugubre, l’emporte alors sur la matérialité des formes. Il en boit toute capacité à dire. Il dépossède à son profit les formes matérielles du sens libérateur que portaient encore leur fantaisie quand des interdits restaient à briser. Bras dessus bras dessous, le fétiche-marchandise et la déesse-œuvre-d’art escaladaient l’acropole de la modernité. Longtemps, ils étaient restés demi-dieux, c’est-à-dire moitié-corps. Leur physique provoquait l’appétit des mortels. Les fesses d’Aphrodite ou les calandres des belles automobiles, c’est appétissant. Puis un jour, la finance a pris le pas sur les calandres et le concept s’est substitué à la cambrure. Cette apothéose marque la fin de l’histoire, la fin de cette histoire.
Ni le concept, ni les portefeuilles d’actions ne remplissent le ventre. Mais la faim, la vraie, la faim qui nous fait saliver pour les gigots physiques, la faim ne s’éteint pas.
Françoise dit de « la rue » que ce n’est pas un art, que c’est un mouvement. L’institution théâtrale souvent approuve ce point de vue (pas toujours), mais dans une autre intention : je suis art et pas toi ; tout ce que je reconnais d’artistique en moi te manque ; je ne reconnais pas l’artistique en toi ; tu n’es qu’un mouvement. Tout ça est assez profond, assez juste. Le pas de côté effectué il y a une quarantaine d’années par le « mouvement de la rue » peut en effet être lu comme une remise en cause de la notion d’art au sens où l’a produite l’imaginaire occidental. Un peu comme aujourd’hui le slam, qu’on raccorde parfois à l’art de la poésie, mais dans une configuration où l’œuvre s’efface devant l’acte. Dans la session slam – un des avatars du « mouvement » hip hop – l’acte consiste dans la réunion de personnes disant des textes qu’elles ont élaborés (peu ou beaucoup, bien ou mal) en suivant une règle de forme et de temps. Vu d’avant Duchamp, la session slam est un salmigondis d’où il arrive au mieux qu’on puisse extraire quelques saillies, quelques perles, parfois même les mettre sur le marché symbolique et financier des œuvres littéraires. La session slam, en effet, produit aussi des textes saillants qui répondent aux critères de la belle œuvre. Mais ce n’est pas le critère du slam. Le critère du slam est dans la qualité d’une réunion où des humains se disent des textes élaborés (saillants ou non), produisent du sens (novateur ou rebattu). Le critère du slam, c’est l’émergence d’un bain de signes, d’un bain de sens dont une communauté réunie se trouve magnétisée. La perle est dans le bain, mais quand on la sort du bain, comme le tentent obstinément l’institution culturelle et le marché de la variété, quand la perle est recalibrée à la façon de l’art hérité, on se demande si elle ne perd pas son attrait. D’ailleurs, isolée, jugée selon les vieux critères, elle court presque toujours le risque d’être rétrogradée au rang d’art mineur. L’électricité ne passe plus si le contact est coupé.
Que se produit-il quand dans les cités populaires de nos villes, dans la rue, sur la dalle, des adolescents s’essayent avec parfois une grâce ensorcelante, parfois dans la maladresse ou même le ridicule, à des figures de break dance ? Quel type de lien s’établit entre ces essais, ces bribes, ces échanges de signes dans la quotidienneté de la rue et ce que produisent les professionnels du hip hop, quand ils sont accueillis sur les scènes de l’institution culturelle publique ou par le marché du spectacle ? Je me souviens avoir vu, dans un théâtre, une représentation de danse hip hop donnée par une compagnie que son travail formel avait fait adopter par le beau monde. Ces artistes étaient allés loin dans l’échange avec les canons des spectacles classifiés « danse contemporaine ». Mais le vocabulaire hip hop, la réputation hip hop restaient suffisamment prégnants pour que la salle fût envahie d’adolescents couleur cités. Et devant les entrechats sophistiqués, devant les figures dépouillées, presque arides présentées sur la sainte scène, on entendait soudain monter des gradins le blasphème jubilatoire, sonore et gesticulant d’un peuple d’enfants enthousiastes qui reconnaissait là la puissance d’un langage dont ils se sentaient co-auteurs. Le signe artistique n’était pas un objet flottant, surplombant, voué à la pieuse dévotion des âmes. Il ajoutait sa voix à la rapsodie d’un langage prenant naissance, un langage natif fait pour répondre à l’intense besoin de prendre la parole chez ceux à qui d’habitude on intime le silence (ou le bruit, ce qui est la même chose). Prendre la parole, puis en l’occurrence, lui donner suffisamment forme pour qu’elle parle à tous. Ce langage manquait. Il fallait d’abord le faire advenir. Là d’abord était l’important. Non pas d’abord l’œuvre sélectionnée par l’institution culturelle, le segment reconnu digne d’être officialisé sur la scène(et ça, vraiment, tant mieux), mais la gestation par tout un peuple de tout un langage, œuvres officiellement sélectionnées comprises.
Que s’est-il passé jadis, dans les champs de coton d’Amérique, quand des hommes et des femmes déportés d’Afrique, condamnés de naissance au bagne, à l’abrutissement et au mépris inventèrent collectivement, bribe après bribe, le langage du blues, puis l’offrirent en héritage à l’humanité entière ? Quelle opinion pouvaient avoir de ces bribes les mélomanes de la bonne société louisianaise appliqués à percer les arcanes du contrepoint et de l’harmonie classique ? Et qui des deux mondes ajouta du sens et des signes qui manquaient à l’histoire humaine ?
À bien y regarder, la très féconde histoire occidentale de l’art, quand elle invente sa modernité, n’échappe pas à ce processus collectif d’émergence. Les villes italiennes de la Renaissance, le peuple, la bourgeoisie de ces bourgs brisent la prison théocratique qui enferme toute représentation. L’humanisme auquel ils donnent naissance recompose les images pour pouvoir y représenter dans une force nouvelle la vitalité des humains. Ils inventent un nouveau langage. Nos musées en conservent, pour notre grand bonheur, les moments les plus denses et ceux-ci sont signés, individuellement signés : Ucello, Boticelli, Le Pérugin, Léonard… Mais il a bien fallu aussi les milliers d’infimes modifications dans la façon de se parler, d’échanger des marchandises, de s’habiller, de regarder passer la procession ou brûler les hérétiques. Il a bien fallu essuyer les plâtres. Avant les anges graciles de Raphaël, il y a les lourds apôtres de Masaccio. Puis cette histoire a pris de l’âge. Elle s’est trouvée comme emprisonnée dans sa puissance, qui en fin de route se transforme en infirmité. À mesure qu’il étendait son empire, l’Occident s’est pris pour la nature des choses humaines. Il a oublié que son langage, son univers de signes était, comme tout autre, aléatoire et contingent, fruit non de la Providence, mais d’un génie collectif et singulier, grand de cette singularité plus que d’un universalisme aveuglant pour lui-même, écrasant pour les autres. Il a confondu sa culture avec la culture, les saillies de sa culture avec les sommets de l’art universel. Il en a déduit que la culture était faite, que les humains d’où qu’ils fussent n’avaient plus qu’à y accéder. Et quand d’autres sources de langage laissaient émerger la possibilité d’autres histoires, l’establishment occidental de la culture était ataviquement conduit à dénoncer les trébuchements et les boiteries qui toujours sont le lot des premiers pas, sans voir qu’on trace un sentier même quand on a le pied bot. Derrière les gaucheries qui accompagnent les commencements, surtout quand ils se font sous l’ombre intimidante de la culture des officiels, la pensée dominante ne discerne pas d’emblée ce que Françoise nomme « mouvement ».
La Rome antique était tellement vaste, tellement belle que mille cinq cents ans après la chute de l’empire, on en devine encore la splendeur. Surplombant le chaos du forum romain, quelques arcades d’un parfait aplomb dessinent dans l’imagination les travées disparues de la basilique de Maxence. On se dit que ces nefs grandioses auraient pu survivre, que nous prendrions plaisir à les parcourir aujourd’hui autrement que par l’esprit. Mais les barbares sont passés par là. Barbare : mot impérial désignant les personnes qui parlent mal la langue de l’empire, les personnes que l’Empire ne comprend pas. À partir du cinquième siècle, un autre univers de signes, d’autres paroles à dire font négliger la beauté romaine. La basilique de Maxence n’a pas résisté à cette négligence. Rétrospectivement, on se dit que c’est quand même dommage. Il fallut attendre mille ans pour qu’on osât s’en inspirer à nouveau sans craindre de perdre la voix. Cette audace fut nommée « Renaissance ».
L’Occident n’a pas les mots pour dire notre humanité diverse qui se mondialise pour une part sous lui, pour une part sans lui. Or les empires ne tiennent jamais longtemps quand ils ne parviennent pas à faire endosser leur projet par ceux qu’ils soumettent. Ce défaut de sens se paiera-t-il de la ruine de Rome ? C’est ce que semble penser et vouloir Oussama Ben Laden. Mais on peut espérer une autre issue. On peut vouloir avancer beaucoup plus vite vers une renaissance où chacun récolterait à sa façon, pour l’emmener ailleurs, ce qui vivrait encore d’un Occident désimpérialisé, d’un Occident capable d’entrer en conversation.
Toute question posée aux animateurs d’Ilotopie sur la classification de leur art les rend évasifs. Comédiens, plasticiens, spectacle, théâtre, rue, installations, public… Les vieilles catégories proposent leurs analogies, aident à cerner le sujet, mais ça ne colle pas vraiment. Il faut les emmêler à des périphrases si l’on veut approcher la nature des événements symboliques proposés par la compagnie (tiens, un vieux mot de théâtre). Lorsque l’entrelacs des fuseaux-habitacles de Confins se pose sur le trottoir d’une rue parisienne et que les « acteurs » d’Ilotopie s’y installent pour y passer les jours et les nuits, où sont les 35 heures ? Quelle est l’œuvre ? Qui fait le spectacle ? Qui regarde quoi ? Qu’est ce qui est vécu, symbolisé ? Qu’est-ce qui reste ? La relation entretenue jour après jour avec le SDF du coin, un anticonformiste rétif à la nafnafisation, fait-elle partie de la pièce ? Placée au pied du pont du Gard (tiens, un monument romain), la même structure entourée d’arbres et de touristes ne vire-t-elle pas de sens ? « La nuit en abribus » est retirée du catalogue quand les sans abri commencent à hanter les grandes métropoles et à disputer le confort selon Jean-Claude Decaux aux intermittents du spectacle (tiens, un statut social). Leur présence a dérobé la maîtrise du sens aux professionnels du signe ! Donc il n’y avait pas l’œuvre et ses spectateurs, mais un certain équilibre dans la distribution du sens, dans la production des signes, un équilibre voulu, mais précaire, vulnérable à la réalité sociale, un équilibre échappant à la conservation, échappant au pouvoir artistique. Même quand c’est à son corps défendant, le « mouvement de la rue » désorganise le lexique officiel de l’art, parce qu’il peine à y trouver les mots pour se dire.
Mais derrière cette désorganisation, ce n’est pas le désert des Tartares. Plutôt une végétation hybride, qui souvent sait prendre aux vergers délaissés. Les temples romains les mieux conservés sont ceux dont les briseurs d’idoles firent les églises du nouveau Dieu.
Dans le mouvement de la rue, champ d’expériences après champ d’expériences, Ilotopie en est venu à tenir le rôle des intellos, des subtils. C’est en tout cas la réputation qu’on prête à la compagnie. Le soutien qu’elle reçoit des hautes instances n’est plus donné avec des pincettes. Les DRAC peuvent s’en recommander sans rougir. Rome y reconnaît ses traces. Le résultat en est l’insolite réunion d’un peuple disparate qui peut-être est tout simplement Le Peuple. Quand Ilotopie propose un spectacle nautique et gratuit sur la Loire, le tout-venant des localités proches s’y rend en voisins : « Il paraît qu’ils ont mis des machines incroyables sur le fleuve ». Mais les amis de la culture viennent aussi : « Tu connais le travail d’Ilotopie ? C’est exquis, assez surprenant. Il faut l’avoir vu ». Pour ce qui se passe ensuite, faisons confiance à l’enfance qui nous travaille tous, que notre esprit soit plein de références érudites ou que nous en soyons privés par une de ces injustices qui distribuent de façon tellement inégale les outils symboliques comme les richesses matérielles. Devant les pétales géants qui glissent sur l’eau portant la voix des femmes fleurs, c’est sous des commentaires différents, mais ensemble qu’est partagée l’émotion et que l’imaginaire s’élargit. L’art et la recherche d’Ilotopie inventent des événements où la collectivité se recoud, se resymbolise. C’est au fond retrouver la vieille utopie grecque d’un théâtre institué pour que la communauté des citoyens y éprouve ensemble sa commune humanité et soit conduite à en construire par elle-même l’organisation politique.
« Qui récupère qui ? » demande Bruno pour qui la question n’est pas rhétorique.
Peut-être pourrait-on dire tout d’abord qu’Ilotopie est allé loin dans la récupération des morceaux d’art mis à disposition par la danse contemporaine, la pensée contemporaine, le théâtre contemporain, l’art contemporain (par contemporain, il faut entendre ce qui fait histoire dans le cours actuel de l’art occidental). Les spécialistes du contemporain ne sont pas perdus quand ils assistent à Narcisse guette ou lisent la relation d’une performance des Gens de couleurs. Ils s’y retrouvent. Ilotopie y trouve aussi des mots pour se vendre à ces acheteurs-là (on y reviendra).
Et puis, quand une autorité publique ouvre l’espace public pour une expérience dans laquelle la liberté critique ne l’épargnera pas, l’artiste peut toujours se rassurer en mettant ce détournement de pouvoir au crédit de son adresse à dissimuler. Mais le ronronnement des engins nettoyeurs de rue qui suivent imperturbables les débordements poétiques en plein air se charge de rappeler les limites du désordre.
Laissons pour l’instant ces question en suspens.
« Nous voulons l’argent du vieil art »
C’est presque systématique : quand on engage la conversation sur la visée d’Ilotopie, Bruno joue les paradoxes tandis que Françoise tient la doxa. Bruno dit : « Mon utopie, c’est de vendre mes images ». Quand il dit vendre, il ne parle pas en métaphores. Il évoque le commerce de la production culturelle : économie de l’art, œuvre contre argent. L’utopie, ce serait parvenir à donner suffisamment corps à ses rêves imagés pour qu’ils finissent par s’inscrire dans la réalité, une réalité qui de nos jours se prouve à elle-même en espèces sonnantes et trébuchantes. Alors Françoise s’insurge : « Tout notre propos dit le contraire. Tout notre propos dénie à l’argent et au pouvoir leur monopole sur la légitimation des signes ».
L’histoire d’Ilotopie débute par une petite annonce commerciale publiée dans la presse. Bruno, qui revendique de réinterpréter à la lumière d’aujourd’hui ses souvenirs anciens, recompose pour moi son annonce :
- Nouveaux fous proposent désordres urbains.
- Pourquoi « nouveaux fous » ?
- Nouveaux fous parce que c’est au temps des « nouveaux philosophes ».
Après réflexion, il ajoute :
- Désordres urbains et action artistique, ou quelque chose comme ça.
Éric retrouve dans ses archives la version initiale, commercialement moins risquée : « Nouveaux fous proposent interventions dans la ville ». La municipalité du Havre répond positivement. Premier marché. C’est en 1979, à la fin des années Giscard. Mai 1968 se sent encore. Mitterrand promet la rupture avec le capitalisme. Les communistes, dont le maire du Havre, adoubent sa foi révolutionnaire. Les masses y croient.
Le commerce des pommes de terre comme celui des objets d’art, s’il compte durer, est assis sur deux piliers : la séduction et la confiance. Le vendeur doit savoir séduire (ou ruser) s’il veut provoquer le désir du client. Le client doit éprouver le sentiment d’en avoir pour son argent. L’argumentaire minimum du marchand de pommes de terre, c’est d’inscrire sur l’étiquette : pommes de terre – 1,6 € le kg. Si le légume a belle allure, ça suffira. Mais lorsqu’il s’agit de vendre du désordre urbain à une autorité publique, la gageure est d’un autre métal. Surtout quand, à partir des années 80, la mise en cause de l’ordre établi devient une bizarrerie politique délaissée par presque tous. Séduire malgré tout ? Ruser ? Trahir la commande ? Se glisser dans les interstices qui fissurent la cohérence fantasmée du pouvoir ? Avec des bonheurs inégaux, Ilotopie s’insinue dans toutes les brèches. Parfois, ça marche.
À Montreuil-sous-Bois, une maison de quartier donne carte blanche à la compagnie pour proposer quatre événements, un par mois. Chaque événement bénéficie d’un budget correspondant à peu près à un Smic de l’époque. Il est rare que sur l’espace public, une autorité politique ou administrative se dessaisisse ainsi du sens au profit d’artistes. Il est rare que l’arbitrage public et l’arbitraire artistique s’accordent confiance à ce point. Les trois premières propositions d’Ilotopie passent librement. La quatrième s’appelle « L’enterrement du Smic ». Il est prévu de labourer un morceau de jardin public, d’y semer sous forme de pièces de cinquante centimes la totalité de la dotation allouée aux artistes, puis de herser le sol et de le rendre aux habitants. La suite est prévisible en même temps qu’aléatoire. Se battre pour le Smic ? Pour un seul Smic ? Redistribuer l’argent public ? Partir à la chasse au trésor (les enfants) ? Céder à la tentation (toutes catégories) ? Y résister (certains adultes) ? Une fois encore, la fable se prête à interprétations multiples et prépare à coup sûr de vifs débats. L’impossibilité d’en déduire un sens univoque et la certitude qu’elle favorisera des interrogations incontrôlables conduisent la municipalité à interdire l’événement. Raté pour cette fois.
En 1989, peu avant des élections municipales, la mairie de Marseille veut une fête pour mettre en scène la démolition controversée d’une barre HLM dans la cité populaire de Plan d’Aou. Ilotopie, compagnie domiciliée dans les Bouches-du-Rhône et déjà quelque peu reconnue, est contactée quinze jours seulement avant l’événement. Commande initiale : un défilé de mode. Ilotopie refuse cette incongruité. L’urgence impose d’aller vite.
- Qu’avez-vous d’autre à proposer.
La compagnie répond au vague désir sous le déguisement d’un vague projet :
- Une fête avec les habitants la veille de la démolition ?
- Pourquoi pas !
- Un événement de presse en présence du maire le lendemain, pour le premier coup de pelleteuse ?
- Allons-y !
Les Ilotopiens n’ont pas envie de faire comme si l’effondrement de chez-soi, même paré de vertus urbanistiques, pouvait être un événement anodin. Une bonne partie de l’argent est remis à une association qui prépare une soirée-grillade pantagruélique. La façade de l’immeuble, cernée d’une bande de peinture noire, devient un faire-part de deuil. La nuit venue, des rétroprojections font apparaître aux fenêtres les photographies de famille glanées auprès des habitants. Pour les funérailles de ces moments de vie, on brûle de l’encens, des cierges. Beaucoup pleurent. Tous sont heureux qu’on ait pris leurs souvenirs au sérieux. Le lendemain : la presse, le maire (Robert Vigouroux), une pelleteuse. Passage à l’acte. Le professeur Vigouroux est posé dans la pelleteuse. Ses mains sont tenues par un technicien, guidées sur les manettes qui actionnent la griffe d’acier. Quelques fausses manœuvres et coups dans le vide provoquent la holà des habitants massés pour la mise à mort. Puis l’engin arrache enfin un pan de mur. Du sang artificiel disposé en poches géantes à l’intérieur de l’immeuble dégouline de la plaie. Informées in extremis, les autorités municipales ont demandé que le rouge du liquide soit remplacé par du bleu. Refusé, sous le (vrai) prétexte du manque de temps. La fête, très réussie, n’est pas allée dans le sens prévu par l’acheteur. Elle n’est pas allée non plus dans un sens contraire. Elle est allée ailleurs, cérémonie de deuil célébrée ensemble par ceux dont l’immeuble éventré fut la demeure et par des artistes cabanophiles émus qu’on éventre un logis. La fête n’a pas été un instrument de propagande mais un moment de vie, de sens. Argent public détourné pour célébrer le sentiment public plutôt que mis au service des stratégies municipales. Réussi, mais risqué pour la fidélisation du client.
L’idée du Palace à Loyer Modéré (PLM) fut proposée pour les fêtes de Lille qui la recrachèrent. Le projet resta dans les cartons, mais surtout, et très fort, dans le désir des artistes qui l’avaient porté. Hasard inaugural : un comité du ministère de la Culture trouve l’idée séduisante et débloque un (petit) budget. Ilotopie joue les écureuils, entrepose cette première noisette. Il en vient d’autres à force de démarches biscornues et d’économies acrobatiques. Un jour, la mairie des 15e et 16e arrondissements de Marseille, en quête d’une animation dans la cité de la Castellane, offre à son insu l’occasion de tenter l’aventure. Le budget dévolu à cette animation est squelettique. Ça évite de soupçonner l’ampleur qu’elle va prendre. Ilotopie déterre ses noisettes. Françoise, qui pousse l’idée depuis l’origine, part en repérage : « Pourquoi tu photographies ma cité ? ». Des mois sont nécessaires pour que le jeu puisse prendre. Il prend. Bonheur attesté. Une part de la presse en fait le procès, une autre y voit un coup de génie. Les jeunes du quartier obtiennent une salle d’activités. La réhabilitation, bloquée depuis cinq ans, trouve les fonds pour se faire. C’est gagné. L’utilité du désordre ilotopiste a touché suffisamment de monde – habitants, journalistes, acteurs sociaux, élus, rêveurs – pour s’instituer comme producteur de sens. Les bailleurs de fonds ont le sentiment diffus d’en avoir eu pour leur argent. Dans les quartiers nord de Marseille comme ailleurs, le système humain a sa part de chaos. C’est par ce labyrinthe que l’imaginaire envoie ses laves. Quand elles refroidissent, le paysage en est changé.
« Mon utopie, c’est de vendre mes images » dit Bruno. « Tout notre propos dénie à l’argent son monopole sur la légitimation des signes » répond Françoise. « Nous voulons l’argent du vieil art » inscrivent les artistes de rue sur leurs proclamations.
Le problème avec les utopies, c’est qu’elles signalisent un monde qui n’existe pas avec des symboles ramassés dans celui que nous habitons. Il est frappant de voir combien l’iconographie des cités utopiques imaginées par les illustrateurs du temps passé est datée, encombrée des emblèmes de chaque temps où chaque image est faite. Rétrospectivement, elle ne nous informe vraiment que sur le passé. Ce texte lui même n’échappe pas au paradoxe. Il est titré « Les utopies à l’épreuve de l’art ». Il commence en affirmant que l’art est peut-être seul à pouvoir proposer une expérience de l’utopie, sans faire courir le risque du totalitarisme à ceux qui la vivent. Puis, au détour de ses développements, il s’enfonce peu à peu dans des questions en forme d’apories. Il en vient par exemple à affirmer ceci : la notion d’art ne prend sens que par une certaine répartition des rôles dans la production des signes et du langage, notamment celle qu’établit l’histoire moderne de l’Occident. Il suggère comme suite à cette thèse que la notion d’art se met à tourner à vide quand les signes vivants sont produits dans une répartition nouvelle, par exemple quand leur émergence implique autant l’artiste que le public, distinction maintenue par commodité (paresse ?) et qui du coup devient factice. Il lit dans les actes d’Ilotopie l’utopie d’une construction solidaire du sens et des signes, l’utopie que cette construction peut échapper aux injonctions des pouvoirs, fussent-il des pouvoirs artistiques, l’utopie que des collectivités humaines peuvent gagner de l’autonomie dans la représentation de leurs désirs et de leurs rêves, mais que ça nécessite une distribution nouvelle des rôles, un dépassement du vieil art. Il suppute que le délaissement en Occident et hors d’Occident du paradigme de l’art et de l’artiste dans la production des signes n’est pas forcément une catastrophe pour qui veut se remettre en mouvement vers une humanité émancipée et diverse. Et c’est justement l’expérimentation in vivo de ce type de délaissement qui serait censée prouver le rôle irremplaçable de l’art dans l’ouverture à l’utopie ?
Tout ça se mord la queue. Il ne peut en être autrement. Nous disons nos désirs avec notre héritage de mots, un héritage institué qui fait système et se cadenasse lui-même. L’incohérence est notre seule issue.
L’utopie que portent beaucoup d’événements proposés par Ilotopie, n’est-ce pas d’abord introduire une brèche dans la cohérence des signes hérités ? Juste devant nous, dans ce moment précis, quand se produit ce jeu-ci, la cohérence du langage dominant se déchire. Un autre monde apparaît, non seulement possible, mais concrètement vécu. Le maire y est dérouté de sa propagande électorale, non pas métaphoriquement mais en vrai, posé par un costaud dans son choix de fossoyeur d’immeuble qu’il cherchait justement à masquer. La femme de ménage se fait servir des croissants chauds par des domestiques en livrée. Quand nous demandons conseil sur la préservation des ressources naturelles, c’est au soliloque expressif de notre propre trou du cul. Mais la déchirure dans la cohérence héritée n’en fait pas de la charpie. Même déchirée, sa trame subsiste. Il y a quelque chose à voir par delà la déchirure, mais il reste assez de la vieille cohérence (du vieil art) pour y battre en retraite et s’y calfeutrer. Le maire rejoindra sa permanence électorale, la femme de ménage repassera demain les culottes de sa patronne et nos trou du culs se renfrogneront dans l’incognito de nos derrières.
Il n’y a pas récupération. Il y a coexistence inévitable de l’utopie vécue et de l’ordre accepté. Pour commencer à me faire comprendre, je dis que l’art permet ça. Pour me faire encore mieux comprendre, je dis que le mot art rend mal compte des productions de signes qui permettent cette ouverture dans la cohérence, que la déchirure dans la cohérence nous laisse encore muets, approximatifs quand il s’agit de désigner les paysages qu’elle dévoile.
Lumières d’Afrique
Si les déchirements de cohérence étaient impossibles, l’histoire n’existerait pas. Les révolutions, quand elles ont prétendu exprimer la cohérence de l’histoire et qu’elles ont mis les forces de l’ordre nouveau au service de cette affirmation, ont institué des sociétés figées, rigides, brutales, cassantes, sans avenir possible. Mettre du jeu dans les mécanismes de la cohérence, dans la cohérence de nos représentations comme dans celle des institutions héritées, est un passage obligé pour tout avènement de « nouveau » dans l’histoire. Questions d’utopistes : que surviendrait- il dans une société planétaire libérée de la muraille meurtrière que le Nord riche hérisse aujourd’hui pour se protéger (croit-il) du Sud pauvre ; qu’est-ce qui se passe si je sème l’argent public dans un jardin public et le laisse à disposition du public ? Ce jeu mis dans la cohérence héritée ne prend d’existence pour les humains que quand ils se le représentent. La mise en représentation de ce jeu est ce qu’on nomme utopie. Une utopie. Au sens technique du terme. Utopie : dessin, représentation de ce qu’on voit quand la cohérence de l’ordre et des signes se déchire. C’est pourquoi on dit à la fois de l’utopie qu’elle est n’importe quoi (« ton projet est vraiment complètement utopique, complètement incohérent ») et en même temps qu’elle s’appuie sur quelque chose, qu’elle ne part pas de rien, qu’elle entretient un certain rapport, un certain jeu avec ce qui nous paraît spontanément cohérent (« ton utopie, je te jure que ça me parle »). Ce jeu n’est possible que par la puissance de l’imaginaire qui à un moment déborde la raison et lui ouvre des champs d’expérience qu’elle était impropre à repérer par elle-même. L’équipe d’Ilotopie a désigné comme des utopies beaucoup des jeux déraisonnables mais très imaginatifs qu’elle se proposait de jouer avec le public. Et c’est assez probant.
Et me revoilà sur le point d’écrire : Ilotopie rend assez probant que l’art soit la matrice de ce jeu. Mais il faut tout de suite aller au delà du mot-verrou d’art, parler avec le mot plus sa déchirure : ce que l’action d’Ilotopie rend assez probant, c’est le fait que l’émergence des signes et du langage soit la matrice de ce jeu, une émergence dont rend compte pour une part le mot d’art, dont il rend mieux compte s’il se déchire à l’emploi. L’utopie fraie son chemin dans le jeu qui se fait quand le mot se déchire, quand la cohérence dont il était le serviteur se déverrouille.
Je travaille beaucoup au Mali. Quand en France ou même en Afrique, je veux donner une idée de mes activités, j’emploie les mots arts, artistes, théâtre, acteurs, spectateurs. Par exemple, je peux tenter d’expliquer mon travail en disant que j’écris, souvent avec mon ami Alioune Ifra Ndiaye, des pièces de kotèba. À la question que me posent inévitablement ceux qui ne connaissent pas le sens de ce mot, je peux répondre : le kotèba est un genre théâtral burlesque et satirique de la culture mandingue. Mais ces formulations sont des abus de langage. D’abord, le kotèba qui se joue certaines nuits de fête dans les cités bambaras ou mandingues ne s’écrit pas. Ensuite, le présenter peu ou prou comme du « théâtre à l’africaine » est aussi bébête que de faire de Victor Hugo un « griot à la française » et c’est beaucoup moins anodin, du fait du déséquilibre entre l’Occident impérial et l’Afrique vaincue (comme dit un proverbe du Mali : « Donne la chèvre à l’herbe, donne l’herbe à la chèvre, la chèvre trouvera son compte dans les deux »). Les explications que je tente avec nos mots communs sont prises dans les plis de la vieille cohérence. Elles masquent les processus singuliers par lesquels l’Afrique fait émerger des signes et du langage. Finalement, elles dénient sa légitimité à nommer, à prendre la parole pour son propre compte, à entrer dans la conversation. Puis-je m’exprimer autrement ? Est-il possible de faire un kotèba d’aujourd’hui sans le contaminer par les mots d’art, de théâtre, etc. ? Est-il même possible que la contamination en reste aux mots, qu’elle ne s’inocule pas aux pratiques qu’ils signalent ? Sans doute non. Pas tout de suite. L’occidentalisation forcée du monde a disséminé partout ses OGM. Aucun champ d’expérience n’est à l’abri. Nulle part. Alors nous tentons comme nous pouvons de représenter le jeu qui subsiste entre les lignées culturelles africaines, hybrides forcés, et celles d’Occident qui tiennent le manche mais parfois en tremblent. Interstices étroitement bordés par de puissants rapports de force, mais où se niche, vivante et chaude, l’utopie de communautés humaines également légitimes à produire du langage. Utopie ?
Si je me permets cette digression, c’est pour la lumière oblique qu’elle envoie sur le paysage. La lumière oblique met du relief là où le soleil de midi écrase les formes. Les « artistes de rue » seront peut-être sensibles à cette mise en relief. Ils savent qu’une scène nationale est au centre et eux à la périphérie. Une scène nationale peut aimer qu’on lui dise : il y a dans ce que vous faites certaines inspirations qui viennent des arts de la rue. Mais c’est pour elle sans enjeu. Sa centralité avale tout. Pour les « arts de la rue », être gratifié du vocable « théâtre de rue » n’est pas sans enjeu. On peut même être tenté d’y chercher refuge. Cependant, la contestation portée par le mouvement de la rue produit aussi des expressions autonomes et pleines de sens. Quand il parle de son administration de tutelle, Bruno dit « ministère de la Culture de certains ». Et la fédération des arts de la rue a longtemps revendiqué un ministère « des » cultures. Vu d’Afrique, ces prises de parti sont pleines de sens. On peut avoir la curiosité de chercher le lien.
Contrat de départ : écrire quelque chose comme un essai à propos de l’expérience ilotopienne. Alors, par conscience professionnelle, j’arrive à Port-Saint-Louis avec mon petit paquet d’idées bien classées dans la tête, espérant vaguement puiser dans la matérialité des histoires concrètes de quoi les confirmer. Je les hisse avec moi dans le poste de vigie qui sert de salle de réunion, à l’extrême proue du Citron jaune. Je les expose à l’assistance, polie, je crois même intéressée. J’en tire un plan avec le dessein d’y caser le « matériau Ilotopie ». Et ça se passe autrement. Comme un vent qui plie la pensée et l’emmène ailleurs. Le plan s’éparpille. Des idées inattendues surgissent. Une rencontre a eu lieu. Elle modifie la donne.
Mais la rencontre est aussi faite de connivences préexistantes, de points de rencontre. En voici un, à ce qu’il me semble, un point où d’emblée nous étions proches.
Longtemps, la question politique a été : « Dans quelle société voulons-nous vivre ? » Elle est en train de se déplacer. Les pouvoirs d’aujourd’hui ont entrepris de nous reconstruire de l’intérieur, pour que nous agissions de nous même en conformité avec leurs objectifs : consommateurs insatiables et ravis, agents consentants du contrôle universel, salariés dévoués aux cours de la Bourse, opinions façonnées, électeurs fascinés, fin de l’histoire. Nous imposer la société dans laquelle nous devons vivre ne leur suffit plus. Trop réversible. Il s’agit désormais d’usiner nos âmes pour nous rendre spontanément propices à les servir toujours.
Ce que nous raconte l’histoire d’Ilotopie, depuis la première cabane, c’est l’autre voie. C’est qu’il n’est pas interdit d’espérer choisir nous-mêmes la forme d’humanité que nous voulons vivre. L’histoire d’Ilotopie nous en donne la preuve par la vie – les cabanes . Par l’art, l’art de la représentation : marcher sur les eaux, faire le deuil d’un immeuble, habiter l’inhabitable… Par le dépassement de « l’art » : inclure dans le jeu le SDF rétif à la nafnafisation, la femme de ménage palacisée, établir grâce à des fictions un certain art de vivre ensemble, convaincre l’ami des arts de se laisser emporter avec les autres…
S’autoriser, individuellement et collectivement, à construire de façon autonome le type d’humain que nous voulons être (créer les conditions de cette autonomie) devient une urgence politique de premier rang.. Je crois que l’expérience d’Ilotopie touche à ça.
Dans un texte devenu célèbre, Francis Le Lay, l’ancien patron de TF1, a cyniquement ouvert le pot aux roses : le vrai métier de la première entreprise française à produire de la représentation, c’est vendre « du temps de cerveau disponible ». Francis Le Lay n’a pas déclaré : « Le métier de TF1, c’est produire des représentations qui confortent l’ordre économique et politique ». Ça, TF1 le fait aussi, mais c’est comme par atavisme, comme un vieux pli qui incline depuis toujours certains vecteurs culturels à servir les vérités officielles. L’ancienne question politique – dans quelle société voulons nous vivre ? –, TF1 se garde bien de la laisser sans réponse. Cependant, son vrai métier travaille plus profond. Son vrai métier consiste à produire des leurres susceptibles d’appâter les cerveaux pour un deal dont ils sont la marchandise. Le système publicitaire de production de signes et de langage ne vise pas d’abord l’alignement des idées. Il vise d’abord la modification des âmes, la modification de la fonction dévolue aux âmes, leur conformation au jeu de leurres qui fait d’elles un outil pour la valorisation du capital. Les émissions les plus « politiques » de TF1 ne sont plus le journal de 20 h ou Les coulisses de l’économie, mais Le maillon faible, Koh-lanta, les feux de l’amour.
Le moteur publicitaire ne fait d’ailleurs que redoubler une mutation plus générale provoquée par l’emprise croissante du capitalisme financiarisé sur le champ culturel. Les « produits culturels » sont désormais le premier poste d’exportation des USA. Des capitaux immenses se portent sur ce gisement très prospectif. Les firmes les plus respectables, par exemple celles qui arment les militaires, se bousculent pour mettre des billes dans la culture et l’entertainment. Ce n’est pas sans effet. Le critère ultime auquel doivent se soumettre les signes et le langage travaillés sous ce critère n’est plus interne, vérité contre vérité. Il leur devient extérieur : quel type d’œuvres sont susceptibles d’assurer une position concurrentielle sur le marché des capitaux. Privatisation du langage. Œuvres véridiques ou menteuses, raffinées ou vulgaires, chef-d’œuvres ou navets, peu importe. Les fonctions de vérité et de communication étaient restées jusque là essentielles, même quand la production culturelle était façonnée pour servir les pouvoirs. Désormais, elles s’effacent devant la capacité à séduire. Réduit à cette seule utilité, le langage conserve son attrait, mais perd sa fiabilité. Il n’est plus un bien commun, un outil de partage, mais l’instrument de tout autres desseins. Le langage ainsi privatisé ne dit plus. Il ne réunit plus. Il ne médiatise plus les affrontements. Il drague. Et nos cerveaux stupéfiés, coupés les uns des autres, désertés par les symboles autour desquels ils trouvaient à se rassembler deviennent ce qu’on a voulu qu’ils soient, des machines à faire monter les ventes.
Grâce à Dieu, les autres sources de signes n’ont pas tari. En bien des endroits, elles restent vivaces. En même temps qu’il gonfle, le monstre se lézarde. Mais pour que les lézardes le fragilisent efficacement, il faudra bien quitter les sentiers battus. Les objurgations et les plaintes du « monde de la culture » ne suffiront pas. Ni l’horizon sans cesse repoussé du 1% du budget de l’État consacré à entretenir les appareils culturels publics. Si la question politique touche désormais directement à l’essence de ce qui nous fait humains, la culture cesse d’être affaire de politique culturelle. Elle devient un enjeu axial de la politique tout court. Alors, elle doit quitter les cercles délicats. Alors il faut que la résistance traverse la société tout entière, délicats autoproclamés et soi-disant rustauds, car la même dépossession les menace. Il faut créer les conditions pour que les membres de la société puissent ensemble reprendre la main sur l’invention des signes et du langage dont ils ont besoin pour se dire et pour se rencontrer, qu’ils en redeviennent co-auteurs.
L’histoire d’Ilotopie donne corps à cette utopie. D’abord, et c’est l’essentiel, elle fait ce pas de côté qui permet de réunir sans artifice ni confusion l’intermittent du spectacle et la technicienne de surface dans une même fiction. Elle imagine des représentations partagées, construites pour émettre ensemble du sens, pour dire et pour mettre en forme des significations inédites, pour élargir la capacité de tous à produire des signes et du langage. Arts de la rue.
En second, elle injecte dans ces événements ce qu’elle trouve à mettre à profit des raffinements artistiques reçus en héritage. Elle le fait avec soin. Elle ne recommence pas l’histoire à zéro. Elle consacre à ça du temps et de l’argent. Elle acquiert pour ça des savoirs faire spécifiques, une adresse, un art qui lui sont propres.
Ilotopie dit à ceux que son histoire traverse :
1 - regarde, tu es fondé à construire les symboles dont tu as besoin pour vivre en humain libre, tu n’es pas voué à te laisser voler l’âme ;
2 - regarde encore, regarde les outils raffinés et les précieux matériaux dont ton âme peut faire usage pour construire cette liberté-là ; nous avons passé notre existence à en réunir le trésor ; nous le mettons au pot commun ; ne t’en prive pas.
Ilotopie est une bonne lézarde.

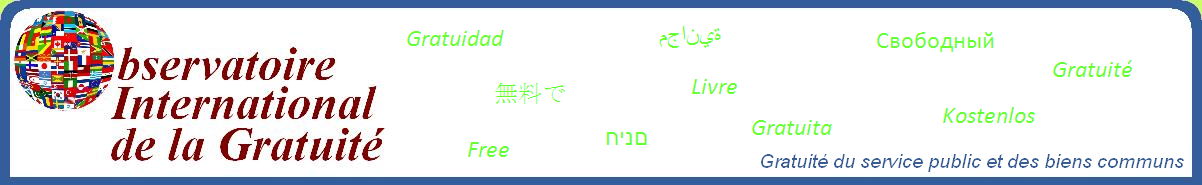

/https%3A%2F%2Fstorage.canalblog.com%2F45%2F62%2F1297332%2F98675872_o.jpeg)