> Gratuité Intellectuelle
.
Le philosophe Laurent Paillard propose de remettre en cause la propriété intellectuelle.
Il veut bannir l’idée de téléchargement illégal et instaurer la gratuité d’une quantité de bande passante, sorte de minimum vital.

Droit de propriété intellectuelle, politique et écologie.
Laurent Paillard
Mon point de départ, dans La Gratuité intellectuelle, a été la question de la propriété intellectuelle. Peut-on appeler « propriété » une œuvre de l'esprit et plus généralement ce que l'on appelle « un bien immatériel » ou bien cette expression est-elle contradictoire ?
Le mobile de cette réflexion a été le phénomène du téléchargement illégal. Comment se fait-il que dans des civilisations dans lesquelles la propriété privée est une évidence pour la majorité des individus, sa violation dans le cas des œuvres de l'esprit soit à ce point banalisée ? Faut-il penser que la majorité des êtres humains est foncièrement malhonnête, ou cela révèle-t-il au contraire le fait que l'idée de propriété intellectuelle est contradictoire au point de ne pas pouvoir être respectée dans les faits ?
Chemin faisant, je me suis rendu compte que cette question amenait à une réflexion plus générale sur la façon dont le capitalisme utilisait la notion de propriété en la détournant de son sens. En premier lieu, l'idée de propriété intellectuelle (et non l'idée de propriété en tant que telle) est symptomatique des contradictions de cette organisation économique. En effet, comme pour ce qui s'est passé avec les enclosures agricoles qui ont fait disparaître les terrains à usage commun, le capitalisme se développe en captant les biens qui devraient être communs, pour en faire des sources de profit. C'est bien sûr le cas de la culture et du savoir. D'autre part, le capitalisme ne peut exister que sur la base d'une accumulation sans limite. Or, si grande soit elle, l'accumulation matérielle ne peut pas se développer indéfiniment. C'est pourquoi la dématérialisation de la monnaie en est une condition essentielle et distingue probablement le féodalisme du capitalisme. C'est bien le caractère immatériel de la monnaie, permettant de l'affranchir de son support physique, qui explique la possibilité d'accumuler au delà de ce qui a un sens dans la vie réelle. D'une certaine manière, l'expression « capitalisme financier » est un pléonasme. De même, et de façon concomitante depuis le développement des échanges informatiques, les fortunes accumulées par certains « créateurs » et acteurs de l'industrie numérique, sont en dehors du sens commun. Ils revendiquent alors le droit de revendre à l'infini une même création de l'esprit, en s'en déclarant « propriétaire ». Une idée « propriétaire » est finalement une idée que l'on va pouvoir faire fructifier toute sa vie et dont nos descendants vont pouvoir profiter jusqu'à 70 ans après notre mort. Or, il faut bien se rendre compte que si ce profit est potentiellement sans limite, les bien matériels qu'il permet d'acheter sont des produit d'un travail réitéré chaque jour. Là encore, il s'ouvre un abîme entre le bénéficiaire d'un droit de propriété intellectuelle (DPI) et celui pour qui l'acte de production doit être réitéré chaque jour. Cela donne une capacité de domination et d'exploitation absolue du premier sur le second.
La réflexion sur les biens immatériels prolonge donc la réflexion sur la monnaie. Le capitalisme a pour particularité de fonctionner sur la possibilité d'accumuler de la monnaie dématérialisée, c'est-à-dire de la liquidité donnant un contrôle sur les richesses matérielles. Ainsi la monnaie, bien commun par excellence puisque destiné aux échanges, devient une source d'enrichissement infinie si on favorise son accumulation, en d'autres termes, sa capitalisation. C'est donc bien la possibilité de s'approprier sans limite de la monnaie qui caractérise le capitalisme, c'est-à-dire une modalité d'enrichissement particulière et historiquement déterminée s'appuyant sur le contrôle d'un bien immatériel.
A partir de là, on peut lire la consolidation des DPI comme une nouvelle extension du capitalisme. Les œuvres et les inventions partageant avec la monnaie la possibilité d'être dématérialisées. Pourtant, par un effet en retour, l'enrichissement qui en résulte est un droit de tirage sur des richesses matérielles limitées. Dans les deux cas, on dispose alors d'un « stock » de symboles inépuisable. Or, si en raison d'un idéalisme débridé, on donne au symbole le même statut -de propriété exclusive- que la chose matérielle, on comprend aisément pourquoi cela finira tôt ou tard par épuiser le monde physique et ses habitants, au premier rang desquels ceux qui doivent produire chaque jours avec leur corps pour gagner de quoi survivre.
Cet ensemble de faits explique la violence de la répression en direction des partisans d'une économie contributive telle qu'elle tente de s'organiser à la marge sur le web :la condition pour que l'économie numérique soit l'eldorado des marchands, c'est de l'imposer comme économie propriétaire. Or cela n'est pas évident puisque son architecture initiale (le protocole HTLM par exemple) est contributive. C'est pourquoi nous assistons à un mouvement d’enclosure du réseau. La société à la pomme et les réseaux sociaux qui sont en réalité des réseaux fermés en sont de bons exemples.
Enfin, pour compléter ce tableau, on peut remarquer que les domaines dans lesquels l'économie marchande se développe le plus actuellement sont justement ceux qui reposent sur des biens immatériels transformés par l'OMC sous la pression de quelques multinationales en propriété intellectuelle. Il s'agit de l'industrie culturelle, de la bio-industrie et de l'industrie pharmaceutique. L'objectif pour ces industries est de s'approprier des connaissances afin de contrôler leur circulation et leur utilisation dans le but d'en tirer du profit. On peut citer par exemple les brevets sur les semences. Il faut noter que c'est à nouveau un moyen de faire du profit aux dépends de l'agriculteur qui n'a pas le droit de semer les graines qu'il aurait pu garder de l'année précédentes (qui sont d'ailleurs souvent des hybrides) sans s’acquitter de royalties.
C'est pourquoi la question écologique est sous-jacente à la réflexion sur les biens immatériels et le numérique. D'une part, comme dit précédemment, la mainmise de l'industrie sur la connaissance induit une standardisation des pratiques agricoles dramatiques pour les paysans en général et ceux du sud en particulier. C'est aussi une catastrophe pour la biodiversité qui porte en germe la destruction des conditions nécessaires à la survie de l'humanité. Cela pose donc à la fois des problèmes sociaux et écologiques. De plus, on confond souvent « informatique » et « virtuel ». Or, l'informatique repose sur une économie utilisant des matériaux dont l'extraction est extrêmement polluante et induit un gaspillage d'énergie gigantesque. Il faut donc rappeler qu'utiliser un ordinateur connecté au réseau a des conséquences environnementales. Si l'on ajoute à ce constat le fait que l'organisation marchande du réseau implique une inégalité d'accès à la connaissance, alors nous avons une seconde raison de penser que l'économie numérique est à la croisée d'une problématique sociale et d'une problématique écologique.
Suite à cet ensemble de constats, il m'a paru nécessaire de réfléchir au statut de ces biens afin de savoir s'ils devaient être considérés comme nécessairement communs ou s'ils pouvaient être appropriables et à quelles conditions. Corrélativement, je me suis demandé s'il était possible de garantir des droits aux auteurs et aux inventeurs sans pour autant s'appuyer sur un système répressif aussi liberticide qu’inefficace. A la suite de cette réflexion, je pense être en mesure d'affirmer qu'il est possible d'organiser la diffusion des œuvres et des connaissances de manière plus juste, à la fois pour les créateurs et pour le public.
Pour une politique de partage des biens immatériels.
Article paru dans les Z'indigné(e)es / la vie est à nous n°8 en novembre 2013.
Le réseau internet est devenu un vecteur majeur de la circulation des connaissances et de la création. Parallèlement, la numérisation des biens culturels et la dématérialisation de leur transmission fait de l’informatique un enjeu social central. Cela se traduit par un appétit de partage, et par l’émergence d'une économie contributive prometteuse. Pourtant, les politiques de développement et d'organisation des échanges immatériels sont pour la plupart misérables afin de laisser le champ libre aux acteurs marchands. Cette absence de volonté politique se traduit par de nombreux aspects. On peut citer les zones blanches qui persistent alors que les zones rentables sont couvertes par de nombreux canaux suite à la marchandisation du réseau. Ajoutons à cela le mythe de la fausse gratuité de l'accès à la connaissance qui serait offerte par le réseau alors que le matériel, le coût des forfaits, les connaissances nécessaires au maniement de l’outil informatique augmentent considérablement, pour les plus démunis, les barrières pour accéder à la connaissance. Sans oublier le financement des contenus par la publicité qui met la circulation de la culture sous la coupe du marché. Enfin, il ne faut pas oublier les nombreux effets pervers du modèle marchand qui, sous prétexte de défendre les artistes et les créateurs, les soumet à l'industrie culturelle favorisant ainsi une privatisation sans précédant de la connaissance entre les mains de quelques multinationales de l'agro-industrie, de la pharmacie ou de la culture.
Dans ce contexte, le renforcement des droits de propriété intellectuelle (DPI) n'est pas une mesure pour défendre la culture, mais un moyen, défendu dans le cadre de l'OMC par quelques multinationales pour la transformer en source de profit en étendant leur monopole sur les connaissances nécessaires à l'existence et à l’épanouissement de chaque être humain. C'est pourquoi la culture doit redevenir un bien commun. La logique répressive adoptée contre le partage des fichiers sur l'internet, qui se solde par la banalisation de la surveillance des internautes, est un effet direct de cette tendance : « surveiller et punir » étant depuis longtemps le leitmotiv du capitalisme face à tout ce qui résiste à son extension.
Pour remédier aux impasses de cette économie « propriétaire », se développe et s'organise une économie contributive faite de réseaux de partage, d'encyclopédies en lignes, de logiciels libres et de licences ouvertes qui permettent d'étendre les droits des usagers. Cette économie est potentiellement révolutionnaire, mais, en l'absence de politique publique du numérique digne de ce nom, ces divers mouvements ont des effets ambivalents qui doivent nous empêcher d'en avoir une vision trop romantique. En effet, d'un côté, ils donnent un accès quasi illimité à la culture à quelques agents dotés du capital économique et culturel suffisant pour profiter sans risque des ressources du réseau, ce qui porte atteinte aux créateurs et aux éditeurs les plus fragiles. D'un autre côte, cela limite considérablement l'accès à la culture de tous ceux qui ne maniant pas facilement l’outil informatique doivent de ce fait payer pour les autres et au prix fort leur accès aux biens immatériels. Sans compter la majorité qui en est tout simplement privée.
Face à tous ces constats, compte tenu du poids du numérique dans l'économie et dans l'organisation des sociétés, on peut raisonnablement penser qu'aucun mouvement politique ne peut espérer mener une politique sociale, antiproductiviste et visant une démarchandisation de l'existence, sans un programme sérieux et une stratégie solide en matière informatique, comme le montre la timidité sinon l'absence de politique du gouvernement Ayrault en la matière. Ainsi, une réelle gratuité pour tous de l'accès aux ressources dématérialisées, appuyée sur des modalités de financements socialisées de la culture et d'une modération de l'usage de l'informatique qui repose sur une industrie et des infrastructures hyperpolluantes peuvent être considérés comme les piliers de l'écosocialisme.
Au contraire, la défense de la propriété intellectuelle, qui se concrétise par l'option répressive telle qu'elle s'exerce en France par l'HADOPI et au niveau international par l'ACTA (Anti-Counterfeiting Trade Agreement), se présente de façon hypocrite comme une défense de l'exception culturelle alors qu'elle constitue incontestablement une extension à toutes choses du modèle marchand et du capitalisme.
Le fait qu'il s'agisse de biens immatériels permet d'entretenir la confusion entre propriété légitime liée à l'usage d'un produit, et capital que l'on fait fructifier afin de s'assurer une rente. Il faut donc bien avoir ce point en tête pour comprendre en quoi penser le droit d'auteur comme une « propriété » revient à justifier et à consolider le capitalisme. Comme j'essaie de le montrer dans La Gratuité intellectuelle (éditions Parangon), il serait au contraire possible de définir et d'assurer des droits réels pour les auteurs et les inventeurs sans les considérer comme propriétaires de leurs œuvres. En effet, une propriété est quelque chose dont l'usage est exclusif, ce que les économistes appellent un bien « rival », contrairement à un bien commun. Or, lorsque l'on partage un bien immatériel, on ne s'en prive pas pour autant. Dés lors, la possession d'un droit exclusif dessus ne peut pas se définir comme une propriété, mais est un capital permettant de soutirer un droit d'accès à l'utilisateur. La problématique est très proche de celle de l'eau : détenir la source et le réseau n'a pas pour but de s'assurer un moyen d'avoir toujours à boire, mais de transformer les usagers en clientèle captive pour les faire payer au prix fort l'accès à la ressource. C'est pourquoi les bien immatériels relèvent des biens communs, comme l'eau que nous buvons ou l'air que nous respirons.
Parler « d'exception culturelle » pour défendre un marché monopolistique des biens immatériels renforçant la mainmise des grandes multinationales de l’industrie culturelle, au détriment de l'accès à la culture du plus grand nombre relève donc du plus grand cynisme, sinon d'un contresens théorique. Cela sélectionne par la fortune ceux qui y ont accès. Il s'agit donc de priver les plus démunis du droit de se cultiver ou de s'approprier les savoirs et les techniques nécessaires à leur existence. Ainsi, en renforçant la marchandisation du savoir, le capital nie la possibilité d'une altérité autonome et augmente son contrôle sur l'activité humaine. Ajoutons à cela que c'est en prenant le contrôle d'un bien immatériel : la monnaie – qui devrait aussi être considérée comme un bien commun - que le capitalisme se développe et colonise toutes les sphères de l'existence. C'est pourquoi, la question de la circulation des biens immatériels dans le réseau est la condition première de la contestation du capitalisme : elle prolonge et renforce la critique socialiste de la monnaie, cette dernière circulant d'ailleurs principalement par ce canal aujourd'hui.
La question de la circulation des biens immatériels et des DPI est donc la racine du capitalisme moderne. Leur renforcement a été adopté par l'OMC sous la forme de textes rédigés par trois associations composées des leaders de l'industrie agrochimique et pharmaceutique. La fusion, pour ne pas dire la confusion entre droits d'auteurs et brevets y a été renforcée de manière à leur assurer un monopole sur les ressources immatérielles telles que des gênes et des molécules pharmaceutiques. Or, la plupart de ces éléments proviennent de connaissances ancestrales des paysans des pays du sud. Par conséquent, cela poursuit la période coloniale, consubstantielle au capitalisme, par d'autres moyens en garantissant aux sociétés du Nord un monopole sur les ressources nécessaires aux usages et aux productions des pays du sud. Au final, cette logique industrielle se solde par une standardisation dramatique de la production agricole fatale pour la biodiversité.
Pour toutes ces raisons, le renforcement général de la propriété intellectuelle, qui porte sur des biens immatériels donc communs, il faut le rappeler, est une des pierres angulaires du capitalisme en tant que système colonial. Organiser la gratuité de la circulation des connaissances, financée par un renchérissement du mésusage de bande passante qui est extrêmement polluant, permettrait de sortir du marché et de mettre ainsi la culture à l’abri des prédateurs qui y font la loi. En permettant aux peuples de se réapproprier leurs usages propres construits par leurs interactions avec leur environnement particulier, ce serait un pas de plus vers l'écosocialisme.
Laurent Paillard.
Leçons d'émancipation :
l'exemple du mouvement des logiciels libres
article publié le 27/04/2009
site ATTAC-France
auteur-e(s) : Hervé Le Crosnier
Un mouvement ne parle que rarement de lui-même. Il agit, propose, théorise parfois sa propre pratique, mais ne se mêle qu’exceptionnellement de la descendance de son action dans les autres domaines, qu’ils soient analogues, tels ici les autres mouvement dans le cadre de la propriété immatérielle, ou qu’ils soient plus globalement anti-systémiques. Les incises sur le rôle politique du mouvement du logiciel libre dans la phase actuelle et sa puissance d’émancipation ne sont donc que mes propres interprétations... même si une large partie du mouvement en partage, si ce n’est l’expression, du moins le substrat. Mais d’autres, pourtant membres du même ouvement, et construisant eux aussi le bien commun du logiciel libre pourraient penser que leur motifs d’adhésion et leur objectifs restent largement différents, considérant l’élaboration de logiciels libres comme une autre approche de l’activité capitalistique et de marché, mais qui leur semble plus adaptée au travail immatériel. Approche « pragmatique » et approche « philosophique » ne sont pas incompatibles, c’est du moins la principale leçon politique que je pense tirer de ce mouvement et de son impact plus global sur toute la société. Car si un mouvement ne parle pas de lui-même, il « fait parler » et exprime autant qu’il ne s’exprime. Le mouvement des logiciels libres, et ses diverses tendances, est plus encore dans ce cas de figure, car son initiateur, Richard M. Stallman n’hésite pour sa part jamais à placer les fondements philosophiques au coeur de l’action du mouvement.
Sommaire
- Introduction
- Le mouvement des logiciels libres
- Un mouvement symbole
- Extension : les nouveaux mouvements du numérique
Pour saisir la genèse du mouvement des logiciels libres, mais aussi son réel impact libérateur pour toute la société, il convient de revenir à la question même du logiciel. Le néophyte a souvent tendance à assimiler le logiciel aux outils de productivité, tels les traitements de texte ou les navigateurs. Mais il convient de comprendre que le logiciel intervient dès qu’une machine, un microprocesseur, sait « traiter l’information », i.e. transformer des signaux d’entrée (souris, clavier, réseau, mais aussi capteurs les plus divers) en signaux de sortie exploitables soit directement par les humains (écran, impression,...), soit utilisés en entrée par une autre machine de « traitement de l’information ».
Le logiciel est partout dans le monde informatique :
c’est l’outil essentiel d’accès aux connaissances et informations stockées dans les mémoires numériques
il est lui même une forme d’enregistrement de la connaissance et des modèles du monde produits par les informaticiens
enfin chaque logiciel est une brique nécessaire au fonctionnement des ordinateurs (système d’exploitation), des réseaux et de plus en plus de tous les appareils techniques qui incorporent une part de « traitement de l’information », depuis les machines-outils de l’industrie jusqu’aux outils communicants de « l’internet des objets ».
Le logiciel est donc tout à la fois un « produit » (un bien que l’on acquiert afin de lui faire tenir un rôle dans l’activité privée ou industrielle), un service (un système, certes automatisé, auquel un usager va faire remplir des tâches) et une méthode (une façon de représenter le monde et les actions possibles). Ce statut ubiquitaire du logiciel est essentiel pour comprendre certaines des revendications de liberté des acteurs du mouvement : il ne s’agit pas simplement d’un outil (un produit de type « machine-outil »), mais d’un système-monde dans lequel se glissent peu à peu la majeure partie des activités humaines, dans tous les domaines, de la production industrielle à la culture, de la communication à l’éducation,... André Gorz parle d’une « logiciarisation de toutes les activités humaines » [1].
La conception des logiciels s’en trouve affectée, ainsi que sa catégorisation qui lui dessine une place spécifique dans le cadre même du « marché ». Le logiciel est à la fois :
une œuvre de création : on peut réellement parler d’un « auteur » de logiciel, au moins collectif grâce au développement de techniques de partage de code et de maintenance (génie logiciel et programmation par objets). Chaque logiciel porte la trace des raisonnements de celui qui l’a programmé ;
un travail incrémental : un logiciel comporte des « bugs », qui ne peuvent être corrigés qu’au travers de l’expérience utilisateur, et un logiciel doit suivre l’évolution de son environnement informatique (les autres logiciels). Ceci implique la coopération comme base de la construction de logiciels fiables, évolutifs, et adaptables aux divers besoins ;
une production de connaissances (les « algorithmes ») qui pourraient devenir privatisées si les méthodes de raisonnement et les formes du calcul ne pouvaient être reprises par d’autres programmeurs (cette question est au coeur du refus par le mouvement des logiciels libres des brevets de logiciels et de méthodes).
Le développement de l’informatique, et l’extension du réseau et du numérique à tous les aspects de la production, de la consommation et des relations interpersonnelles (au niveau privé comme au niveau public) crée un véritable « écosystème », dans lequel :
chaque programme doit s’appuyer sur des couches « inférieures » (des applications déjà existantes jusqu’aux pilotes des machines électroniques dites « périphériques ») et rendre des informations à d’autres logiciels. La définition des « interfaces » entre programmes devient essentielle, et la normalisation de ces échanges une nécessité vitale.
les programmes peuvent lire ou écrire des données provenant d’autres programmes ou outils. C’est l’interopérabilité.
Que ces échanges soient « ouvert » ou « à discrétion d’un propriétaire » devient une question déterminante. Dans le premier cas, l’innovation s’appuie sur ce qui existe, et peut rester concurrentielle (nouveaux entrants, mais aussi nouvelles idées) ; dans le second, tout concours à la monopolisation (au sens de monopoles industriels, mais aussi de voie balisée limitant la créativité). D’autant qu’un « effet de réseau » (privilège au premier arrivé [2]) vient renforcer ce phénomène.
Tous ces points techniques forment un faisceau de contraintes et d’opportunités pour les industries du logiciel comme pour les programmeurs individuels :
la capacité à « rendre des services aux usagers » sans devoir maîtriser une chaîne complète. Ce qui entraîne la création d’un « marché du service » et la capacité de détournement social de tout système numérique : innovation ascendante, usage de masse, relations ambiguës entre les facilitateurs -producteurs de logiciels ouverts ou de services interopérables – et les usagers,... ;
la mise en place d’un espace d’investissement personnel pour les programmeurs (autoréalisation de soi, expression de la créativité, capacité à rendre des services associatifs et coopératifs). On rencontre ici un changement émancipateur plus général que Charles Leadbeater et l’institut Demos a nommé « the pro-am révolution » [3].
Les logiciels libres partent de cette intrication du logiciel, de la connaissance et du contenu : tout ce qui limite l’accès au code source des programmes va :
limiter la diffusion de la connaissance,
privatiser les contenus (avec les dangers que cela peut représenter pour les individus, mais aussi les structures publiques, des universités aux États)
brider la créativité
Le « code source » est la version lisible par un « homme de l’art » d’un logiciel. L’accès à ce code est un moyen de comprendre, d’apprendre, de modifier, de vérifier, de faire évoluer un logiciel. C’est de cette liberté là qu’il est question dans le mouvement des logiciels libres.
Il s’agit de construire la « liberté de coopérer » entre les programmeurs. Un logiciel libre respecte quatre libertés :
la liberté d’exécuter le programme, pour tous les usages (liberté 0.)
la liberté d’étudier le fonctionnement du programme, et de l’adapter à ses besoins (liberté 1) ; pour cela, l’accès au code source est nécessaire.
la liberté de redistribuer des copies, donc d’aider son voisin, (liberté 2).
la liberté d’améliorer le programme et de publier ses améliorations, pour en faire profiter toute la communauté (liberté 3) ; pour cela, l’accès au code source est nécessaire.
On notera que cet ensemble de « libertés » constitue une nouvelle « liberté de coopérer », et non un « droit » au sens où la responsabilité de la continuité de cette liberté reposerait sur des structures et des forces extérieures aux communautés concernées. C’est parce qu’ils ont besoin de coopérer pour libérer leur créativité (et aussi souvent pour gagner leur vie avec cette création de logiciel) que les développeurs ont installé, dans le champ de mines des entreprises du logiciel et de l’informatique, les espaces de liberté dont ils pouvaient avoir besoin. Le maintien de cet espace de liberté peut évidemment demander l’intervention de la « puissance publique » : procès, respect des contrats de licence, mais aussi financement de nouveaux logiciels libres ou amélioration/adaptation de logiciels libres existants, … Mais à tout moment, c’est la capacité à élargir et faire vivre les outils, méthodes, normes et réflexions par la communauté des développeurs du libre elle-même qui détermine l’espace de cette « liberté de coopérer ».
Une des conséquences, souvent marquante pour le grand public, au point d’occulter le reste, vient de la capacité de tout programmeur à reconstruire le programme fonctionnel (le logiciel « objet ») à partir du « code source »... Si le « code source » est accessible, pour toutes les raisons énumérées ci-dessus, il existera donc toujours une version « gratuite » du logiciel. Mais ce n’est qu’une conséquence : un logiciel libre peut être payant, c’est d’ailleurs souvent le cas : mais les copies seront à la discrétion de celui qui aura acheté un logiciel. S’il le souhaite, il peut redistribuer gratuitement. Le produit payant, s’il veut avoir une « raison d’être », y compris dans le modèle du marché, doit donc incorporer du service complémentaire. On passe d’un modèle « produit » à un modèle « service ».
La question économique pour la communauté des développeurs de logiciels libres, tourne alors autour du phénomène de « passager clandestin », celui qui va profiter des logiciels libres produits par d’autres, sans lui-même participer à l’évolution de l’écosystème. Pire, celui qui va privatiser la connaissance inscrite dans les logiciels libres. Par exemple, le système privé Mac OS X s’appuie sur l’Unix de Berkeley. Apple profite du choix des concepteurs de ce dernier, dans la pure tradition universitaire, de considérer leur logiciel comme une « connaissance » construite à l’Université et donc délivrée par elle pour tous les usages, sans règles et sans contraintes... une subtile question de gouvernance au sein du mouvement des logiciels libres, mais qui a des conséquences sociales d’ampleur... Dans la théorie des biens communs, la maintenance de la capacité des communautés à continuer d’accéder aux biens communs qu’elles ont produite est centrale.
Le « mouvement des logiciels libres » part de cette double contrainte :
favoriser la coopération autour du code informatique pour étendre l’écosystème
laisser fonctionner un « marché de l’informatique » (tout service mérite rétribution)
L’invention de la GPL (« General Public Licence ») [4] en 1989 par Richard Stallman et Eben Moglen va marquer un tournant :
auparavant le modèle « universitaire » produisait des biens de connaissance dont les usagers (étudiants, mais aussi industries) pouvaient disposer sans contraintes. Ceci permettait le développement de plusieurs produits construits sur les mêmes connaissances (vision positive), mais aussi la privatisation par les entreprises associées aux centres de recherche universitaires ou publics ;
écrite pour protéger une construction communautaire, celle du projet GNU (GNU’s Not Unix), la GPL produit une forme de gouvernance adaptée à un type de bien, à une série de règles et normes communautaires, et à un projet politique (représenté par la Free Software Foundation).
La GPL s’appuie sur le « droit d’auteur » pour compléter celui-ci par un « contrat privé » (une « licence ») qui autorise tout usage (donc offre les quatre libertés du logiciel libre), mais contraint celui qui s’appuie sur du code libre à rendre à la communauté les ajouts et corrections qu’il aura pu apporter. On parle d’une « licence virale » : tout logiciel qui utilise du logiciel libre doit lui aussi rester un logiciel libre.
Cette invention juridique est fondatrice, non seulement du mouvement des logiciels libres, et du maintien et extension de cet espace alternatif de liberté, mais aussi fondatrice pour d’autres mouvements qui vont exploiter la capacité des détenteurs de connaissance (ou les producteurs de culture) à décider volontairement de construire de nouveaux espaces de coopération et de liberté.
Le mouvement des logiciels libre représente une expérience sociale de grande ampleur, qui a profondément bouleversé le monde de l’informatique. Il suffit d’imaginer un monde dans lequel seul l’achat d’un logiciel permettait de tester des produits et services informatiques : dans ce monde il n’y aurait pas d’internet (les règles de l’organisme technique qui élabore les normes, l’IETF, imposent l’existence d’au moins un logiciel libre pour valider un protocole), pas d’échange de musique numérique, l’évolution des sites web serait soumise à la décision d’opportunité économique des géants oligopolistiques qui se seraient installés sur l’outil de communication, l’apprentissage des méthodes de développement informatique dans les universités seraient soumises à la « certification » de tel ou tel béhémot du logiciel ou des réseaux,...
N’ayons pas peur de dire la même chose avec d’autres mots qui parleront peut-être plus clairement aux héritiers du mouvement social et ouvrier : le mouvement des logiciels libre a fait la révolution, créé de nouveaux espaces de liberté, assuré un basculement des pouvoirs et libéré plus largement autour de lui ce qui aurait pu devenir un ordre nouveau, balisé par les décisions de quelques entreprises. Comme toute révolution, elle est fragile, comporte des zones d’ombres, des « risques » de dérapages ou de récupération. Mais avant tout, comme les révolutions sociales, elle est un formidable espoir qui va ouvrir à la joie du monde non seulement les acteurs, mais tous les autres courants entraînés dans la dynamique, comme nous le verrons plus loin.
Le mouvement des logiciels libres met en avant la notion de « biens communs » : créés par des communautés, protégés par ces communautés (licence GPL, activité de veille permanente pour éviter les intrusions logicielles [5]) et favorisant l’élargissement des communautés bénéficiaires. La gouvernance des biens communs, surtout quand ils sont dispersés à l’échelle du monde et de milliards d’usagers, est une question centrale pour la redéfinition de l’émancipation. Le mouvement des logiciels libres montre que cela est possible.
C’est un mouvement qui construit de « nouvelles alliances ». Les clivages face au logiciel libre ne recouvrent pas les clivages sociaux traditionnels. Par exemple, le souverainisme ne sait pas comment se situer face à des biens communs mondiaux : il n’y a plus de capacité à défendre des « industries nationales ». Seuls les services peuvent localiser l’énergie économique ouverte par de tels biens. Le mouvement des logiciels libres ne se définit pas en tant que tel « anti-capitaliste », car nombre d’entreprises, parmi les plus importantes et dominatrices (IBM en tête) ont compris que l’écosystème informatique ne pouvait fonctionner sans une innovation répartie, et donc des capacités d’accès et de création à partir des bases communes (le fonctionnement de l’internet et les normes d’interopérabilité). Il est plutôt « post-capitaliste », au sens où il s’inscrit dans le modèle général du « capitalisme cognitif » [6], qui est obligé de produire des externalités positives pour se développer.
Enfin, c’est un mouvement social qui s’est inscrit dès sa formation dans la sphère politique en produisant une utilisation juridique innovante (la GPL) comme moyen de constituer la communauté et protéger ses biens communs. Ce faisant, ce mouvement agit en « parasite » sur l’industrie qui le porte. On retrouve des éléments du socialisme du 19ème siècle : ne plus attendre pour organiser des « coopératives » et des « bourses du travail ». Une logique qui est aussi passée par l’expérience des mouvements dits alternatifs (« californiens ») : construire ici et maintenant le monde dans lequel nous avons envie de vivre.
Cette symbiose entre le mouvement, son radicalisme (c’est quand même un des rares mouvements sociaux qui a produit et gagné une révolution dans les trente dernières années) et les évolutions du capital montre qu’il existe une autre voie d’émancipation que « la prise du Palais d’Hiver », surtout dans un monde globalisé et multipolaire, dans lequel le « Quartier Général » n’existe plus [7].
Enfin, le mouvement des logiciels libres a construit une stratégie d’empowerment auprès de ses membres. La « communauté » protège ses membres. Il y a évidemment les règles juridiques de la GPL d’une part, mais pensons aussi à la capacité à « offrir » du code en coopération pour que chaque membre puisse s’appuyer sur un écosystème en élargissement permanent afin de trouver les outils dont il a besoin ou d’adapter les outils existants à ses besoins. C’est une des raisons de la force du mouvement : en rendant plus solides et confiants ses membres, il leur permet d’habiter la noosphère [8]. Cet empowerment doit beaucoup au mouvement féministe (même si paradoxalement il y a peu de femmes et qu’elles sont souvent traitées avec dédain parmi les activistes du logiciel libre). Comme dans l’empowerment du mouvement féministe, c’est la vie quotidienne et l’activité humaine créatrice qui est au coeur de la réflexion du mouvement social. La « concurrence » entre programmeurs libres se joue sur le terrain de « l’excellence » au sens des communautés scientifiques : il s’agit de donner du code « propre », de qualité, rendant les meilleurs services, autant que de permettre aux débutants de s’inscrire dans la logique globale, par leurs initiatives et activités particulières, sans la nécessité d’être un élément dans un « plan d’ensemble ». C’est un mouvement qui pratique l’auto-éducation de ses membres (nombreux tutoriels sur le web, ouverture des débats, usage des forums ouverts,...).
Enfin, même si de nombreuses structures associatives organisent et représentent le mouvement, la structuration de celui-ci comme mouvement social mondial est beaucoup plus floue. C’est au travers de l’usage des produits du mouvements que l’on devient « membre » du mouvement, et non au travers de la production d’un discours ou d’une activité de lobbyisme ou de conscientisation. On retrouve les formes d’adhésion « à la carte » des autres mouvements sociaux. On s’aperçoit aussi que les mouvements parlent toujours au delà des discours de leurs membres, individus ou organisations...
Un autre élément essentiel pour comprendre l’importance et l’enjeu du mouvement des logiciels libre est de voir sa descendance dans d’autres mouvements liés à la sphère du numérique. Comme tout mouvement, les acteurs des logiciels libres ne sont pas tous conscients de l’étendu stratégique de leur actions. Nombre des membres se contentent des règles et normes « techniques » établies par le mouvement et se reconnaissent dans l’aspect pratique des résultats. Mais pourtant, les règles et les méthodes mise en place par le mouvement des logiciels libres se retrouvent dans d’autres sphères.
On parle d’une « société de la connaissance » ou « de l’information », ce qui est une expression ambiguë, qu’il conviendrait de mettre en perspective [9]. Mais pour résumée qu’elle soit, l’expression souligne que la propriété sur la connaissance, la capacité à mobiliser « l’intelligence collective » sont des questions organisatrices essentielles de l’économie du monde à venir. Et que ces questions renouvellent autant les formes de domination (par exemple la montée des grands « vecteurs » [10] sur l’internet, comme Google, Yahoo !, Orange, Adobe,... qui souvent s’appuient sur les logiciels libres) que les formes de l’émancipation, et la notion de contournement, de situation (au sens du situationisme) et de symbiose parasitique.
On voit donc apparaître de nouvelles lignes de faille dans les oppositions « de classe » liées au capitalisme mondialisé et technicisé. Et en conséquence de nouveaux regroupements des « résistants » ou des « innovateurs sociaux ». Plusieurs tentatives de théorisation de cette situation existent, depuis la théorie des Multitudes de Toni Negri et Michael Hardt [11], à celle de la Hacker Class de MacKenzie Wark [12], qui décrivent des facettes de ce monde nouveau qui émerge. Toutefois, ces interprétations ne savent pas encore répondre à deux questions centrales. D’abord celle dite traditionnellement des « alliances de classes », notamment la relation entre ces mouvements sociaux et les mouvement de libération issus de l’ère industrielle. Des « alliances » posées non en termes « tactiques » (unité de façade ou d’objectifs), mais bien en termes programmatiques (quelle société voulons-nous construire ? quelle utopie nous guide ? Quelle articulation entre l’égalité – objectif social - et l’élitisme – au sens fort des communautés scientifiques ou des compagnons : être un « grand » dans son propre domaine de compétence- ?). Ensuite celle dite de la transition, particulièrement en ce qu’elle porte sur les relations entre les scènes alternatives et les scènes politiques. Le capitalisme, comme forme de sorcellerie [13], ne peut pas s’effondrer de lui-même sous le poids de ses contradictions internes. Le politique, avec toutes les transformations nécessaires des scènes où il se donne en spectacle (médias, élections, institutions,...), garde une place dans l’agencement global des divers dispositifs alternatifs -ou internalisés et récupérés – qui se mettent en place.
Ces questions peuvent avancer quand on regarde l’évolution du mouvement des logiciels libres, qui est né d’une innovation juridique (la GPL), et qui défend aujourd’hui son espace alternatif au travers de multiples actions contres les tentatives, souvent détournées et perverses, de mettre en place des enclosures sur le savoir et la culture. La place du mouvement des logiciels libres en France, avec notamment les associations APRIL (Association pour la Promotion de l’Informatique Libre) [14], AFUL (Association Française des Utilisateurs de Logiciels Libres) [15] et les divers GUL (Groupes d’Utilisateurs de Linux) dans tous les départements, participent très largement au travail d’information et de pression sur les décideurs locaux et nationaux. On les a vu souvent, au côté de mouvements spécialisés comme « La quadrature du net » [16], ou de mouvements de consommateurs, comme « Que Choisir », s’investir sur les dernières lois concernant la propriété immatérielle (lois dites DADVSI et HADOPI). L’approche de la politique n’est plus « frontale », mais part de la défense des espaces de libertés, des « biens communs » créés, et leur reconnaissance comme forme essentielle de la vie collective. On retrouve les logiques du socialisme du XIXème siècle, des coopératives et de la Première Internationale.
Le mouvement des logiciels libres, s’il est le plus abouti et le plus puissant de ces nouveaux mouvements, n’est plus seul. C’est dans le domaine de la connaissance et de l’immatériel, dont la « propriété » que l’image de la GPL et des logiciels libres a connu une descendance abondante et pugnace. Les questions de la propriété sur la connaissance et de la construction, maintenance et gouvernance des biens communs créés par les communautés concernées sont deux éléments clés de ces nouveaux mouvements sociaux.
Quelques exemples :
le mouvement des créations ouvertes (Creative commons [17], Licence Art Libre,...) est construit autour de règles juridiques qui permettent aux auteurs d’autoriser des usages pour mieux faire circuler leurs idées, musiques, travaux divers. Ce mouvement emprunte directement à la « révolution douce » de la GPL pour son côté subversif, et à la fluidification du marché culturel comme conséquence de l’extension des communs de la culture. Une manière pragmatique de poser les problèmes qui évite l’enfermement dans des alternatives infernales [18].
le mouvement des malades qui veulent partager les connaissances avec leurs médecins. Avec une participation politique forte des malades de SIDA dans l’opposition aux ADPIC, qui s’est traduite par l’adoption des exceptions pour les médicaments dans les Accords de DohaC [19])
le mouvement des chercheurs pour le libre-accès aux publications scientifiques et aux données scientifiques
le renouveau des mouvements paysans autour du refus de l’appropriation des semences par les trusts multinationaux (contre les OGM, pour le statut de bien communs des « semences fermières » [20] – un exemple symptomatique en est la réalisation d’un numéro de « Campagnes solidaires », journal de la Confédération Paysanne avec Richard Stallman)
le mouvement pour un nouveau mode de financement de la recherche pharmaceutique (notamment les propositions de James Love pour l’association KEI – Knowledge Ecology International [21]) et pour l’utilisation de nouveaux régimes de propriété afin de permettre le développement de médicaments adaptés aux « maladies négligées » (Médecins sans frontières, DNDi [22],...)
le mouvement mondial pour le libre-accès à la connaissance (a2k : access to knowledge) qui réunit des institutions (États, notamment pour l’Agenda du développement à l’OMPI, constitution du bloc des « like-minded countries »), des réseaux d’associations (IFLA, association internationale des bibliothécaires, Third World Network,...) ou des universitaires (il est intéressant de penser que ce mouvement a tenu sa première conférence mondiale à l’Université de Yale [23])
le mouvement OER (Open Educational Ressources [24]) qui réunit autant des grandes institutions (MIT, ParisTech) que des enseignants souhaitant partager leurs cours, avec le parrainage de l’UNESCO... et de HP !
le mouvement dit « société civile » [25] lors du SMSI (Sommet mondial sur la société de l’information, sous l’égide de l’ONU en 2003 et 2005) ou du Forum pour la Gouvernance de l’Internet, et tous les mouvement qui s’interrogent sur l’évolution des réseaux, combattent l’irénisme technologique autant que le refus passéiste des nouveaux modes de communication
les mouvements portant sur le « précariat intellectuel », depuis les intermittents du spectacle jusqu’à l’irruption d’une « hacker class » (MacKenzie Wark) pratiquant le piratage comme valeur de résistance
les mouvements de refus de la mainmise publicitaire sur l’espace mental collectif, qui organisent la dénonciation et le rejet de l’industrie de l’influence (Résistance à l’Agression publicitaire [26]
le Forum Mondial Sciences & Démocratie [27], dont la première édition s’est tenue à Belèm en janvier 2009. Ce mouvement introduit la question des biens communs de la connaissance au coeur d’une nouvelle alliance entre les producteurs scientifiques et techniques et les mouvements sociaux.
Les formes de politisation au travers de l’empowerment des membres et des « usagers » de ces mouvements sont largement différentes de celles de la vague précédente des mouvements sociaux du vingtième siècle. La capacité de ces mouvements à s’inscrire directement dans la sphère politique est aussi une particularité. Il ne s’agit pas seulement de « faire pression » sur les décideurs politiques, mais d’imposer à la société politique la prise en compte de biens communs déjà établis et développés.
La problématique des biens communs n’a pas fini de produire une remise en mouvement de la conception d’une révolution émancipatrice, des rythmes de l’activité militante et de la relations entre les communautés de choix et les communautés de destin. Un élément moteur de la réflexion théorique en cours reste la dialectique entre l’empowerment individuel et coopératif/communautaire par la création et la maintenance de biens communs, et la défense des plus fragiles (financièrement, mais aussi juridiquement par des droits leur permettant une nouvelle gouvernance, l’accès à la connaissance ou de respect de leurs formes de connaissances, cf les mouvements « indigènes » [28]).
Car il faudra bien trouver des articulations théoriques, pratiques et politiques entre les diverses formes de résistance aux sociétés de contrôle, de militarisme, d’influence et de manipulation qui se mettent en place.
Pour cela, les pratiques, les réflexions et les succès sur le terrain du mouvement des logiciels libres sont à la fois un encouragement et une première pierre d’une réflexion par l’action. Ici et maintenant. En osant s’opposer aux nouveaux pouvoirs et aux franges les plus avancées des dominants.
Texte diffusé sous licence Creative Commons by-nc
Notes
[1] L’immatériel, André Gorz, Galilée, 2004
[2] Effet de réseau, wikipedia http://fr.wikipedia.org/wiki/Effet_de_réseau
[3] The Pro-Am revolution, How enthusiasts are changing our economy and society, Charles Leadbeater, Paul Miller, Pamphlet, 24th November 2004 ISBN : 1841801364. http://www.demos.co.uk/publications/proameconomy
[4] http://www.gnu.org/licenses/licenses.fr.html
[5] C’est par exemple par ce type d’analyse des logiciels propriétaires que l’on a trouvé le « rootkit » (logiciel espion) installé par Sony à chaque fois qu’on lisait un CD de cette entreprise sur un ordinateur. Les logiciels libres, en permanence sous l’oeil des usagers et des membres de la communauté comportent beaucoup moins de failles et de risques d’infections par des virus ou autres « badware ».
[6] Le capitalisme cognitif : la nouvelle grande transformation, Yann Moulier-Boutang, Ed. Amsterdam, 2007
[7] Ces deux références renvoient à l’imagerie du mouvement communiste de libération (bien distinct du stalinisme de pouvoir). La prise du Palais d’Hiver de Saint Petersbourg signait le début de la révolution de 1917 et l’écroulement de la dictature tsariste ; le texte de Mao Zedong « Feu sur le Quartier général » était un appel à la révolte contre l’installation bureaucratique « par en haut », qui allait ouvrir la période dite de la « Révolution culturelle ». L’histoire a fini par avoir raison des mouvements de libération, ce qui n’enlève rien à leur force de contestation, mais montre que la vision d’un monde centralisé, avec des noeuds de pouvoir centraux à défaire, reste en deçaà des formes exactes du pouvoir... et donc des besoins des révolutions émancipatrices.
[8] Homesteading the noosphere, Eric Raymond http://catb.org/  ;esr/writings/homesteading/homesteading/ Une traduction française est disponible dans le livre Libres enfants du numériques, Florent Latrive et Olivier Blondeau, Ed. De l’Eclat.
[9] Société de l’information/société de la connaissance, Sally Burch : In : Enjeux de Mots, sous la direction de Valérie Peugeot, Alain Ambrosi et Daniel Pimienta, C&F éditions, 2005. http://vecam.org/article516.html
[10] Tentative de définition du vectorialisme, In : Traitements et pratiques documentaires : vers un changement de paradigme ? Actes de la deuxième conférence Document numérique et Société, 2008 Sous la direction d’Evelyne Broudoux et Ghislaine Chartron. Ed. ADBS
[11] Multitude : Guerre et démocratie à l’âge de l’Empire, Michael Hardt et Antonio Negri, La découverte, 2004
[12] Un Manifeste Hacker : "a Hacker Manifesto", McKenzie Wark, Ed. Criticalsecret, 2006 (traduction française)
[13] La sorcellerie capitaliste : Pratiques de désenvoûtement, Philippe Pignarre et Isabelle Stengers, La Découverte, 2004
[17] http://fr.creativecommons.org/
[18] Construire le libre-accès à la connaissance, Hervé Le Crosnier, In : Entre public et privé, les biens communs de l’information. Colloque, Université de Lyon 2, 20 octobre 2005 http://archives.univ-lyon2.fr/222/
[19] Sida : comment rattraper le temps perdu, Gernan Velasquez, In : Pouvoir Savoir : Le développement face aux biens communs de l’information et à la propriété intellectuelle, C&F éditions, 2005. http://vecam.org/article1035.html
[20] Les paysans sont-ils les protecteurs des semences locales, Guy Kastler, à paraître (version en ligne : http://vecam.org/article1075.html)
[21] Prizes to stimulate innovation, James Love, KEI International http://www.keionline.org/content/view/4/1/
[22] Relancer la recherche et développement de médicaments contre les maladies négligées, Bernard Pecoul et Jean-François Alesandrini In : Pouvoir Savoir, op. Cité. http://vecam.org/article1033.html
[23] Accès à la connaissance : Access to Knowledge, Compte-rendu de la conférence Access to knowledge qui s’est tenue à l’Université de Yale du 21 au 23 avril 2006, par Hervé Le Crosnier http://herve.cfeditions.org/a2k_yale/
[24] Cape Town Open Education Declaration : Unlocking the promise of open educational ressources, http://www.capetowndeclaration.org/read-the-declaration
[25] Relieurs, Première phase du Sommet mondial de la société de l’information - SMSI 2002/2003, Note de synthèse Octobre 2004 par Valérie Peugeot http://vecam.org/article364.html
[26] http://www.antipub.org/, AdBusters,...)
[28] Forum social mondial : un appel pour « bien vivre » plutôt que vivre mieux, Christophe Aguiton http://www.cetri.be/spip.php?article1037&lang=fr
Libération, no. 7071
REBONDS, jeudi 5 février 2004, p. 35
L'avenir de la culture et la défense des créateurs ne passent pas par la
chasse aux pirates.
Pas de ligne Maginot sur le Net
PAUL Christian
La croisade contre le «piratage» des oeuvres musicales et
cinématographiques, c'est le Prozac des industries culturelles en crise, qui
investissent plus dans d'interminables guérillas juridiques que dans leur
adaptation urgente à l'univers numérique. Prendre l'Internet en otage serait
la pire réponse à cette crise. «Droit d'auteur» contre «piratage» : trop
simple ! Faut-il en effet criminaliser les pratiques de millions
d'internautes qui accèdent à la musique sur le réseau ? Pourquoi transformer
leurs fournisseurs d'accès en shérifs privés ? Comment tirer les leçons de
la révolution numérique sans être accusé d'abandonner les créateurs, les
auteurs, les interprètes ? Le débat public qui s'enflamme fait apparaître
des enjeux politiques trop longtemps refoulés. Là où beaucoup rêvaient d'un
consensus bien ordonné, émergent désormais des intérêts et des conflits que
la puissance publique n'a pas appris jusqu'ici à réguler. Il y a donc
urgence à éclairer les choix démocratiques.
Prenons-en acte : la révolution numérique modifie brutalement les modèles
économiques des industries culturelles. On imagine la stupeur des moines
copistes devant l'irruption de l'imprimerie... C'est la situation des majors
d'aujourd'hui. D'abord, tous les économistes en conviennent, en modifiant la
chaîne de création, de production et de diffusion, la mutation technologique
transforme le rôle, la valeur ajoutée et le bénéfice de chacun, pour le
cinéma et encore plus pour la musique. Pour les oeuvres musicales, en effet,
les technologies numériques rendent possibles la copie multiple sur des
supports vierges, le stockage sur des baladeurs et des disques durs, l'achat
en ligne sur des plates-formes ou des portails, ou encore, grâce à ceux-ci,
l'écoute gratuite et légale. Demain, le déploiement des réseaux à haut débit
étendra au cinéma ces bouleversements dont le DVD n'est qu'une première
étape.
Ensuite, les pratiques qui chamboulent aujourd'hui le marché de la musique
et réduisent ses ventes résident dans les réseaux d'échange direct de
fichiers musicaux «de pair à pair» (P2P). Ces téléchargements concernent en
France des millions d'internautes et quelques centaines de millions sur le
réseau mondial. Plus encore, là où Napster concernait seulement les fichiers
musicaux, les logiciels P2P permettent de télécharger tous les contenus
numériques (vidéo, images, logiciels, jeux, etc.).
Ces usages de masse, dont le développement s'accélère et qui font partie de
la vie quotidienne de millions d'Européens, obéissent à plusieurs logiques
qui ne se limitent pas à un effet d'aubaine. Le consommateur n'est pas dupe..
Il sait ou devine que dans l'univers numérique, la chaîne de production et
de diffusion change et que les coûts sont comprimés. Il résiste aux excès du
marketing musical et au durcissement de la protection des droits. C'est
pourquoi paraissent dérisoires les batailles d'arrière-garde juridiques ou
techniques, les guerres de retardement face à des évolutions irrésistibles
dont on mesure encore à peine les effets.
La dernière trouvaille technique réside dans le verrouillage des CD, les
rendant illisibles pour une partie des lecteurs. La dernière parade
juridique prend la forme d'amendements flibustiers à la future loi sur
l'économie numérique. Sans rien protéger, ils provoquent des dégâts
collatéraux : obligation de surveillance et filtrage dénaturent l'Internet
français sans apporter de réponses durables. Pour autant, la liberté de
l'Internet n'est pas le culte de la gratuité totale. Réaffirmons-le, il n'y
a pas de création culturelle sans rémunération des artistes. Quelles sont
les responsabilités de chacun, celles des citoyens, des acteurs du marché et
celle du législateur ?
D'abord, nous devons refuser les «lignes Maginot numériques», les bricolages
improvisés sous la pression d'intérêts particuliers au mépris de la
recherche d'une voie juste et équilibrée. Pour cela, il est impératif de
provoquer de vrais choix publics, sans renvoyer aux catacombes des millions
d'usagers de Kazaa. Ensuite, nous devons reconnaître, négocier et défendre
une pluralité de modes de rémunération et les régulations juridiques. Les
pistes sont légion. De la crédibilité de ces réponses alternatives et déjà
émergentes pour la rémunération des créateurs dépend la culture dans la cité
numérique. Rien n'oblige à renoncer à des systèmes mutualisés de répartition
des droits, à condition de les moderniser et de les alimenter.
La redevance pour copie privée (sur les CD ou d'autres supports numériques
de stockage) a déjà permis d'expérimenter une nouvelle forme de répartition
des droits. L'extension de la licence légale, à laquelle deux sociétés de
gestion des droits des artistes interprètes se sont ralliées, va dans le
même sens. L'adaptation de l'offre marchande doit insister sur la qualité
des services et l'innovation.
La première aurait dû être de proposer une offre commerciale attractive, à
prix raisonnable, de musique en ligne et greffant des services sur les
contenus, comme y invite l'économie numérique dans tous les secteurs. Le
recours à des rémunérations forfaitaires ou à des abonnements (Canal + n'a
pas tué le cinéma...) participe de cette attractivité.
Mais chacun le perçoit, il faut aller plus loin. En reconnaissant que des
formes nouvelles de production, voire d'autoproduction, ne cessent de se
développer sur les réseaux, rompant la chaîne des intermédiaires
traditionnels, et offrant même à une partie des artistes la possibilité
d'être mieux diffusés et rémunérés. En rappelant que la liberté essentielle
de l'artiste, c'est aussi de choisir son mode de diffusion. Désormais, les
canaux sont multiples. La diversité culturelle en sera renforcée. La
révolution numérique ne change pas seulement la diffusion des biens
culturels, elle transforme radicalement la création et l'économie de la
culture dans son ensemble.
Cet effort pour bâtir de nouvelles règles du jeu se double d'une
revendication appelée à devenir notre manifeste politique : bâtir une
coalition des biens publics informationnels. Sur d'autres fronts que la
création culturelle (les brevets, les logiciels, les médicaments ou les
semences agricoles...), la question de la propriété intellectuelle et des
biens communs est également devenu un enjeu politique majeur. Dans la cité
numérique, faisons reconnaître une place immense pour l'accès libre aux
savoirs, pour de la gratuité et pour des contenus publics. Une part
conséquente du patrimoine culturel en fait d'ores et déjà partie. Le
mouvement pour le logiciel libre a conquis sa place.
Oui, je crois, comme Daniel Cohen, que «la propriété intellectuelle rompt
avec le schéma de la propriété tout court».
Christian PAUL, député PS de la Nièvre et président de la fondation les
Temps nouveaux.Derniers ouvrages parus de Christian Paul : Du droit et des
libertés sur l'Internet, la Documentation française, 2000, et Vers la cité
numérique, fondation Jean-Jaurès, 2002.
© 2004 SA Libération. Tous droits réservés.
Le leurre de la gratuité
Libération du lundi 23 février 2004
Patrice Chéreau, cinéaste, Costa-Gavras, cinéaste, Pascal Dusapin,
compositeur, Jean-Claude Carrière, scénariste, Jacques Fansten,
cinéaste, Francis Girod, cinéaste, Laurent Heynemann, cinéaste,
Caroline Huppert, réalisatrice, Pierre Jolivet, cinéaste, Claude Lelouch,
cinéaste, Christine Miller, scénariste, Claude Miller, cinéaste, Bertrand
Tavernier, cinéaste, Pascal Thomas, cinéaste.
En réponse à l'article de Monsieur Christian Paul publié par Libération le 5
février dernier, intitulé Pas de ligne Maginot sur le Net, et au moment où
la loi sur l'économie numérique est examinée par le Parlement, nous,
auteurs, déclarons que nos oeuvres ont un prix et que nous ne ratifions pas
la philosophie de la gratuité sur les réseaux.
Le public et les responsables politiques doivent savoir que les droits
d'auteur sont notre unique source de rémunération et, aujourd'hui, nous
sommes donc privés pour partie de ce qui est notre exigence la plus
élémentaire : vivre de notre travail.
Ceux qui encouragent par démagogie le consommateur à penser que la culture
est gratuite portent la responsabilité, en nous appauvrissant, d'appauvrir
la création.
Internet est un formidable outil d'éducation et de mise en commun de la
pluralité des cultures, de la diversité et du progrès des connaissances.
Mais la gratuité est un leurre et un mensonge.
Derrière cet artifice se cache une vérité : la publicité et le trafic des
communications téléphoniques engendrent d'énormes profits sur Internet. On
donne aux consommateurs l'illusion de ne pas rétribuer le spectacle, mais en
vérité, il paye : abonnement à la connexion, bénéfice sur la vente en ligne,
prélèvement de micro paiements, écrans publicitaires, sont autant d'exemples
qui démontrent que les oeuvres circulent à l'intérieur d'une économie dont
les profits sont énormes pour ceux qui les diffusent sans les produire.
La philosophie de bazar, qui tend à définir comme caduque et réactionnaire
toute tentative de définition et de régulation du marché de la Toile, ne
fait que conforter une politique imbécile conduisant à un assèchement des
ressources de la production mettant en péril l'avenir des oeuvres et ceux
qui les créent.
Nous sommes pour la liberté d'expression et pour la liberté du consommateur..
Mais ces libertés ne peuvent s'opposer l'une à l'autre. Nous voulons
continuer à offrir au public des oeuvres diverses et une relation de respect
mutuel. Mais nous sommes contre le pillage de nos oeuvres.
Le soutien politique à la doctrine trompeuse de la gratuité dans un paysage
planétaire sans règle, sans rémunération, sans respect du droit moral est
une position démagogique que nous dénonçons comme nous dénonçons les
fournisseurs d'accès, pyromanes de la culture qui la propagent à leur seul
profit.
Pour la gratuité sur Internet
Le 23 février dernier, une pléiade d’auteurs et d’artistes pour la beaucoup engagés à gauche publiaient sous le titre « Le leurre de la gratuité » une charge argumentée contre la diffusion gratuite des œuvres de l’esprit sur Internet. Il se trouve que j’ai publié en 1995 un essai intitulé « Pour la gratuité », aujourd’hui épuisé, mais en libre diffusion sur le net (). Je suis également engagé, avec Lieux Publics, le Centre national de création des arts de la rue, dans une réflexion sur la gratuité d’accès aux créations proposées sur l’espace public, gratuité aujourd’hui menacée mais toujours revendiquée par une majorité des artistes concernés. Je ne vis moi même que de ce que me rapportent mes œuvres. Le point de vue exprimé dans Rebonds m’a donné envie de réagir et de réagir à la façon dont vivent les listes de discussion sur internet, c’est à dire en réponse directe aux affirmations énoncées.
Nous, auteurs, déclarons que nos oeuvres ont un prix.
Avant d’avoir un prix, vos œuvres ont un coût. Leur coût, c’est votre temps de travail celui de tous ceux qui contribuent à leur réalisation. Le prix payé à Paul-Loup Sulitzer pour ses œuvres est énorme. De son vivant, le prix des œuvres de Van Gogh était nul ou presque. Mais le coût des œuvres de Van Gogh, c’est à dire le prix de son éphémère survie n’était pas nul pour autant. Il n’était pas non plus si éloigné de ce qu’il faut à Paul-Loup Sulitzer pour se loger, se nourrir et répondre à ses menus désirs. Il n’est pas illégitime que les auteurs demandent à ce que leur temps de travail soit rémunéré. Mais le système actuel n’est fondé ni sur la qualité des œuvres que seule l’histoire consacre, ni sur le temps passé à les produire, mais sur les aléas commerciaux de leurs dérivés marchands : diffusion cinématographique, édition, etc. Je propose que nous ne nous arcboutions pas à cette formule qui remet nos destinées artistiques entre les mains du marché.
Nous ne ratifions pas la philosophie de la gratuité sur les réseaux.
Philosophie ? Non, technique ! Une technique fait que les savoirs et les œuvres peuvent désormais se partager gratuitement, ou presque, sans que celui qui les a émis n’en soit dépossédé. Ce n’est pas complètement nouveau. Je ne cesse pas de savoir que deux plus deux font quatre quand je l’ai transmis à d’autres. C’est par exemple ce que fait l’école « gratuite », tout en payant les enseignants. C’est ce que nous faisons tous, nous les adultes, en transmettant sans la perdre notre expérience à nos enfants. Ces techniques, on en fait quoi ?
Le public et les responsables politiques doivent savoir que les droits d'auteur sont notre unique source de rémunération.
C’est justement là le problème. Pourquoi une rente sur les dérivés marchands d’une œuvre de l’esprit seraient-elles « notre unique source de rémunération » ? Les professeurs d’universités sont payés à juste titre pour une activité qui réunit à la fois la création des connaissances et leur diffusion. Les artistes soumis à l’intermittence assurent dans leur domaine des tâches du même ordre dans un statut malheurement de plus en plus précaire, mais néanmoins toujours suggestif. On peut imaginer autre chose que les arcs-boutants du marché.
Aujourd'hui, nous sommes donc privés pour partie de ce qui est notre exigence la plus élémentaire : vivre de notre travail.
Ça, ce n’est pas vrai. Aucun des signataires de cet appel, tous éminents, que je respecte tous et que pour certains j’aime, ne peut dire en vérité qu’elle ou qu’il ne vit pas de son travail. Ce qu’ils peuvent dire, c’est qu’ils sont exploités dans leur travail, qu’une partie des richesses produites par leur travail est indûment perçue par des gens qui y ont mis de l’argent, mais pas de travail. Et ça, c’est une autre histoire.
Ceux qui encouragent par démagogie le consommateur à penser que la culture est gratuite portent la responsabilité, en nous appauvrissant, d'appauvrir la création.
Le « consommateur » ne peut en aucun cas appauvrir la création culturelle. C’est toujours en un lieu de nous mêmes où nous ne sommes pas consommateurs que nous nous ouvrons à la création. C’est toujours dans une disposition d’esprit antinomique avec la consommation, une disposition d’esprit qui nous interdit d’en vouloir pour notre argent.
La gratuité est un leurre et un mensonge. Les profits sont énormes pour ceux qui diffusent (les œuvres) sans les produire.
Donc luttons contre le droit de faire des profits sans les produire. Pas contre la gratuité.
La philosophie de bazar, qui tend à définir comme caduque et réactionnaire toute tentative de définition et de régulation du marché de la Toile, ne fait que conforter une politique imbécile conduisant à un assèchement des ressources de la production mettant en péril l'avenir des oeuvres et ceux qui les créent.
Bazar, caduque, réactionnaire, imbécile ? Oh la la !
Nous sommes pour la liberté d'expression et la liberté du consommateur, mais ces libertés ne peuvent s'opposer l'une à l'autre.
Bien sûr que ces libertés sont directement opposées l’une à l’autre. Nous savons tous par notre expérience intime que nous sommes conditionnés en tant que consommateurs et un peu plus libre quand nous nous risquons à rencontrer l’art ou la liberté d’expression. Moi, dans un super-marché, j’ai du mal à acheter des marques que je ne connais pas, mais au théâtre, je prends le risque de me faire chier. On n’est pas tout d’une pièce.
Nous sommes contre le pillage de nos oeuvres. Le soutien politique à la doctrine trompeuse de la gratuité dans un paysage planétaire sans règle, sans rémunération, sans respect du droit moral est une position démagogique que nous dénonçons.
Pillage des œuvres, c’est qui ? La famille Picasso qui au nom du droit d’auteur et du copyrigth fait de la signature du maître un argument publicitaire pour une marque automobile ou l’internaute qui diffuse à ses potes le dessin d’un homme mort sans souci d’argent ? Respect du droit moral oui, mais ça c’est moral, donc sans prix, donc gratuit. Qu’on punisse d’amendes ou de prison les atteintes à mon droit moral, peut-être. On peut en effet penser qu’il faille que le « paysage planétaire ait ses règles ». Mais que j’en reçoive personnellement le prix, que le prix de mon honneur soit évalué en euros, non, quand même ! Rémunération ? Bien sûr. Mais pourquoi serait-elle antinomique avec la gratuité ? Aussitôt découverte, la formule de la relativité, E = MC2, est immédiatement devenue un bien commun de l’humanité. Et on n’a pas entendu dire qu’Einstein, qui l'a trouvée, soit mort dans la misère. Quand le peuple français a inventé l’école gratuite ou la sécurité sociale qui rémunèrent des millions de nos compatriotes, il ne n’est pas fait du mal. Demain, l’art gratuit et les auteurs rémunérés ? Si on se mettait à y réfléchir ?

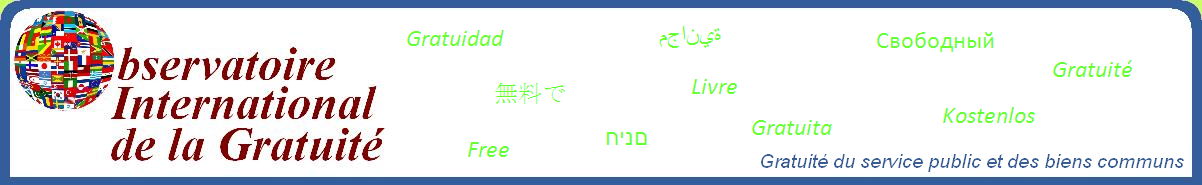


/https%3A%2F%2Fstorage.canalblog.com%2F45%2F62%2F1297332%2F98675872_o.jpeg)