Pour aller à l'essentiel
.
- Jean-Louis Sagot-Duvauroux : « Une expérience de solidarité qui donne le goût de transformer la société »
- Entretien réalisé par I. D. pour le journal L’Humanité
- Lundi, 30 Décembre, 2013
- Philosophe et écrivain, Jean-Louis Sagot-Duvauroux développe l’idée d’un nouveau rapport au tout-marchand, passant par des initiatives locales inédites et probantes.
- Jean-Louis Sagot-Duvauroux est un des premiers à avoir ouvert le débat sur la gratuité, avec son livre Pour la gratuité, en 1995. Avec Magali Giovannangeli, présidente de la communauté d’agglomération du Pays d’Aubagne et de l’Étoile, il a coécrit Voyageurs sans ticket, liberté, égalité, gratuité (1).
-
- En 2009, lorsque la ville d’Aubagne a lancé la gratuité des bus, elle s’est heurtée au scepticisme. Comment l’expliquer ?
- Jean-Louis Sagot-Duvauroux. Faire advenir une idée nouvelle provoque du débat. Tant mieux. Depuis quatre ans, l’expérience a prouvé son efficacité sociale, économique, écologique, humaine. La gratuité de tout est sans doute une chimère, mais un certain nombre de besoins essentiels de l’être humain, comme la santé, l’éducation, les déplacements ou l’eau, peuvent être, sont déjà, par endroits ou en partie, rendus libres d’accès pour tous. Dans les bus d’Aubagne, le chômeur et le notaire sont égaux. Là, l’égalité devient concrète. C’est rare et précieux. Créer des espaces publics où chacun est à égalité sans considération de revenus, c’est une invention politique très désirable et qui peut faire école.
- Quelle est votre définition de la gratuité ?
- Jean-Louis Sagot-Duvauroux. Ce qui est libre d’accès, ce qui ne dépend pas de ce que nous avons dans la poche. La gratuité est une alternative à la façon marchande d’accéder à un bien, soit par la profusion de la nature, par exemple la lumière du soleil, soit par des inventions politiques comme la Sécurité sociale ou l’école gratuite. Ces politiques ont un coût. Mais la révolution est ailleurs. Elle se niche dans la nature de l’accès au bien concerné. Avec la gratuité, c’est « à chacun selon ses besoins » et non plus « à chacun selon ses moyens ». D’une certaine manière, le gratuit est l’axe de notre vie. Une partie de notre temps est vendue sous forme de force de travail. L’autre partie est sans prix. Pour tout le monde, ce qui est sans prix prime sur ce qui est évaluable monétairement. L’amour de nos enfants est plus important que le chariot du supermarché. L’illusion d’optique liée à l’emprise du marché sur les esprits nous empêche d’en être conscients.
- La liberté que procure la gratuité serait-elle aux avant-postes de la question politique ?
- Jean-Louis Sagot-Duvauroux. L’émancipation humaine, c’est-à-dire la liberté en marche, est le fondement du projet communiste initial. La gratuité émancipe du marché et du « chacun pour soi » qu’il porte en lui. Elle émancipe aussi du contrôle policier qui devient inutile. Les anciens communistes parlaient de « dépérissement de l’État ». Pour la doctrine libérale, le maximum de liberté a été atteint grâce au « libre » marché, à la « libre » entreprise, à l’État représentatif, à la consommation comme clef du bien-être, au modèle occidental. Or il existe, dans beaucoup de domaines, souvent localement, des expériences qui s’affranchissent de ce bornage. Dans la région parisienne, la répression très spectaculaire de la « fraude » dans les transports en commun est sans doute la forme la plus prégnante de l’intimidation policière des couches populaires, principalement des jeunes et, parmi eux, de nos jeunes compatriotes noirs ou arabes. Pourquoi ne pas permettre partout et par principe aux moins de vingt-cinq ans de circuler gratuitement ? Ils paieront bien nos retraites. Voilà une vraie revendication populaire alternative. Déjà, on a constaté que l’abolition du zonage le week-end avait fait diminuer les tensions à la gare du Nord, porte d’entrée de la capitale pour les quartiers les plus populaires d’Île-de-France.
- D’après vous, l’idée de gratuité est-elle révolutionnaire ?
- Jean-Louis Sagot-Duvauroux. C’est une expérience de solidarité qui donne le goût de transformer la société. Les tenants du capitalisme nous rabâchent que l’homme ne fonctionne qu’à la cupidité. Faux ! On sait très bien fonctionner aussi à la solidarité. Le problème est que l’argent, invention humaine, est devenu leur maître. La gratuité montre qu’on peut remettre l’argent à sa place, bon esclave, mauvais maître. Les forces qui se recommandent d’une alternative au libéralisme gagneraient à faire l’inventaire des expériences qui ont franchi les frontières dans lesquelles le système enferme la liberté. La gratuité en fait partie. Cet inventaire ouvrirait l’action sur des perspectives politiques et idéologiques moins dépressives que la récrimination contre le malheur des temps.
-
- (1) Éditions Au Diable Vauvert, 2012.
Raoul Vaneigem
La gratuité est l’arme absolue
In Siné mensuel
 Interview du situationniste historique par un de ses vieux potes.
Interview du situationniste historique par un de ses vieux potes.
Membre de l’Internationale situationniste de 1961 à 1970, Raoul Vaneigem est l’auteur du Traité de savoir-vivre à l’usage des jeunes générations (Gallimard, 1967), d’où furent tirés les slogans les plus percutants de Mai 68, et d’une trentaine d’autres livres. Dernier titre paru : L’État n’est plus rien, soyons tout (Rue des Cascades, 2011).
Siné Mensuel : Peux-tu donner une brève définition des situationnistes ?
Raoul Vaneigem : Non. Le vivant est irréductible aux définitions. Ce qu’il y avait de vie et de radicalité chez les situationnistes continue à se développer dans les coulisses d’un spectacle qui a toutes les raisons de le taire et de l’occulter. En revanche, la récupération idéologique dont cette radicalité a été l’objet connaît une vague mondaine dont les intérêts n’ont rien de commun avec les miens.
S. M. : Que voulaient dire les situs quand ils affirmaient que le situationnisme n’existait pas ?
R. V. : Les situationnistes ont toujours été hostiles aux idéologies, et parler de situationnisme serait mettre une idéologie où il n’y en a pas.
S. M. : Pour quelles raisons as-tu rompu avec l’Internationale situationniste en 1970 ? Avec le recul, que penses-tu de Guy Debord ?
R. V. : J’ai rompu parce que la radicalité qui avait été prioritaire jusqu’en mai 1968 était en train de se dissoudre dans des comportements bureaucratiques. Chacun a alors choisi ou de poursuivre seul sa voie, ou d’abandonner le projet d’une société autogérée. Peut-être Debord et moi étions-nous plus dans la complicité que dans l’affection, mais qu’importe la rupture ! Ce qui a été sincèrement vécu n’est jamais perdu. Le reste n’est que l’écume de la futilité.
S. M. : Quel regard portes-tu sur le mouvement des Indignés ?
R. V. : C’est une réaction de salut public, à l’encontre de la résignation et de la peur qui donnent à la tyrannie du capitalisme financier son meilleur soutien. Mais l’indignation ne suffit pas. Il s’agit moins de lutter contre un système qui s’effondre qu’en faveur de nouvelles structures sociales, fondées sur la démocratie directe. Alors que l’État envoie à la casse les services publics, seul un mouvement autogestionnaire peut prendre en charge le bien-être de tous.
S. M. : L’utopisme est-il toujours à l’ordre du jour ?
R. V. : L’utopisme ? Mais c’est désormais l’enfer du passé. Nous avons toujours été contraints de vivre dans un lieu qui est partout et où nous ne sommes nulle part. Cette réalité est celle de notre exil. Elle nous a été imposée depuis des millénaires par une économie fondée sur l’exploitation de l’homme par l’homme. L’idéologie humaniste nous a fait croire que nous étions humains alors que nous restions, pour une bonne part, réduits à l’état de bêtes dont l’instinct prédateur s’assouvissait dans la volonté de pouvoir et d’appropriation. Notre « vallée de larmes » était considérée comme le meilleur des mondes possibles. Or, a-t-on inventé un mode d’existence plus fantasmatique et plus absurde que la toute-puissante cruauté des dieux, la caste des prêtres et des princes régnant sur les peuples asservis, l’obligation de travailler censée garantir la joie et accréditant le paradis stalinien, le Troisième Reich millénariste, la Révolution culturelle maoïste, la Société de bien-être (le Welfare state), le totalitarisme de l’argent hors duquel il n’y a ni salut individuel ni salut social, l’idée enfin que la survie est tout et que la vie n’est rien ? À cette utopie-là, qui passe pour la réalité, s’oppose la seule réalité qui vaille : ce que nous essayons de vivre en assurant notre bonheur et celui de tous. Désormais, nous ne sommes plus dans l’utopie, nous sommes au cœur d’une mutation, d’un changement de civilisation qui s’esquisse sous nos yeux et que beaucoup, aveuglés par l’obscurantisme dominant, sont incapables de discerner. Car la quête du profit fait des hommes des brutes prédatrices, insensibles et stupides.
S. M. : Explique-nous comment la gratuité est, selon toi, un premier pas décisif vers la fin de l’argent.
R. V. : L’argent n’est pas seulement en train de dévaluer (le pouvoir d’achat le prouve), il s’investit si sauvagement dans la bulle de la spéculation boursière qu’elle est vouée à imploser. La tornade du profit à court terme détruit tout sur son passage, elle stérilise la terre et dessèche la vie pour en tirer de vains bénéfices. La vie, humainement conçue, est incompatible avec l’économie qui exploite l’homme et la terre à des fins lucratives. À la différence de la survie, la vie donne et se donne. La gratuité est l’arme absolue contre la dictature du profit. En Grèce, le mouvement « Ne payez plus ! » se développe. Au départ, les automobilistes ont refusé les péages, ils ont eu le soutien d’un collectif d’avocats qui poursuit l’État, accusé d’avoir vendu les autoroutes à des firmes privées. Il est question maintenant de refuser le paiement des transports publics, d’exiger la gratuité des soins de santé et de l’enseignement, de ne plus verser les taxes et les impôts qui servent à renflouer les malversations bancaires et à enrichir les actionnaires. Le combat pour la jouissance de soi et du monde ne passe pas par l’argent mais, au contraire, l’exclut absolument.
Il est aberrant qu’une grève entrave la libre circulation des personnes alors qu’elle pourrait décréter la gratuité des transports, des soins de santé, de l’enseignement. Il faudra bien que l’on comprenne, avant le krach financier qui s’annonce, que la gratuité est l’arme absolue de la vie contre l’économie.
Il ne s’agit pas de casser les hommes mais de casser le système qui les exploite et les machines qui font payer.
S. M. : Tu prônes la désobéissance civile. Qu’entends-tu par là ?
R. V. : C’est ce qui se passe en Grèce, en Espagne, en Tunisie, au Portugal. C’est ce que résume le titre de mon pamphlet écrit pour des amis libertaires de Thessalonique : L’État n’est plus rien, soyons tout. La désobéissance civile n’est pas une fin en soi. Elle est la voie vers la démocratie directe et vers l’autogestion généralisée, c’est-à-dire la création de conditions propices au bonheur individuel et collectif.
Le projet d’autogestion amorce sa réalisation quand une assemblée décide d’ignorer l’État et de mettre en place, de sa propre initiative, les structures capables de répondre aux besoins individuels et collectifs. De 1936 à 1939, les collectivités libertaires d’Andalousie, d’Aragon et de Catalogne ont expérimenté avec succès le système autogestionnaire. Le Parti communiste espagnol et l’armée de Lister l’écraseront, ouvrant la voie aux troupes franquistes.
Rien ne me paraît plus important aujourd’hui que la mise en œuvre de collectivités autogérées, capables de se développer lorsque l’effondrement monétaire fera disparaître l’argent et, avec lui, un mode de pensée implanté dans les mœurs depuis des millénaires.
S. M. : Tu désapprouves le système carcéral mais, en 1996, à la suite de l’affaire Dutroux, tu as participé à Bruxelles à la « Marche blanche » qui, selon la presse française, réclamait une répression accrue des actes de pédophilie. N’est-ce pas contradictoire ?
R. V. : Voilà bien un exemple de contre-vérité journalistique manifeste. Si les parents des victimes de Dutroux avaient réclamé la peine de mort pour l’assassin, la foule aurait abondé dans leur sens. Or, c’est le contraire qui s’est passé. J’admire le courage et le sens humain de Gino et Carine Russo, qui se sont opposés résolument à toute idée de peine de mort (ils ont même prévenu qu’ils n’accepteraient pas que le meurtrier soit, comme de coutume, liquidé par les autres prisonniers). La Marche blanche a été l’exemple rarissime d’une émotion populaire qui en appelait au refus de la pédophilie au nom de l’humain et du refus des prédateurs, et non par le biais de la répression pénale. Il y avait là une dignité tranchant avec l’ignominie populiste qui consiste à se servir de l’émotion pour promouvoir la bestialité répressive, la vengeance. Où voit-on aujourd’hui une réaction collective dénoncer cette stratégie du bouc émissaire qui, pour empêcher que la colère des citoyens s’en prenne aux mafias affairistes, qui les ruinent, sonne le tocsin de la peur et du sécuritaire pour désigner comme menace et ennemi potentiel l’autre, l’étranger, le « différent » – juif, arabe, tzigane, homosexuel ou, au besoin, simple voisin ?
S. M. : Tu as plusieurs enfants. Ne trouves-tu pas cruel de faire délibérément naître de nouveaux êtres dans ce monde-ci ?
R. V. : J’exècre la politique nataliste qui, en multipliant mécaniquement les enfants, les condamne à la misère, à la maladie, à la désaffection, à l’exploitation laborieuse, militaire et sexuelle. Seul l’obscurantisme religieux, idéologique et affairiste y trouve son compte. Mais je refuse qu’un État ou une autorité, quelle qu’elle soit, m’impose ses ukases. Chacun a le droit d’avoir des enfants ou de n’en avoir pas. L’important est qu’ils soient désirés et engendrés avec la conscience que tout sera fait pour les rendre heureux. Ce sont ces nouvelles générations – tout à fait différentes de celles qui furent les fruits de l’autoritarisme familial, du culte de la prédation, de l’hypocrisie religieuse – qui aujourd’hui sont en train d’opposer, si confusément que ce soit, la liberté de vivre selon ses désirs au totalitarisme marchand et à ses larbins politiques.
S. M. : Parle-nous de la cause animale, dont les penseurs révolutionnaires n’ont longtemps tenu aucun compte.
R. V. : Il s’agit moins d’une cause animale que d’une réconciliation de l’homme avec une nature terrestre qu’il a exploitée jusqu’à présent à des fins lucratives. Ce qui a entravé l’évolution de l’homme vers une véritable humanité, c’est l’aliénation du corps mis au travail, c’est l’exploitation de la force de vie transformée en force de production. Notre animalité résiduelle a été refoulée au nom d’un esprit qui n’était que l’émanation d’un pouvoir céleste et temporel chargé de dompter la matière terrestre et corporelle. Aujourd’hui, l’alliance avec les énergies naturelles s’apprête à supplanter la mise à sac des ressources planétaires et vitales. Redécouvrir notre parenté avec le règne animal, c’est nous réconcilier avec la bête qui est en nous, c’est l’affiner au lieu de l’opprimer, de la refouler et de la condamner aux cruautés du défoulement. Notre humanisation implique de reconnaître à l’animal le droit d’être respecté dans sa spécificité.
S. M. : En Belgique, le vote, en principe, est obligatoire. As-tu déjà voté dans ta vie ? Tu paies les amendes ?
R. V. : Je ne vote jamais, je n’ai jamais reçu d’amende.
S. M. : Quelle leçon peut-on tirer de cette longue année pendant laquelle la Belgique s’est passée de tout gouvernement ?
R. V. : Aucune. Pendant le sommeil lucratif des hommes politiques – 55 ministres qui n’ont pas de problèmes de fins de mois – les mafias financières continuent à faire la loi et se passent très bien des larbins qui sont à leur botte.
S. M. : Comment vois-tu la « révolution » en cours dans les pays arabes ? L’islam te semble-t-il une menace pour elles ?
R. V. : Où le social l’emporte, les préoccupations religieuses s’effacent. La liberté qui se débarrasse aujourd’hui de la tyrannie laïque n’est pas disposée à s’accommoder d’une tyrannie religieuse. L’islam va se démocratiser et connaître le même déclin que le christianisme. J’ai apprécié le slogan tunisien : « Liberté pour la prière, liberté pour l’apéro ! »
S. M. : Finalement, tu restes un optimiste irréductible, non ?
R. V. : Je pourrais me contenter de la formule de Scutenaire* : « Pessimistes, qu’aviez-vous donc espéré ? » Mais je ne suis ni optimiste, ni pessimiste. Je me fous des définitions. Je veux vivre en recommençant chaque jour. Il faudra bien que la dénonciation et le refus des conditions insupportables qui nous sont faites cèdent la place à la mise en œuvre d’une société humaine, en rupture absolue avec la société marchande.
Propos recueillis par Jean-Pierre Bouyxou
Illustration : Etienne Delessert
* L’écrivain belge Louis Scutenaire (1905-1987) est l’auteur de Mes inscriptions. Raoul Vaneigem lui a consacré un livre dans la collection « Poètes d’aujourd’hui » (Seghers, 1991).
Construire historiquement la gratuité des services publics
Roger Martelli
Le 1er août 2010, à Cuba, Raul Castro annonce la suppression de 500 000 emplois publics. La Centrale des Travailleurs Cubains justifie aussitôt la mesure par les contraintes d’efficacité économique. Il faut, dit le syndicat, éliminer « des gratuités indues et des subventions excessives ». La France a des moyens de redistribution que l’histoire récente n’a pas accordés à Cuba. Mais l’exemple cubain a la vertu de nous rappeler deux idées fondamentales : que la gratuité ne se décrète pas, mais se construit ; qu’elle n’est pas une donnée isolée, mais un élément d’une globalité.
Le droit à disposer gratuitement des ressources naturelles pour satisfaire des besoins élémentaires fait partie des combats primitifs pour l’égalité. La lutte des paysans anglais contre les « enclosures », celle de leurs homologues français pour le maintien des biens communaux et des droits d’usage ou celle des paysans allemands pour le libre usage du bois mort jalonnent cette primo-histoire. En son temps, cette lutte avait deux faces : progressive par son rappel du caractère absolu de l’égalité et son refus de la marchandisation des droits élémentaires ; rétrograde par son opposition à la plus formidable source de créativité qui se trouvait alors dans l’expansion de la propriété capitaliste.
Nous n’en sommes plus là. D’une part, la demande de gratuité s’est élargie du côté de services jugés essentiels au développement des personnes. En sens inverse, l’universalisation de la marchandise a suivi l’expansion de la sphère capitaliste, réalisant l’intuition qui était celle du Manifeste du parti communiste en 1848. Pourtant, du milieu du XIXe siècle à celui du XXe, la croissance capitaliste a su composer avec la tendance à l’extension de la gratuité vers l’école (années 1880), vers l’assistance médicale (1893), puis vers les prestations de santé en général (1946). Cette marche à la fourniture gratuite de services a été accompagnée par la création, hésitante mais continue, de services publics affectés à la couverture des besoins fondamentaux.
On sait que la notion française de service public a fini par juxtaposer, au début du siècle dernier, la mission d’intérêt général, la personne morale de droit public et l’existence d’un droit et d’un juge administratifs. Au XXe siècle, cette notion s’est accompagnée de la mise en place d’un secteur public. Dans son fondement, le service public est rapporté à la notion révolutionnaire « d’utilité commune » et de « nécessité publique » (1789). Il n’écarte pas le principe de gratuité, à partir d’une double considération, philosophique (la jouissance de la richesse sociale ne saurait être subordonnée à la capacité monétaire des individus à en payer le prix) et administrative (la couverture financière du service est assurée par l’impôt et non par les prix). De fait, aujourd’hui encore, dans une entreprise comme la RATP, les recettes de billetterie représentent au maximum un quart des recettes.
Depuis une bonne trentaine d’années, un mécanisme inverse tend à réduire l’espace de la gratuité. Le secteur public s’est étiolé, avec la conjonction de trois phénomènes : la dévolution croissante au privé des missions de service public, la promotion de l’ajustement managérial et concurrentiel dès le milieu des années soixante, puis la privatisation multiforme. Dans le même temps, l’extension de la prestation payante est présentée comme la condition d’une responsabilisation des individus (contre la logique dite de « l’assistanat ») et d’une affectation adéquate des ressources (l’orientation vers la demande sociale « utile » est confiée au marché). Le glissement de l’usager vers le client est ainsi présenté, tout à la fois, comme la clé de l’efficacité moderne et comme la base première de l’en-commun.
Il faut refuser d’un même mouvement la rétraction du secteur public par la privatisation, sa perversion par l’extension de la règle concurrentielle et sa dénaturation par la marchandisation élargie. En cela, la revendication d’un nouvel élan de la gratuité constitue un horizon stratégique incontournable. Il n’est pas besoin ici d’en dire les justifications éthiques immédiates : le creusement des inégalités et l’installation d’une pauvreté de masse remettent à l’ordre du jour l’extension de la gratuité, a minima pour les plus démunis, en partant de l’idée que le gonflement des capacités monétaires (pouvoir d’achat des salaires et revenus minimaux) ne suffit pas à assurer leur accès à des biens fondamentaux. Des justifications bien plus larges touchent à la fois à la morale sociale et à l’efficacité économique. On démontre aujourd’hui aisément que la non-gratuité des transports urbains produit des coûts dérivés internes (l’importance des dépenses de contrôle, de surveillance et de répression dans les transports) ou externes (les quelque 30 milliards dépensés pour assurer les coûts de la sur-utilisation des transports automobiles).
De façon plus générale, le moment que nous vivons oblige à des ruptures mentales majeures. Quand on met au centre de toute réflexion prospective la question du développement humain et durable, il n’est plus possible de considérer l’expansion des capacités humaines (qualification, santé, mobilité) comme des « coûts » qu’il faudrait réduire en demandant au marché d’en assumer la couverture. La prise en charge collective des dépenses afférentes à l’essor de ces capacités devient une clé des équilibres humains à venir ; or la recette fiscale et son affectation publique, dès l’instant où elles sont délibérées, contrôlées et évaluées de façon permanente et transparente, sont les modes de régulation aujourd’hui les plus justes et les plus performants pour atteindre cet objectif.
Une affirmation de ce type ne peut, sous peine d’échec, ignorer les contradictions réelles. On en retiendra ici deux : celle qui oppose l’extension des besoins humains, individuels et collectifs, et la finitude des ressources disponibles ; celle qui oppose la nécessaire promotion de l’esprit public et la difficulté de son exercice, dans des sociétés marquées en longue durée par les antagonismes de classes et la prégnance des cultures consuméristes et marchandes. Il existe théoriquement trois modèles de régulation de ces contradictions : la régulation marchande, la régulation administrative et l’autorégulation personnelle. On sait les effets potentiellement antagoniques mais également pervers des deux premiers modèles. On sait aussi la difficulté fondamentale du troisième modèle, dont la généralisation ne peut s’inscrire que dans la longue durée des révolutions sociales globales vers un développement non-consumériste et économe en ressources matérielles. Il est des domaines où l’application immédiate du principe de gratuité ne pose pas de problème majeur (les transports urbains). Il en est d’autres où son application non maîtrisée peut conduire à des dysfonctionnements, à des dérives administratives et à un déficit de qualité qui, à terme, pourraient légitimer à nouveau le recours à la règle concurrentielle.
Le plus raisonnable est d’inclure la revendication d’une gratuité étendue des services publics dans une démarche de lutte sociopolitique longue, cohérente et évolutive, articulée en six moments :
1. Tenir pour une tendance imprescriptible l’extension de l’accès gratuit aux services qui conditionnent le développement des capacités humaines (santé, logement, éducation, culture). L’universalité et donc la socialisation de leur accès sont à la fois des droits fondamentaux et des exigences d’efficacité économique et sociale. La planification démocratique de l’affectation des ressources et l’exclusivité du financement par la fiscalité et le crédit public sont les bases garantissant l’accès égal, transparent et si possible gratuit aux services.
2. Agir dès maintenant pour le retour ou pour l’accès plein à la gratuité des domaines où la puissance publique a reculé dans l’exercice même des principes qu’elle avait accepté d’assumer (éducation et santé).
3. Pour cette implication publique, affirmer la nécessité d’un renforcement du secteur public. Il faut revenir sur la lente dégradation des dernières décennies : abroger les privatisations directes ou rampantes ; étendre le secteur public dans les domaines de l’eau, du crédit, des secteurs mettant en jeu la santé. Rétablir l’idée selon laquelle l’appropriation sociale est la meilleure forme pour assumer des missions de service public ; cette appropriation sociale se réalise exclusivement au sein d’un secteur public démocratisé et d’une économie sociale et solidaire débarrassée de la prégnance des contraintes du secteur financier concurrentiel.
4. Proposer l’extension la plus rapide possible de la gratuité dans le domaine où son exercice soulève les objections les plus faibles, à savoir les transports urbains. Pour le cas du logement social, de l’eau, de l’énergie ou des télécommunications, un débat national doit être organisé pour peser les termes des problèmes éventuels et décider, soit de la gratuité totale, soit des critères de gratuité partielle (par des seuils évolutifs d’accès à la gratuité).
5. Plus généralement, considérer que, la gratuité pas plus que les services publics n’étant des données naturelles, leur définition et leur modalité relèvent de la délibération et de la décision collectives. La question démocratique, une fois de plus, est au cœur de toute avancée. Dans le cas de la gratuité, elle devrait se déployer sous deux formes principales : l’extension d’une démocratie directe (incluant la possibilité du référendum) ; la transformation des services publics, dont la modernisation passe par leur démocratisation et, au bout du compte, par leur « désétatisation ». Moins de privé, moins d’État, davantage de « chose publique », c’est-à-dire de commun…
6. La question de la gratuité est une manière de poser en grand l’exigence que les libéraux veulent délégitimer : celle de l’allocation démocratique des ressources disponibles et notamment de la part du « travail » par rapport à celle du « capital ». En 30 ans, sans délibération, 10% de la richesse produite (200 milliards) ont été transférés de la rémunération du travail vers les profits : fatalité ou choix de société ? Selon la réponse, la gratuité est un possible fécond ou une illusion meurtrière.
La perspective révolutionnaire est-elle morte avec l’effondrement du modèle soviétique? Ne peut-on penser pourtant que la crise écologique rend plus actuelles et urgentes que jamais les grandes questions que posaient jadis les différentes familles socialistes?
Le moment est incontestablement venu d’en finir avec une certaine gauche c’est-à-dire avec sa vision de l’histoire, sa conception du politique, son rêve d’un gâteau toujours croissant. En finir avec cette gauche-là est nécessaire pour retrouver, sous ses sédiments solidifiés, le sang qui vivifiait autrefois ses rêves, ses valeurs, ses projets, ses combats, ses conquêtes.
Tout se passe comme si nous avions perdu la capacité d’imaginer un autre monde en raison de ce «trop plein de réalité» qui nous broie et interdit toute évasion. Comment croire qu’être «révolutionnaire» puisse être de revendiquer le SMIC à 1500 euros «tout de suite» face à une gauche réformiste qui le promet pour un peu plus tard ? Si cette identité doit être conservée, être de gauche n’est-ce pas d’abord défendre les dimensions non-économiques de nos existences et de la société, valoriser les cultures populaires, c’est-à-dire se refuser (individuellement et collectivement) comme forçats du travail et de la consommation? Certes, si on ne croit plus en la possibilité de construire une société plus fraternelle, le SMIC à 1500 euros devient une revendication confortable et même juste socialement, car comment pourrions-nous accepter de renvoyer dos à dos exploités et exploiteurs, dominants et dominés, salauds et pauvres types. Mais si nous croyons toujours en la possibilité de rouvrir le champ des possibles, faut-il accepter ce corporatisme qui entretient le système qui nous aliène plus qu’il ne le combat ?
Nous ne pourrons renouer avec l’espérance que si nous rejetons à la fois l’idée qu’un autre monde ne serait pas possible et celle qu’un autre monde serait inéluctable. En finir avec le dogme de la fin de l’histoire ne sera pas nécessairement si simple lorsqu’on constate avec quelle facilité cette gauche s’abreuve aux «globalivernes» de l’époque: après avoir réhabilité l’entreprise et le marché, il nous faudrait épouser leur immondialisation. En finir avec l’autre dogme suppose de régler nos comptes avec la thèse marxienne d’un enchaînement inévitable des sociétés: le capitalisme comme accoucheur du socialisme. J’ai bien peur en effet que la société capitaliste en détruisant tout ce qui restait des sociétés traditionnelles ait fini par inventer les humains qui vont avec ses produits. Nous serions dans ce cas bien plus étrangers au socialisme que nos grands-parents purent l’être. Ce ne serait donc pas par hasard que la nouvelle frontière du socialisme passerait quelque part en Amérique latine et centrale au contact des peuples autochtones les moins déracinés. Ce constat serait désespérant, sauf si nous acceptons de changer de regard et d’admettre que l’anticapitalisme a toujours son siège au cœur même de nos existences
Quel pourrait être le nouveau paradigme révolutionnaire ?
Je suis fondamentalement d’accord avec Jean Zin [auteur de L’écologie politique à l’ère de l’information (2006); il participe à la revue Multitudes]: la notion de «décolonisation de l’imaginaire» (Serge Latouche) ou de «réveil des consciences» (Pierre Rabhi) est totalement insuffisante, car le grand problème est d’abord celui des institutions.
Nous avons besoin d’un principe qui guide nos pas et qui soit capable de fédérer notre action. Les objecteurs de croissance revendiquent «plus de liens et moins de biens», mais comment y parvenir ? Beaucoup de nos amis ne croient pas en la possibilité de faire rêver et de défendre des intérêts, c’est pourquoi ils s’en remettent à la pédagogie des catastrophes. Ces adeptes de « la décroissance faute de mieux » se condamnent à l’impuissance. Je fais, au contraire, le pari opposé: celui du caractère désirable de notre projet. Ce qui suppose de partir de ce qui constitue l’angle mort de tout système car la solution est toujours du côté de la béance… entendue comme ce qui suture la structure.
Toute société est en effet fondée sur un Interdit structurel: la monarchie a ainsi fait du régicide le crime absolu; la bourgeoisie a ensuite élevé le respect de la propriété privée au rang de tabou; l’interdit de la gratuité est désormais ce qui fait système et suture la société de l’hyper-capitalisme. C’est pourquoi contrairement aux autres sociétés marchandes qui ont toujours toléré un secteur gratuit (religieux ou laïc), l’hyper-capitalisme, fondé sur la vénalisation du marchand, ne peut que sacrifier la gratuité. Nos anciens ont dû guillotiner Louis XVI, Proudhon a martelé que « la propriété, c’est le vol », c’est désormais de la défense de la (quasi)gratuité que nous devons partir pour espérer fissurer l’édifice et élargir, peu à peu, cette fissure au point d’en faire société: de la défense des gratuités existantes à l’extension constante de la sphère de la gratuité.
« Gratuité de l’usage, renchérissement du mésusage».
Cette révolution que nous proposons est donc celle de la « gratuité du bon usage ».
Cette notion ne relève pas d’une définition objective et encore moins moraliste. L’usage est simplement ce que la société reconnaît comme tel à un moment donné face au mésusage. La définition est donc affaire de mœurs, de rapports de force, d’état des lieux.
Le premier grand intérêt de ce paradigme est de résoudre la contradiction entre les contraintes environnementales et le souci social car il ne suppose plus de faire croître le gâteau (PIB) avant de procéder à sa redistribution, mais d’en changer la recette. L’autre grand avantage est de réconcilier le temps de la démocratie et celui des écosystèmes, car ce sera aux citoyens de définir ce qui est bon usage (gratuit) et ce qui est mésusage (renchéri). Il fait donc disparaître toute contradiction entre le but et le chemin. Il exige à chaque étape que le politique, la délibération, soit première.
Le législateur saura trouver les solutions techniques adaptées: système de prix variables par niveaux de consommation ou par type d’usage, etc. Pourquoi payer au même tarif le mètre cube d’eau pour faire son ménage et remplir sa piscine privée ? Pourquoi payer les mêmes impôts fonciers pour une résidence principale et secondaire ? Pourquoi payer son essence, son électricité, son gaz le même prix pour un usage normal et un mésusage? L’eau va manquer: raison de plus pour en rendre gratuit le bon usage et renchérir ou interdire le mésusage. Ce paradigme s’oppose à celui de la société dominante: que signifierait en effet l’adoption programmée d’une taxe sur le carbone si ce n’est le fait de vider les rues des voitures des plus pauvres pour que les riches puissent rouler plus vite ?
Ce principe de gratuité généralisable (sous diverses formes) à l’ensemble des biens communs est susceptible de susciter un fort courant de mobilisations populaires donc de créer un débat qui obligera, droite et gauche, à se positionner sur ce terrain. Ce principe a aussi le grand mérite de lier la cause de la liberté (de l’autonomie) à celle de la responsabilité. Contrairement à ce que pourrait être un mariage rouge-vert qui cumulerait les interdits, nous osons la liberté, mais nous rappelons qu’elle doit être encadrée et qu’elle a nécessairement un prix. Chacun reste libre de s’offrir du mésusage (dans la mesure où la loi ne l’interdit pas exceptionnellement): par exemple en possédant une maison de campagne mais en supportant les surcoûts de ce mésusage.
Le danger serait bien sûr que cette politique renforce les inégalités en permettant l’accès aux mésusages à une petite minorité fortunée. Le pire serait de cantonner le peuple au nécessaire (au sérieux) et de libérer, moyennant finances, le futile, le frivole, aux classes aisées. C’est pourquoi ce paradigme de « la gratuité de l’usage» et du «renchérissement du mésusage » ne peut aller sans une diminution importante de la hiérarchie des revenus et sans une réflexion sur l’adoption d’un revenu universel d’existence, RUE, (autour du SMIC) accouplé à un « revenu maximal autorisé », RMA, (au-dessus d’un seuil on prend tout).
Pour un revenu universel inconditionnel lié à un revenu maximum autorisé
Cette vieille idée du 18e siècle d’un revenu universel, qui figure dans l’article 25-1 de la Déclaration universelle des droits de l’Homme de 1948, est toujours restée lettre morte: «Toute personne a droit à un niveau de vie suffisant pour assurer sa santé, son bien-être et ceux de sa famille, notamment pour l’alimentation, le logement, les soins médicaux ainsi que pour les services sociaux nécessaires».
La gauche productiviste n’a jamais voulu engager ce combat sous prétexte que l’introduction d’un revenu universel inconditionnel servirait de prétexte à la droite libérale pour supprimer le salaire minimum. Faisons remarquer à nos amis que le patronat et l’Etat n’ont pas attendu l’adoption d’un RUE pour démanteler le droit du travail…. Les inégalités sociales ont même explosé lorsque cette gauche-là était au pouvoir.
Conséquence: la société s’est monstrueusement habituée aux inégalités de revenus: qui proposerait aujourd’hui un écart maximal de salaires de un à quatre passerait pour un affreux extrémiste, alors qu’il s’agissait d’une mesure phare du Programme commun de gouvernement de la gauche durant les années soixante-dix. En 1974, le revenu moyen des dix patrons américains les mieux payés était 47 fois plus élevé que le salaire moyen d’un ouvrier de l’industrie de l’automobile; en 1999, il équivalait à 2381 fois le salaire moyen. Je propose donc d’opposer à l’insécurité générée par l’hyper-capitalisme le principe d’un revenu universel d’existence (RUE) versé, sans condition, à l’ensemble des citoyens: ce RUE est simplement la contrepartie de la reconnaissance du droit de chacun à l’existence puisque nous héritons tous, en tant que membres de l’humanité, de la civilisation.
L’indépendance financière est indispensable pour passer des droits formels aux droits réels et poursuivre le mouvement d’émancipation notamment des femmes et des jeunes. Elle est en outre la condition même de la décroissance, car aucun individu n’acceptera de diminuer ses activités rémunératrices si la société ne lui assure pas une certaine sécurité.
Ce choix du revenu d’existence est donc celui de la poursuite de la socialisation face au recours aux tribus, chers à la Nouvelle droite qui préférera toujours ses «petites patries» à celui d’une société fondée sur l’autolimitation des besoins comme condition de l’autonomie. Cette mesure en desserrant l’emprise de l’économie allégerait l’obligation de travailler. Cette libération de l’idéologie du travail est sans doute ce qui gêne le plus le co-Président d’ATTAC, l’économiste Jean-Marie Harribey puisqu’il qualifie ce projet de «revenu d’existence monétaire et d’inexistence sociale». Comment peut-on croire encore au mythe du travail libérateur? Pourquoi pas «Moulinex libère la femme» ?
Disons-le tout de suite: l’argent ne manque pas pour financer ce RUE. Des pays moins riches notamment l’Alaska et le Brésil l’expérimentent à un niveau financier trop faible. La France a consacré en 2005 un budget de 505 milliards pour ses organismes sociaux. Les ménages en ont reçu 438 milliards au titre des différentes allocations. Le reste est consacré aux services publics (écoles, hôpitaux, etc.). L’affectation directe de tout ou partie de ces 438 milliards aux 60 millions de Français ne pose donc pas un problème comptable mais une question de choix de société: comment voulons-nous vivre ?
Ce revenu d’existence est en outre inséparable d’un revenu maximal autorisé (RMA). Là où Sarkozy prône, avec la notion de bouclier fiscal, de ne pas redistribuer une partie des revenus au-dessus d’un certain plafond, nous disons l’inverse: au-delà d’un certain revenu, l’Etat prend tout. L’adoption de ce RMA (par le biais de la pression fiscale) permettrait de financer le revenu universel et l’extension de la gratuité.
Ce RUE pourrait être versé en partie en monnaie locale pour favoriser la relocalisation des activités (pas seulement économiques), en partie en monnaie fondante pour éviter la capitalisation voire sous forme de droits de tirage sur des biens communs (allocations en nature).
Quelle culture de la gratuité ?
Il ne peut y avoir de société de la gratuité sans culture de la gratuité, comme il n’existe pas de société marchande sans culture marchande. Les adversaires de la gratuité le disent beaucoup mieux que nous. John H. Exclusive est devenu aux Etats-Unis un des gourous de la pensée «anti-gratuité» en publiant « Fuck them, they’re pirates » («Qu’ils aillent se faire foutre, ce sont des pirates»). Il y explique que le piratage existe parce que les enfants sont habitués à l’école à recopier des citations d’auteurs, à se prêter des disques, à regarder des vidéos ensemble, à emprunter gratuitement des livres dans les bibliothèques, etc. L’école (même américaine) ferait donc l’éducation à la gratuité.
Les milieux néoconservateurs proposent donc de développer une politique dite de la «gratuité-zéro» qui serait la réponse du pouvoir aux difficultés des industries «culturelles» confrontées au développement des échanges gratuits, via les systèmes «peer-to-peer». La politique à promouvoir sera totalement à l’opposé et passera par la généralisation d’une culture de la (quasi)gratuité. Nous aurons besoin pour cela de nouvelles valeurs, de nouveaux rites, de nouveaux symboles, de nouvelles communications et technologies, etc. Puisque les objets sont ce qui médiatisent le rapport des humains à la nature quels devront être le nouveau type d’objets de la gratuité ?
L’invention d’une culture de la gratuité est donc un chantier considérable pour lequel nous avons besoin d’expérimenter des formules différentes mais on peut penser que l’école sera un relais essentiel pour développer une culture de la gratuité et apprendre le métier d’humain, et non plus celui de bon producteur et consommateur. Parions que la gratuité ayant des racines collectives et individuelles beaucoup plus profondes que la vénalité en cours, il ne faudrait pas très longtemps pour que raison et passion suivent…
Comment avancer vers la gratuité ?
Jean-Louis Sagot-Duvauroux (Pour la gratuité, DDB, 1995) a défini toute une démarche pour avancer vers la gratuité qui pourrait nous servir de modèle. Il propose de «répertorier tous les espaces de gratuité qui subsistent et que la nomenclature habituelle de nos représentations éparpille sous des rubriques différentes. Cela permettrait de faire apparaître un territoire beaucoup plus grand qu’on ne l’imagine au premier abord, un rapport de force beaucoup plus disputé entre le gratuit et le marchand, prise de conscience qui constitue en elle-même un puissant encouragement à combattre le règne de l’argent.»
A côté des gratuités construites (l’école, les bibliothèques) existent des gratuités premières (la lumière du soleil, l’air), et des îlots de gratuité notamment dans le cadre familial, amical, coopératif. Ce repérage permet déjà de constater que, malgré ce que voudrait nous faire croire le système, la gratuité n’est pas morte: «Tracer la géographie du continent gratuité fait surgir à la conscience des images et des perspectives inattendues: l’argent et ses lois n’ont pas pris le pouvoir partout; la vie humaine n’est pas forcément vouée au culte de la marchandise; même si elle reste un parti pris, la gratuité n’est pas une illusion.»
La notion de la gratuité constitue un excellent levier de changement, parce qu’elle est enracinée au plus profond de l’histoire et de la conscience humaine: du mythe du paradis terrestre au souvenir fantasmé du sein maternel (Maurice Bellet, Plaidoyer pour la gratuité et l’abstinence, Bayard, 2003). Marcel Mauss puis l’équipe d’Alain Caillé [qui dirige la Revue du MAUSS, Ed. La Découverte] ont montré en quoi on est intellectuellement et ontologiquement obligé de poser l’idée d’une gratuité initiale pour fonder la société. C’est donc cette donation première qui fait tenir les hommes ensemble.
La loi du don engendre une triple obligation: celle de donner, celle de recevoir et celle de rendre. Le don constitue donc une véritable institution. Cette universalité du don engendre l’universalité de la lutte pour pouvoir donner.
Notre société, pour avoir trop évacué le don, s’en trouve fortement fragilisée: seule la gratuité pourrait remédier au malaise dans la civilisation. Jean-Louis Sagot-Duvauroux ajoute que «Ce combat pour améliorer la part gratuite de la vie» peut servir de «boussole pour des combats apparemment dépareillés» comme le mouvement pour la gratuité des transports collectifs urbains, du logement social, du droit au sol, etc.
L’extension de la sphère de la gratuité est la meilleure façon de contrer la tendance actuelle à la privatisation généralisée (du vivant, des espaces urbains, aériens, maritimes, des plages, des forêts, etc.) et donc au mésusage: avec la défense de la (quasi)gratuité, nous pourrions conquérir de nouveaux bastions, au lieu de nous cantonner à une attitude défensive des services publics existants, et créer ainsi un rapport de force plus favorable.
Face au capitalisme qui est une machine à insécuriser, nous devons sécuriser. Face au capitalisme qui est une machine à tout vénaliser: nous devons dévénaliser. Face au capitalisme qui déterritorialise, nous devons défendre l’usager maître de ses usages.
Tout ce qui permet de retrouver l’usager (nécessairement multiple) derrière la figure trompeuse du consommateur est positif. Mais ne nous leurrons pas: il ne suffit pas de renouer avec un autre vocabulaire pour métamorphoser les conceptions et les pratiques. Il ne s’agit pas davantage de fantasmer sur un retour des anciens usages: non seulement c’est impossible mais pas souhaitable. Serait-il profitable de revenir à des objets sexués ? Nous pouvons rompre avec la société productiviste et de consommation sans faire de nouveau des serpillières et des balais les biens propres des usagères (des femmes).
Il s’agit bien de réinventer un autre mangeur derrière le consommateur de produits alimentaires, de réinventer un nouveau patient derrière le consommateur de soins (para)médicaux, de réinventer un nouvel élève derrière le consommateur de cours, etc. Tous ces combats sont parallèles mais dissemblables puisqu’il s’agit justement de faire (re)naître des usages spécifiques: nous sommes du côté de la dé-liaison de ce que la consommation a lié. Nous devons désapprendre à penser que manger et lire serait comparable donc aucune alter-consommation ne peut les réunir. Cette réinvention de l’usage passe par une anthropologie sensualiste. Le bon usage est toujours du domaine du voir, de l’entendre, du toucher, du goûter, du contempler, du penser, de l’aimer, de l’agir alors que le mésusage est du registre de l’avoir, du paraître, du vénal.
J’insiste: la culture de l’usage n’est pas celle du nécessaire. Elle ne s’oppose pas à la frivolité, bien au contraire, contrairement à toute une tradition de l’extrême gauche qui réduisait sa pensée aux «vrais» besoins. Le bon usage, c’est aussi la fête c’est-à-dire faire bombance, faire du bruit, mélanger le politique et le commercial, le livre et les merguez.
«Gratuité de l’usage» et «renchérissement du mésusage»: voilà qui aiderait cependant à renouveler la pensé d’une gauche déboussolée et d’une écologie exsangue, voilà qui pourrait renouveler les formes de notre combat.
[Ces questions sont développées dans Paul Ariès, Le Mésusage, Essai sur l'hypercapitalisme, Parangon, 2007.]
Construire un nouveau pacte des droits sociaux
Pour un revenu social démonétarisé
Par Paul Ariès
Nous sommes tributaires d’une longue histoire en matière de luttes et d’acquis sociaux pour garantir à chacun ( e) le droit de vivre dignement quelle que soit sa situation personnelle. Le pacte des droits sociaux dont nous avons hérité (notre sécurité sociale) arrive aujourd’hui à bout de souffle car il correspondait à une société croissanciste qui nous conduit dans le mur. Alors que les naufragés du système sont de plus en plus nombreux et sans perspective de trouver une place dans cette société qui ne veut pas d’eux et dont eux-mêmes n’attendent plus rien, alors que la planète est DEJA assez riche pour faire vivre tous les humains, nous ne devons pas accepter les politiques de récession sociale, nous devons, bien au contraire, affirmer qu’être fidèles aux combats émancipateurs c’est être encore plus exigeants, c’est imposer un nouveau pacte de droits sociaux qui ne soit pas en retrait mais davantage protecteur, c’est imaginer un nouveau pacte qui ne nous conduise pas à défendre un système qui nous tue, mais qui nous permette de commencer à changer véritablement de société. Les adeptes d’un revenu social ne sont donc pas moins disant en matière social mais mieux disant.
Le revenu garanti est un composant essentiel de ce nouveau pacte social qui permettra d’avancer vers plus d’autonomie et d’en finir avec la centralité du travail dans nos existences. Je n’ignore rien de la qualité des débats qui opposent les partisans d’un revenu d’existence (ou citoyen) aux adeptes d’une dotation inconditionnelle d’autonomie (DIA), sans même parler de la revendication des confédérations syndicales en faveur d’un « salaire socialisé ». Nous sommes donc tous d’accord pour dire que la société doit garantir à chacun (e ) de quoi vivre, simplement certes, mais de façon totalement sécurisée et de manière inconditionnelle. Les débats sur les formes que doit prendre ce revenu social doivent naturellement se poursuivre mais je crois que nous avons tout à gagner à ne pas cultiver ce qui nous différencie/divise mais bien au contraire à chercher une convergence qui tienne compte de notre histoire. Nous ne devons plus répéter vingt ans d’échec et plus de notre combat en faveur d’un revenu social. Nous ne devons pas davantage être dupes lorsque nos adversaires de droite comme Alain Madelin, Christine Boutin ou Dominique de Villepin parlent de « dividende social »… Ce qui nous oppose à la droite ce n’est pas seulement le montant du revenu garanti, ce n’est pas uniquement son caractère universel ou pas, inconditionnel ou pas, c’est la place qu’occupe ce revenu garanti universel et inconditionnel comme instrument de sortie du capitalisme et du productivisme. Pour le dire autrement : le revenu social n’est pas un revenu de survie… Il est lié à la notion de gratuité donc à la construction de « communs », il est donc un instrument du passage vers une autre société et non pas une façon de faire survivre les naufragés du système.
J’ai toujours dit ma préférence pour un revenu inconditionnel qui aurait plusieurs formes : une partie versée sous forme de monnaie nationale, une autre partie sous forme de monnaie locale (pour faciliter la relocalisation de biens socialement et écologiquement responsables) et une partie, essentielle à mes yeux; sous forme de droits d’accès aux biens communs. Je suis convaincu aujourd’hui que notre combat pour un revenu garanti doit prendre avant tout la forme de la défense et de l’extension de la sphère de la gratuité (libre accès à certains biens et services). J’en suis convaincu autant pour des motifs pragmatiques que théoriques. Les Français aiment leurs services publics notamment locaux et ils y sont attachés. Les gauches et l’écologie antilibérale disposent dans ce domaine d’une tradition et d’un vrai savoir-faire. Nous pourrons plus facilement convaincre nos concitoyens mais aussi les appareils militants que la défense des SP passe nécessairement par leur rénovation, dont la gratuité fait partie.
Le bon combat n’oppose donc pas les partisans que nous sommes d’un revenu garanti à ceux qui défendent les services publics mais il oppose ceux qui défendent à reculons les services publics (en multipliant les partenariats privé/public, en généralisant les abandons de droits, etc.) et tous ceux, dont nous sommes, qui veulent garantir à chacun le droit de vivre dignement. Nous pouvons prendre la tête de ce mouvement de défense des services publics en prônant la gratuité du bon usage face au renchérissement du mésusage individuel/collectif. Le colloque co-organisé par le Sarkophage et la communauté d’agglomération les lacs de l’Essonne a montré que des petits bouts de gratuité sont conquis dans de nombreuses villes. Ici, on commence par la gratuité de l’eau vitale, ailleurs par celle des transports en commun urbains, ailleurs encore par celle des activités culturelles et des services funéraires, ailleurs on réfléchit à la gratuité de la restauration scolaire et à celle du logement social, etc. D’autres ont pu également parler d’un bouclier énergétique face à l’inflation des coûts. Le grand mérite de ce combat pour donner à chacun les moyens de Bien-vivre c’est qu’il n’apparait pas illusoire mais possible puisqu’il part du vécu de la population, puisqu’il mobilise un imaginaire qui est déjà ancré depuis des siècles (celui de la gratuité de l’école par exemple, celui aussi des droits sociaux, celui de la redistribution sociale via la fiscalité, etc.). Toutes les expériences réalisées montrent que cette façon de penser le droit de vivre dans la dignité oblige à un surcroit de démocratie, oblige à faire de la politique autrement c’est-à-dire à partir du vécu de la population, à partir des choix de gratuité qui peuvent être offerts (gratuité de l’eau vitale ou des transports en commun contre celle du stationnement urbain). Toutes les expériences réalisées montrent que cette façon de penser le droit de vivre permet de lier le contenu social et le contenu écologique, bref d’avancer vers une société antiproductiviste. Il ne s’agit pas en effet de remunicipaliser la restauration scolaire pour faire la même chose que les géants de la restauration commerciale, il s’agit d’avancer vers une alimentation relocalisée, désaisonnalisée, moins carnée, moins gourmande en eau, biodiversifiée, etc. Cette question de la gratuité du bon usage est l’un des chemins les plus directs pour arriver à lier le social et l’écologique, le rouge et le vert…
Ce combat en faveur d’une DIA démonétarisée au maximum présente en outre deux autres avantages : il oblige à faire des choix collectifs dès lors que ce sont les citoyens qui doivent décider ce qui sera gratuit donc ce qui est doit être produit en priorité et comment le produire. C’est donc une excellente pédagogie pour apprendre à différencier (selon) les besoins, c’est à dire pour être du côté des usages, des utilités, et non pas de la valeur marchande. Ce chemin n’est pas sans embuche : admettons avec le réseau Négawatt que l’on veuille assurer à chacun non pas une certaine quantité de fioul domestique ou un certain nombre de kg watt mais un égal droit une température minimale, comment procéder ? quel niveau garantir ? Ce combat en faveur d’une DIA (ou si l’on préfère d’un revenu garanti) démonétarisé est enfin un premier pas pour réapprendre à déséconomiser nos existences et nos combats politiques (parler de droits d’accès aux biens communs est mieux que de parler de revenus financiers). Je suis convaincu que nous pouvons gagner toute une fraction des gauches existantes à ce combat (sans compromission aucune, sans rien céder sur la critique de l’économisme). Cette façon de poser le débat court-circuite les oppositions traditionnelles au revenu garanti (la préférence pour la réduction du temps de travail (32 heures tout de suite !) plutôt qu’un revenu garanti, la crainte que le revenu garanti soit une variante du « tititainement" (variante moderne de la maxime romaine antique « du pain et des jeux », le besoin de reconnaissance sociale par le travail notamment dans les milieux populaires, etc.). Cette affirmation d’un revenu garanti démonétarisé (au maximum de ce qui est possible) est enfin une façon de rappeler que la construction de communs est la seule richesse des pauvres. Nous allons ainsi bien au-delà de la seule question légitime de la redistribution. Nous commençons déjà par changer de société, par prôner un égalitarisme radical.
Ce combat pour les biens communs et leur gratuité se développe sur tous les continents. Son parangon reste la guerre de l’eau à Cochabamba, en Bolivie, où une insurrection sociale est parvenue à s’opposer à la privatisation et a marqué le début, en avril 2000, du cycle de manifestations qui conduiront Evo Morales à la Présidence de la République. Nous pouvons avec la DIA démonétarisée mettre la question des « communs » au cœur de notre combat.
« Commune » est un mot latin composé de deux racines, cum qui signifie « avec » et munus qui veut dire « don ». Commun se rapporte donc au don par lequel on est lié aux autres du fait même de l'avoir reçu, avec et comme les autres. Le commun n'est donc pas un ensemble de biens qui n'appartiendrait à personne et que tout un chacun pourrait utiliser librement. Il ne faut pas confondre le commun avec ce que le droit romain qualifiait de res nullius (la chose sans maître). Le commun est un don qui oblige à rendre donc il est avant tout une relation. Ce qui signifie qu’il n'y a pas de biens communs en soi (comme l’eau ou l’éducation) donc que notre combat doit être de convaincre tous ceux qui se contentent de vouloir l’eau vitale gratuite, qu’il faut aller beaucoup plus loin dans ce domaine, que c’est nécessaire écologiquement, socialement, culturellement, politiquement, anthropologiquement. Le danger de la conception restrictive en vogue au sein de l’altermondialisme est en effet de faire des « communs » une simple exception aux biens marchands. Si on peut imaginer de commencer par la gratuité de l’eau vitale ou celle des transports en commun urbains, il s’agit bien de poursuivre ce mouvement au-delà de ce qui est strictement vital. Ainsi en lançant en Janvier 2009, l’appel pour des « produits de haute nécessité », Patrick Chamoiseau, Edouard Glissant et autres poètes et militants des Antilles fondaient ce qui allait devenir une poétique de l’existence qui n’est pas sans rappeler le mouvement pour le Buen-Vivir. Si un revenu garanti universel, inconditionnel et au maximum démonétarisé est une des conditions du socialisme de la décroissance, du socialisme gourmand dont je rêve, cela signifie qu’il ne s’agit nullement de partager des biens vitaux (même si cela est nécessaire). Il s’agit donc d’inventer un nouveau socialisme qui ne soit plus celui de la misère que dénonçait Marx mais pas davantage cette mauvaise copie du productivisme que fut le socialisme réel. Je crois enfin que nous devons soutenir avec force le principe de l’inconditionnalité pour ne pas risquer de réintroduire en contrebande une vision trop économique du monde/ de la vie. Le fameux donner/accepter/rendre concerne le domaine des ressources nécessairement rares mais il ne peut régir celui des relations inépuisables qui fondent l’humanité en chacun de nous.
Ces questions sont d’autant plus importantes que certains courants de la décroissance sont portés vers une approche néo-malthusienne. Il ne s’agit pas (principalement) de partager parce qu’il y a peu (le fameux « on va manquer ») mais parce que le partage est du côté de la jouissance d’être, seul principe anthropologique que nous pouvons opposer à la jouissance d’avoir (in Paul Aries, le socialisme gourmand, La Découverte, mars 2012). Notre choix de construire des « communs » est donc d’abord l’affirmation de la primauté du don, mais d’un don libéré de la contrainte de rendre. Je préfère parler d’un don sans retour, d’un don de pure générosité, de pure frivolité, un don qui nous renvoie davantage aux stratégies d’embellissement y compris dans le règne animal qu’à de sombres calculs d’apothicaires, un don qui permette d’imaginer une intention gratuite, bref de l’amour

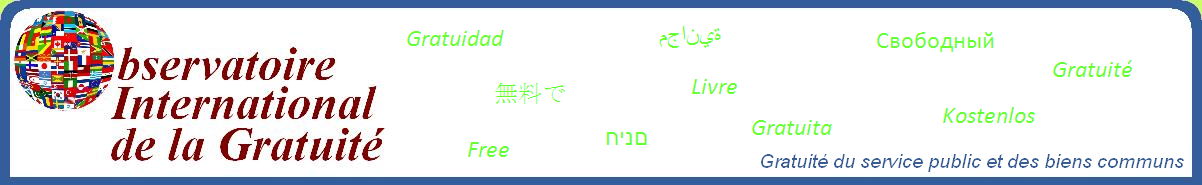


/https%3A%2F%2Fstorage.canalblog.com%2F45%2F62%2F1297332%2F98675872_o.jpeg)